|
Bienvenue ! |
SAINT-POL-DE-LEON SOUS LA REVOLUTION (CHAPITRE 15). |
Retour page d'accueil Retour page "Saint-Pol-de-Léon sous la Révolution" Retour page "Ville de Saint-Pol-de-Léon"
CHAPITRE XV.
SOMMAIRE.
Les esprits se montent dans les campagnes. — Morlaix envoie des troupes à Plouvorn. — Le Jureur Dumay donne sa démission de Procureur de la Commune. — Le sieur Leyer, vicaire à Landerneau, sollicite l'aumônerie de l'hôpital de Saint-Pol. — La veuve Danguy se propose pour remplacer les Hospitalières « non constituées ». — La municipalité demande des instructions au Directoire de Morlaix, au sujet du prochain départ des Ursulines. — Dreppe nommé professeur d'hydrographie. — Ménez, maître d'école, refuse de prêter serment à la Constitution. — Sévézen, autre maître d'école, prête serment. — Dumay veut revenir sur sa démission. — Admirable lettre adressée d'Angleterre par Mgr de La Marche à l'Administration du Finistère.
MONSIEUR PRUD'HOMME DE KERAUGON
avait donné sa démission de maire le 7 janvier 1792 à la suite du violent
réquisitoire de l'Intrus Dumay, procureur de la Commune. Le 22, on devait
procéder à l’élection d'un nouveau maire. Le conseil, craignant des troubles, à
cette occasion, demanda au district de Morlaix des commissaires pour venir
assister le bureau. Ce que la municipalité redoutait arriva en effet. Par suite
des troubles qui survinrent le 22 janvier, l'élection ne put se faire. Le
district de Morlaix n'avait envoyé ce jour aucun de ses membres à Saint-Pol, ce
qui mit les conseillers dans un grand embarras. On dut remettre l'élection au
dimanche 29.
Ce qui se passait journellement sur tout le territoire inspirait de l'horreur pour le nouveau régime. On traquait les prêtres fidèles et on imposait de force aux paroisses des ecclésiastiques dont la conduite laissait grandement à désirer. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris, si, en l'état actuel des choses, les têtes se montaient, et si surtout dans les campagnes les esprits fermentaient. Dans tout le Léon, les paroisses commençaient à s'agiter, et sur plusieurs points il se tenait des rassemblements ; Plouvorn était signalé comme le principal lieu des réunions. Ordre fut donné à deux cents hommes de la garde nationale soldée de Morlaix et à une compagnie d'artilleurs de se rendre, avec deux pièces de canon à Plouvorn. Mais à leur arrivée, tout y était tranquille, ce qui n'empêcha pas de condamner la Commune à payer le séjour des soldats, parce qu'elle avait soutenu les prêtres réfractaires.
L'ancien maire de Saint-Pol, devenu procureur du district de Morlaix, le citoyen Raoul déclara que Plouénan subirait bientôt le sort de Plouvorn. Il fallait, disait-il, prendre les paroisses du Léon par la bourse, si on voulait en venir à bout et soutenir uniquement les curés et les vicaires constitutionnels.
Ces mesures, loin d'apaiser les esprits, contribueront à les indisposer de plus en plus. Nous n'aurons que trop souvent l'occasion de le constater.
La suppression du collège et la fermeture des petites écoles tenues par les Ursulines avaient été démandées, le 25 novembre 1791, par le curé Dumay. Le conseil municipal s'y refusa. Il adressa une expédition du réquisitoire de l'Intrus au Directoire du département avec prière de maintenir le collège qui était désormais la seule ressource des malheureux habitants de Saint-Pol.
Le conseil départemental fit droit, le 1er décembre, à cette requête. Il consentait même à conserver le principal et les professeurs actuels à la condition toutefois de prêter le serment prescrit par la loi du 26 décembre 1791. La municipalité de Saint-Pol invitait en conséquence le 30 décembre 1791 le principal et les professeurs, à prêter ce serment, sous peine de destitution. Ces messieurs s'y refusèrent et adressèrent, le 6 janvier 1792 une lettre collective à la municipalité pour expliquer leur conduite.
On dut pourvoir à leur remplacement.
Voici comment les choses se passèrent ; nous citons le registre :
« Le 15 février 1792, le conseil, à défaut de maire proclamé, était réuni par M. Déniel, assisté de MM. Berdelo, Miorcec et Le Roux.
M. Raoul, procureur syndic du district de Morlaix, introduit dans la salle, dépose sur le bureau la commission à lui octroyée le 12 de ce mois par MM. du Directoire du district de Morlaix de congédier le principal et les professeurs actuels de Saint-Pol et d'y installer les nouveaux principal et professeurs admis par l'arrêté du Directoire du département du Finistère, daté du 4 de ce mois, et duquel la copie est céant. M. le commissaire a requis acte du dit dépôt, et que l'Assemblée le suive au dit collège pour assister à ses opérations et en dresser procès-verbal ».
En l'endroit se sont présentés les nouveaux principal et professeurs.
Savoir, MM. :
Jean-Toussaint Gouez, principal.
Pierre-Marie Trobert, professeur de
physique.
Michel-Marie Pondaven, professeur de logique.
Jean-Marie Perrin,
professeur de rhétorique.
Jacques-Pierre Coustou, professeur de seconde.
Jean-Baptiste Bourguays, professeur de quatrième.
Julien-Marie Balanec,
professeur de cinquième.
Absent : M. Bourzou, professeur de troisième.
« Chacun des dits sieurs a mis sur le bureau un extrait à lui relatif du sus-dit arrêté du département et a offert de prêter le serment requis ».
« L'Assemblée a décerné à M. Raoul acte du dépôt de la sus-dite commission et aux dits sieurs Gouez, Trobert, Pondaven, Perrin, Coustou et Balanec acte de leur présence, de la représentation de leurs extraits singuliers sus refférés, et de ce que individuellement ayant la main levée ils ont jurés qu'ils seront fidèles à la Nation, à la Loi, au Roy, qu'ils maintiendront la Constitution de tous leurs pouvoirs et qu'ils rempliront avec zèle et courage les fonctions leur confiées ; vont tous les membres de l'Assemblée accompagner M. le commissaire du district de Morlaix au dit collège aux fins requises et autres qu'il appartiendra, et ont tous les sus nommés présents signés » [Note : Reg. 23. Fol. 17, recto].
Fait et délibéré les dits jour et an que devant.
Pondaven, Goëz, principal, Trobert, Raoul, J.-P. Coustou, J.-M. Perrin, J. Balanec, Miorcec, De Mic, Berdelo, Le Roux, Morel, J.-B. Le Bourguays.
C'en était fait du collège de Léon. La confiance des familles suivit ses anciens professeurs dans leur retraite, et force fut bientôt de fermer le collège, faute d'élèves. Trois jours après, le citoyen Raoul était encore à Saint-Pol. Il exhibait à la municipalité la commission qui lui avait été donnée par le district de Morlaix, le 12 février. Il lui était enjoint de se faire accompagner de deux commissaires et de M. Le Roux, ingénieur, pour visiter les maisons des cy-devant Minimes, cy-devant Lazaristes, Carmes, Ursulines et la Retraite, afin de désigner un lieu propre à l'établissement, à Saint-Pol, d'un atelier de charité, conformément à l'arrêté du Département du 13 décembre 1791.
MM. Miorcec, Le Roux, officiers municipaux sont choisis pour accompagner le commissaire et l'ingénieur. La séance du conseil, qu'on avait dû suspendre, fut reprise à 4 h. 1/2, au retour de la commission qui déclara que la maison de la Retraite était la plus convenable pour l'établissement en vue.
La question néanmoins n'était pas à la veille d'être tranchée.
Ainsi que nous avons eu l'occasion de le remarquer, le drapeau national avait dû être changé. M. Le Verrier, capitaine commandant le 1er bataillon du 39ème en garnison à Saint-Pol, vint le 21 février 1792, à la maison commune, prier la municipalité d'assister le jeudi suivant à la bénédiction du drapeau du régiment.
Le même jour, le sieur Nicolas Guernigou, natif de Morlaix, se présente à l'Assemblée et déposée sur le bureau un extrait de l'arrêté du Département, du 16 février, le nommant professeur de troisième, en remplacement du sieur Boursou. Il prête serment et signe [Note : Reg. 23. Fol. 17, recto].
Le 26 février 1792, le curé Dumay donne sa démission de procureur de la Commune. Ce fut un soulagement pour toutes les âmes honnêtes. Le conseil municipal, dont il était loin d'avoir les sympathies, lui vote néanmoins des remerciements, tout en acceptant sa démission et fixe l'Assemblée primaire au dimanche, 11 mars, pour procéder à l'élection d'un nouveau procureur.
Dans une séance, tenue trois jours après, le sieur Miorcec donnait lecture à l'Assemblée d'une lettre adressée, le 3 février, à M. Rageul par le sieur Leyer, prêtre et vicaire de Landerneau, sollicitant la place d'aumônier de l'hôpital de Léon et tout le traitement attribué à cette place ; il se proposait en outre de faire les fonctions de vicaire dans la paroisse, moyennant aussi le traitement à ce attribué.
M. Miorcec pria l'Assemblée de délibérer en faisant observer que l'aumônier actuel de l'hôpital ne pouvait aux termes des décrets de l'Assemblée nationale remplir ses fonctions, ne s'étant pas conformé à la loi du 26 décembre 1790.
M. Dumay fut prié de répondre à la sus-dite lettre, la municipalité étant d'avis de le recevoir.
L'Intrus avait reçu aussi une lettre d'une certaine veuve Danguy qui se proposait de remplacer les Dames hospitalières, attendu que celles-ci n'étaient pas constituées. Communication de cette lettre fut faite par l'Intrus au conseil qui répondit à la dame Danguy d'attendre la décision de la municipalité qui voulait installer, le même jour, le nouvel aumônier et les nouvelles hospitalières [Note : Reg. 23. Fol. 21, recto et verso].
D'après la rumeur publique, le premier bataillon du 39ème était rappelé, ce qui ne laissait pas de beaucoup alarmer la municipalité, les Ursulines devant aussi quitter bientôt leur communauté. On craignait qu'à cette occasion le peuple ne se portât à des excès que la garde nationale n'était pas en état ni de prévenir ni d'empêcher. Le conseil municipal demanda, à Morlaix, des instructions sur la conduite à tenir à l'égard de ces religieuses.
1° Devait-on leur accorder leurs effets de chambre, leur argenterie et
linge, et en quelle quantité ?
2° Les sœurs converses devaient-elles être
traitées sur le même pied que les religieuses de chœur ?
3° L'aumônier
pouvait-il réclamer quelques effets, ornements ou linge d'église ?
4° Au
moment de la sortie des religieuses, ne faudra-t-il pas y mettre deux gardiens,
la maison étant si vaste ?
5° Quel traitement attribuer à chaque gardien, et
seront-ils autorisés à cultiver le jardin et à vendre les denrées ?
6°
L'aumônier devra-t-il se retirer le même jour que les religieuses ?
7° Les
officiers municipaux pourront-ils demander à ces religieuses la représentation
de l’argent monnayé ou en dépôt qu'elles peuvent avoir entre leurs mains et s'en
saisir ?
Les membres du district de Morlaix répondent le même jour que la loi du 14 octobre 1790 doit, comme toutes les autres, être observée envers les religieuses. Il ne s'agit pas de donner de l'extension à cette loi ni de l'interpréter en défaveur des Ursulines. On doit entendre par mobilier les effets qui auraient été à leur usage personnel, tant ce que chacune d'elles avait en sa possession, exception faite des effets mobiliers communs à la maison ; dans ces effets entrent naturellement un couvert d'argent que chacune est d'usage de porter pour son usage. La loi n'ayant point déterminé aucune quantité de linge, on ne peut la désigner ; les frustrer de cette partie du mobilier serait excéder la rigueur de la loi. La même loi n'a pas privé les sœurs ; elles doivent jouir des mêmes avantages.
Il n'en est pas de même de l'aumônier qui n'a aucun droit sur les effets, ornements ou linge d'église qui, étant déclarés bien nationaux, doivent rester sous la surveillance de l'administration. Cet ecclésiastique salarié par la maison, n'a droit qu'à la réclamation des objets qui lui sont propres.
Il n'y a point de doute que l'on doive nommer des gardiens suffisants, après avoir fait l'inventaire.
L'aumônier de cette maison ne doit plus y rester, les religieuses ayant quitté.
Quant à la dernière question de la lettre de la municipalité, elle n'est pas admissible. Un corps constitué ne peut se permettre une demande injurieuse à l'administration. Il n'y aurait aucun inconvénient à se saisir des dépôts volontaires que les religieuses pourraient désirer mettre entre les mains des officiers municipaux, mais on ne doit pas en provoquer de toute autre nature.
M. Miorcec est, à l'unanimité des voix, élu maire. Il en accepte la charge, le 4 mars 1792, à la joie de tout le monde. M. Le Bihan devient procureur de la Commune au lieu et à la place de l'Intrus Dumay démissionnaire.
M. Miorcec prête serment.
Desteenne est remplacé comme secrétaire greffier par Etienne-Joseph Labbé qui prête également serment ainsi MM. Guillaume, Villeneufve et Guillaume Corre, notables [Note : Reg. 22. Fol. 97].
L'arrêt de mort des Ursulines était porté depuis bientôt deux ans. Le 14 juin 1790, en effet, le maire de Saint-Pol, MM. Pierre Le Hir, Claude-René Raoul, officier municipal, et Hyacinthe Le Gall de Kerven, procureur de la Commune, s'étaient rendus au couvent des Ursulines vers les 9 heures du matin, pour faire un état et un inventaire du mobilier, des titres et des papiers de la communauté. Le procès-verbal de cet inventaire, dressé dans la salle du Chapitre, fut signé par ces messieurs et par sœur Marie-Catherine de Goazmoal, dite sœur Saint-Pierre, supérieure, par sœur Marie-Anne La Marre, dite sœur Saint-Joseph, sous-prieure, et par sœur Marie-Gabrielle Pirivin, dite Cœur de Jésus, procureuse. Les religieuses auxquelles on avait demandé séparément si elles voulaient profiter des dispositions de l'article 5 du décret sanctionné le 26 mars par Louis XVI, avaient toutes répondu qu'elles désiraient vivre et mourir dans leur communauté.
Le 4 mai 1791, les Ursulines remirent leurs divers titres au sieur Jacques-Laurent Le Lamer, administrateur et membre du Directoire du district de Morlaix, et au sieur Pierre Archambault, commis en chef du bureau des domaines nationaux, du même district, nommés par délibération du 19 avril pour recevoir ces titres et ces papiers.
Le 29 décembre 1791, elles avaient été requises de se constituer une supérieure et une économe, conformément à la loi civile, œuvre des Jansénistes. Les Ursulines s'y refusèrent, ce qu'on leur demandait étant en contradiction flagrante avec leurs statuts approuvés par l'autorité ecclésiastique.
Encore quelques semaines, et la communauté était dissoute. Et en effet, le 9 mars 1792, les Ursulines quittaient leur couvent. Personnel des Ursulines au moment de leur expulsion de l'établissement :
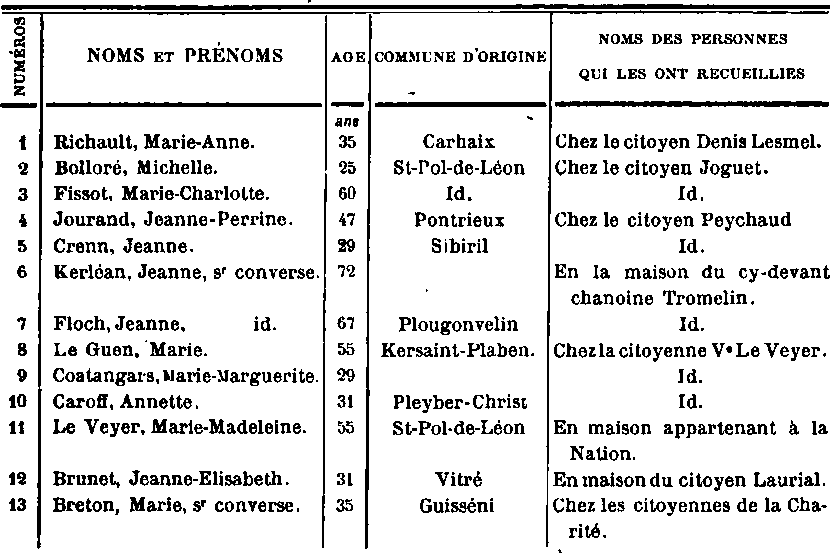
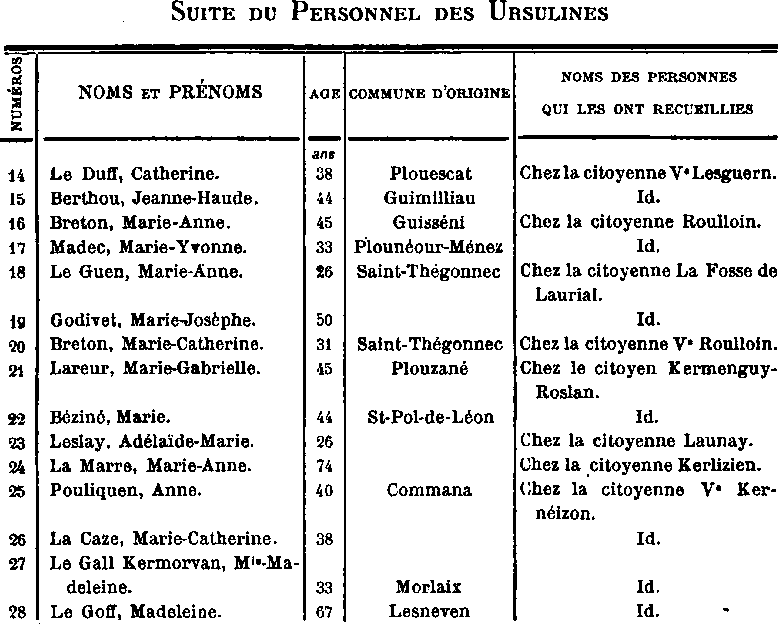
Cette liste, telle qu'elle est donnée par la municipalité de Saint-Pol, est loin d'être exacte. Quand nous avons fait notre travail sur Plougoulm, nous avons eu entre les mains la liste de toutes les religieuses Ursulines, au moment de leur expulsion. Cette liste avait été faite alors et était restée dans les archives de la communauté. Elles étaient au nombre de 37 religieuses de chœur, de 12 sœurs converses, de 2 novices de chœur et d'une postulante converse.
Les Ursulines étaient venues s'établir à Saint-Pol, vers 1629.
Après leur sortie forcée, réduites pour la plupart à une misère extrême, le gouvernement ne leur payant pas la pension qu'il leur avait allouée, elles adressèrent au pouvoir une supplique des plus touchantes, demandant à rentrer dans leur couvent. Autant eût-il valu s'adresser à des rochers. Est-ce que leurs persécuteurs connaissaient ni la pitié ni la justice ? [Note : V. Archives des Ursulines de Saint-Pol, et Reg. 23. Fol. 29, verso].
Une école d'hydrographie avait été établie à Saint-Pol. M. Dreppe y fut nommé professeur le 26 février 1792. C'est dans un concours qui eut lieu à Saint-Pol, le 20 décembre 1791, qu'il avait obtenu son brevet, qu'il ne reçut toutefois que le 17 mars 1792. Il portait la signature de Louis XVI.
Quelques maîtres d'école continuaient à enseigner, sans avoir prêté le serment prescrit aux fonctionnaires. Le 23 mars, la municipalité les fit venir à sa barre, à l'effet de prêter serment.
Le sieur Ménez, l'un des maîtres d'école de la ville, ayant été introduit, fut invité à se conformer au décret de l'Assemblée nationale. Il s'y refusa nettement, déclarant que s'il prêtait ce serment, il perdrait tous ses élèves. Il ajouta qu'à partir de ce jour il fermait son école. Il signa ensuite sur le registre.
Après lui, se présenta Guillaume Sévézen, aussi maître d'école, lequel, sur l'invitation du conseil, prêta le serment requis et signa sur le registre [Note : Reg. 23. Fol. 23-24].
Dans l'Assemblée primaire du 25 mars 1792, MMi Le Hir, Dreppe, Goëz et Trobert, ayant été nommés, le premier procureur de la Commune, les deux autres, officiers municipaux et le dernier notable, furent invités à se rendre à la mairie pour faire le serment civique. Il n'y eut à se présenter à la municipalité que MM. Dreppe et Trobert. M. Le Hir, n'ayant pas paru, le conseil députa vers lui MM. Berdelo et Dreppe, officiers municipaux et Villeneufve, notable. M. Le Hir déclara à ces Messieurs qu'il ne pouvait accepter la charge de procureur de la Commune, occupant déjà d'autres places incompatibles avec celle-là.
Comme le sieur Goëz était absent, on attendit son retour pour lui déférer le serment, ce à quoi il obtempéra sans difficulté [Note : Reg. 22. Fol. 98].
Le 5 avril, l'Intrus Dumay, regrettant sans doute son acte du 26 février, informe par billet la municipalité que celle-ci, n'ayant pas accepté sa démission, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection d'un procureur de la Commune.
« Le conseil lui répond que, ce même jour 26 février, il a écrit sa démission sur le registre, la quelle a été acceptée alors par la municipalité qui lui a voté des remerciements ; que, le 25 mars dernier, il a été procédé à l'élection d'un autre procureur. M. Le Hir, qui avait réuni la majorité des suffrages, ayant refusé, une Assemblée primaire, fixée au 15 courant, pourvoirait à son remplacement.
En conséquence, la municipalité a accepté la démission du sieur Dumay et lui fait connaître qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le chiffon de papier qu'il a fait parvenir au bureau ».
C'est M. Péréault, ancien clerc de procureur, qui fut dans l'Assemblée primaire du 15 avril, nommé procureur de la Commune.
Nous avons vu qu'après les visites domiciliaires, et le désarmement des ci-devant privilégiés, on avait commencé à incarcérer les prêtres insermentés. Monseigneur de La Marche, profondément affligé de la manière cruelle avec laquelle on traitait les prêtres de son diocèse, détenus au château de Brest, adressa à l'administration du Finistère, la lettre suivante qui est un admirable monument de la grandeur d'âme de ce digne évêque. Nous la reproduisons intégralement d'après M. Tresvaux du Fraval, tome 1er, page 346. Histoire de la Persécution révolutionnaire en Bretagne.
Messieurs les Administrateurs,
« C'est au nom de l'humanité que je veux rappeler à votre souvenir une multitude de prisonniers que vous paraissez avoir oublié dans le château de Brest. C'est par vos ordres qu'ils y ont été conduits ; depuis cinq mois ils sont entassés dans une même salle, placés près de deux infirmeries, où sont traitées de malheureuses victimes du libertinage. La corruption de l'air, la rigueur de l'hiver, la qualité des aliments ont porté de terribles atteintes à leur santé. Deux déjà ont succombé, un autre a perdu un œil, environ dix-huit ont été successivement transférés presque mourants à l'hôpital, le reste est languissant. Les chaleurs que nous commençons de sentir et qui vont s'accroître, feront bientôt fermenter la corruption qui les environne, et infailliblement l'infection deviendra mortelle.
Ils ne sont point prévenus d'aucun crime, seulement on les a soupçonnés de pouvoir en commettre ; mais, Messieurs, emprisonner des hommes, parce que vous appréhendiez qu'ils ne se portassent un jour à exciter des troubles, changer ainsi les précautions en châtiment, prévenir les délits par des punitions, infliger des peines à des crimes qui n'ont pas été commis encore ; souffrez que je vous le représente, je vois dans cette conduite l'oubli de l'humanité, de la justice, de la raison, la violation des droits de l'homme, de votre Constitution, de votre nouvel ordre judiciaire, de l'acte même qui constitue les corps administratifs.
Vous avez juré fidélité à la loi, à la nation, au roi.
La Loi ! vous êtes en opposition avec elle. La Nation ! si elle est le plus grand nombre des habitants du royaume, son cri s'élève contre vous. Le Roi ! par l'organe de son ministre, il vous a fait connaître ses intentions qu'il ne m'a pas laissé ignorer.
Qu'attendez- vous donc, Messieurs, pour rendre la liberté à ces innocentes victimes qui ne font entendre aucune plainte contre vous, à ces prêtres respectables que vous avez estimés et que vous estimez encore, si vous avez conservée les principes religieux qu'ils vous ont enseignés, et que conservent inviolablement une multitude de fidèles qui les honorent comme de généreux confesseurs de la foi.
Ne vous semble-t-il pas qu'il est enfin temps de briser leurs chaines ? Ah ! Messieurs, ils en porteront les marques assez longtemps ; jusqu'au tombeau. Quel terme avez-vous fixé à leurs maux ? Sans doute, vous ne les avez pas condamnés à une mort obscure et lente, et à ne sortir des longues agonies de la prison que pour aller expirer sur un lit d'hôpital.
Je ne crains pas de vous assurer que votre intérêt même doit plaider leur cause auprès de vous. Si vous pensez que cette Constitution que vous avez juré de maintenir puisse être consolidée, ne serait-ce pas, après tant de sacrifices, de pertes et de malheurs par le retour de la justice, de la commisération et enfin du repos. Vous jugez bien que la violation des droits, les traitements arbitraires ne pourront la rendre douce ni désirable à qui que ce soit ; je puis même vous attester que les persécutions contre le clergé ont plus que tout le reste éloigné de la révolution française, la nation généreuse où j'ai trouvé un asile.
Enfin, Messieurs, la conscience n'est pas en elle-même, et n'est pas pour vous un vain nom. Croyez-vous qu'elle ne vous reprochera pas un jour vos procédés contre de pauvres ecclésiastiques ? Croyez-vous pouvoir contempler avec la sévérité d'une conscience juste, les humiliations, les amertumes, les maladies, les souffrances sous les quelles vous faites expirer vos semblables ; en vous les exposant, je sens que mon cœur se déchire, le vôtre restera-t-il insensible ?
Il est simple, Messieurs, que je vous paraisse plus coupable que mes fidèles coopérateurs, s'il faut une victime, voici la compensation que je vous prie d'agréer. Dans la dernière lettre pastorale que j'ai adressée, le 20 août, au clergé et au peuple de mon diocèse, je disais à mes prêtres prisonniers que je me verrais volontiers chargé de leurs fers, pourvu qu'à ce prix ils tombassent de leurs mains. Ce désir que je leur témoignais, je le change aujourd'hui en prière. Rendez à tous une liberté entière et inviolable, et je m'engage à traverser ensuite les mers pour aller me remettre volontairement à votre discrétion.
J'ose croire que vous m'estimez du moins assez, pour vous tenir assuré, que, si vous acceptez ma proposition et en remplissez les conditions, je serai fidèle à mon engagement.
Je suis avec respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : + J. F., évêque de Léon,
Londres, 20 avril 1792. — N° 10, Queen Street ».
Cette noble et généreuse démarche n'eut aucun résultat.
(abbé J. Tanguy).
© Copyright - Tous droits réservés.