|
Bienvenue chez les Nouvoitouciens |
NOUVOITOU |
Retour page d'accueil Retour Canton de Châteaugiron
La commune
de Nouvoitou ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de NOUVOITOU
Nouvoitou vient du latin "novestocus", dérivé de "novus stocus" (nouvelle tige).
Lorque Geoffroy de Pouancé, seigneur de la Guerche, donne sa fille Thomase en mariage à André, baron de Vitré, il lui constitue une dot importante ; or, dans cette dot figure, entre autres choses, tout ce que le sire de la Guerche possède dans la paroisse et le bourg de Nouvoitou, « in parrochia et burgo de Novetoul » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 917). Cet acte étant de l'an 1240, il en résulte que la paroisse qui nous occupe existe au XIIIème siècle, mais il est probable qu'elle était ancienne déjà. Vers le même temps, en effet, en 1257, Gaultier, seigneur de Châteaugiron, atteste qu'une partie des dîmes de Nouvoitou avait été donnée par ses prédécesseurs à l'abbesse et au couvent de Saint-Sulpice-des-Bois (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 2 H, 145). A noter qu'en 1778, cette dîme est peu importante, car l'abbesse de Saint-Sulpice ne contribue alors à la portion congrue du recteur de Nouvoitou que pour 24 livres.

C'est durant le XIIIème siècle qu'est vraisemblablement créé l'archidiaconé du Désert. Le nouvel archidiacre reçoit comme fonds principal de son bénéfice la majeure partie des dîmes de Nouvoitou, avec une maison et une terre dans cette paroisse. L'évêque lui accorde aussi le droit de présenter le recteur de Nouvoitou, et l'archidiacre du Désert use de ce privilège jusqu'à la Révolution. A cette dernière époque, le recteur, M. Godard, déclare qu'il jouit du presbytère et de ses deux jardins estimés 400 livres, des dîmes novales lui rapportant 300 livres, et d'une portion congrue qui doit être de 500 livres ; c'est donc un revenu total d'environ 900 livres (Pouillé de Rennes).
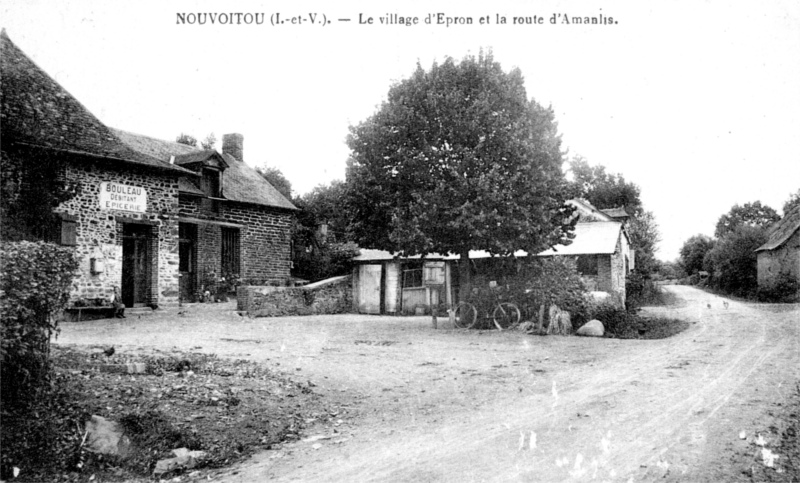
Cette portion congrue est payée par l'archidiacre du Désert, grand décimateur ; mais quelques petites dîmes appartiennent aussi à l'ancien hôpital de Saint-Thomas de Rennes et sont alors levées par le collège de cette ville. Enfin, les Cordeliers de Rennes possèdent la ferme des Tremblais, qu'ils afferment alors 180 livres, et dont la maison est devenue de nos jours le presbytère actuel de Nouvoitou

La maison seigneuriale de la paroisse de Nouvoitou, La Motte, possède un droit de haute justice et relève de la seigneurie de Bourgbarré. Elle appartient en 1388 aux seigneurs du même nom puis passe entre les mains des seigneurs de la Motte Saint-Armel qui l'unissent à leur vicomté en 1642. Elle devient ensuite la propriété de la famille la Monneraye, puis de la famille Feudé au XVIIIème siècle. Les Ligueurs pillent Nouvoitou le 24 juillet 1589.
On rencontre les appellations suivantes : parochia de Novetoul (en 1240), ecclesia de Novo Statu (en 1257), Nouvoistou (en 1565).
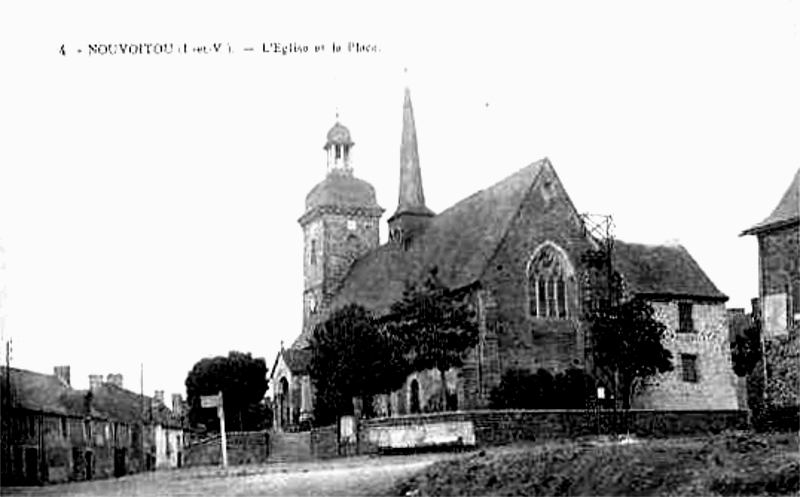
Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Nouvoitou : Pierre Hervault (décédé en 1602), Pierre Bourdon (en 1602), Noël Geffray (en 1602), François Le Barbier (1621-1624), Pierre Bellouin (en 1624), Julien Grivel (1660-1690), Jean Rallier (1690-1723), René Cocqueu (1723-1748), Guillaume Orain (1748-1772), François Turmel (1772-1775), Michel-François Godard (1775-1789), François-Marie Barbedette (1803-1805), François-Julien Bébin (1805-1815), Thomas Mahé (1815-1871), Thomas Mahé (à partir de 1871), ....
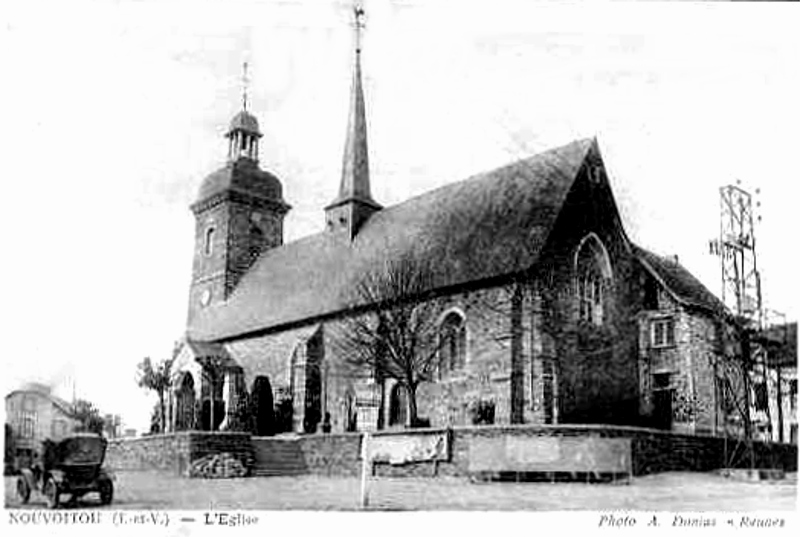
Voir
![]() "
Le
cahier de doléances de Nouvoitou en 1789
".
"
Le
cahier de doléances de Nouvoitou en 1789
".
![]()
PATRIMOINE de NOUVOITOU
![]() l'église
Saint-Martin (XV-XVI-XVII-XIXème siècle). L'église est mentionnée pour
la première fois en 1426. Dédiée à saint Martin de Tours, l'église de
Nouvoitou se compose d'une nef à chevet droit avec fenêtres flamboyantes ;
un seul collatéral existe au Nord, séparé d'elle par des arcades en plein
cintre. Une inscription gothique, gravée sur une pierre d'ardoise encastrée
dans le mur septentrional du sanctuaire, fait connaître la date de la
construction de cet édifice : Mil quatre cens quatre-vingt-six, - Pour
le proufilt des mors et vifs, - Fut refaict tout de nouveau - L'édifice
de cest chanceau ; - Lors thésauriers estoint pour voir - Gillet Maulgendre
et Jehan Maulnoir. Quant au collatéral, il ressemble beaucoup à ceux
de SaintArmel et doit être contemporain de cette dernière église, bâtie
au XVIIème siècle par les Loaisel, seigneurs de Chambière et de Nouvoitou.
On attribue aussi à leurs successeurs la construction de la tour ajoutée
au siècle dernier au bas de la nef. La maison seigneuriale de la paroisse
était, en effet, la Motte de Nouvoitou ; son possesseur — dans les
derniers siècles le seigneur de Chambière, en Saint-Armel, marquis de Brie
— jouissait en l'église de Nouvoitou des droits de supériorité et de
fondation ; il y avait un enfeu, un banc et une lisière ornée de ses
armoiries (Déclaration de 1680 - Archives nationales P. 1712). Le seigneur
de la Motte de Nouvoitou avait fondé antérieurement au XVIIème siècle
une chapellenie de trois messes par semaine dans la cathédrale de Rennes;
c'est ce qu'on appelait la chapellenie de Saint-Nicolas ; elle était fondée
de quelques dîmes en Nouvoitou. En 1634, Isaac Loaisel, seigneur de Brie,
la Motte et Chambière, avait également fait une fondation en faveur des
enfants pauvres de Nouvoitou, appelée chapellenie de Chambière ou des
choristes. On voyait jadis dans l'église de Nouvoitou les autels du Rosaire
et de Saint-Roch. Vers 1691, Julien Micault et Jean Sottin, sieur de Mousigné,
firent une fondation en faveur du Rosaire, dont la confrérie fut érigée
au premier de ces autels, le 15 août 1693, par le P. Chéreil, dominicain
de Bonne-Nouvelle (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45 ; 1
H, 5). Quant à l'autel Saint-Roch, appelé autel du Milieu, il se trouvait
adossé à l'une des colonnes séparant les nefs. L'autel actuel de
Notre-Dame, placé au haut du collatéral, possède plusieurs bas-reliefs
fort curieux qui sont les débris d'un retable de la fin du XVème siècle
dont on ne saurait trop déplorer la perte. « Ces bas-reliefs sont en
albâtre peint et doré dans différentes parties. Le sujet qui décore la
porte du tabernacle représente Dieu le Père portant la tiare et le nimbe,
et vêtu d'une tunique et d'une large draperie qui pend sur les genoux ;
d'une main il tient le globe surmonté de la croix, de l'autre il bénit à
la manière grecque ; entre ses genoux il tient son Fils en croix, et sur sa
poitrine est fixée une colombe figurant le Saint-Esprit, troisième
personne de la Sainte-Trinité, ainsi représentée. Six anges les
environnent : deux agitent des encensoirs près de la tête du Père ; deux,
sur la tête desquels il appuie ses pieds, reçoivent dans un calice d'or le
sang qui coule des pieds du crucifix, et les deux autres celui qui s'échappe
des mains. Le bas-relief qui fait le côté droit du tabernacle représente
le mystère de l'Annonciation, le Père soufflant son Verbe dans l'oreille
de la Vierge ; du côté de l'épître, l'Adoration des Mages ; plus loin,
sur le retour, est sainte Barbe près de la tour et un autre petit saint. Au
côté gauche du tabernacle on voit encore la Trinité sous la forme de
trois personnes assises l'une auprès de l'autre ; aux pieds du Père Eternel
est la Vierge, également assise devant lui et recevant de ses mains une
triple couronne ; deux petits anges sont en adoration plus bas, et au sommet
est un dais composé de pinacles et d'aiguilles comme au-dessus de tous les
autres bas-reliefs. Le suivant, qui répond à l'Adoration des Mages, figure
encore la glorification de la Vierge : elle est debout, environnée de l'auréole
en amande, et porte une couronne d'or ; au-dessus d'elle apparaît Dieu le Père,
comme sur le premier sujet, et six anges, dont deux jouent de la harpe et de
la cithare, tandis que les quatre autres soutiennent l'auréole lumineuse
qui environne la Vierge ; à ses pieds, un saint personnage agenouillé lui
fait hommage d'une espèce de ceinture, symbole de sa chasteté. Sur le
retour du retable, un peu à gauche, sont le Bon-Pasteur et saint Laurent »
(abbé Brune, Archéologie religieuse, 414, 415). En sortant de l'église de
Nouvoitou, remarquons une pierre tumulaire adossée à la muraille du chevet
; elle offre l'effigie d'une dame reposant sous une arcade trilobée, la tête
appuyée sur un coussin que tiennent deux petits anges ; on appelle cette
pierre la tombe de la baronne et on prétend qu'elle recouvrait les restes
d'une dame de Vauxelle (Pouillé de Rennes). La nef et le chœur datent du XVème siècle. La
chapelle de la Vierge date de 1549. La sacristie date du XVIIème siècle.
La tour-clocher date de 1675. Le bas-côté est refait en 1834. Le porche
sud date du XVIIème siècle. Le cadran solaire date de 1609. Le gisant date
du XIVème siècle. Le panneau du retable date du XVème siècle. Le retable
du maître-autel date du XVII-XIXème siècle. Le confessionnal date de 1835.
Le Christ en Croix date du XVIème siècle. Le vitrail de Saint Pierre et
Saint Jean, oeuvre du maître-verrier Denis, date de 1879 (don de la famille
Poirier). La statue de Sainte Anne et la Vierge, date du XVIIème siècle. Les statues de saint
Pierre et saint Martin, oeuvre du sculpteur Martin Morillon, datent de 1703 ;
l'église
Saint-Martin (XV-XVI-XVII-XIXème siècle). L'église est mentionnée pour
la première fois en 1426. Dédiée à saint Martin de Tours, l'église de
Nouvoitou se compose d'une nef à chevet droit avec fenêtres flamboyantes ;
un seul collatéral existe au Nord, séparé d'elle par des arcades en plein
cintre. Une inscription gothique, gravée sur une pierre d'ardoise encastrée
dans le mur septentrional du sanctuaire, fait connaître la date de la
construction de cet édifice : Mil quatre cens quatre-vingt-six, - Pour
le proufilt des mors et vifs, - Fut refaict tout de nouveau - L'édifice
de cest chanceau ; - Lors thésauriers estoint pour voir - Gillet Maulgendre
et Jehan Maulnoir. Quant au collatéral, il ressemble beaucoup à ceux
de SaintArmel et doit être contemporain de cette dernière église, bâtie
au XVIIème siècle par les Loaisel, seigneurs de Chambière et de Nouvoitou.
On attribue aussi à leurs successeurs la construction de la tour ajoutée
au siècle dernier au bas de la nef. La maison seigneuriale de la paroisse
était, en effet, la Motte de Nouvoitou ; son possesseur — dans les
derniers siècles le seigneur de Chambière, en Saint-Armel, marquis de Brie
— jouissait en l'église de Nouvoitou des droits de supériorité et de
fondation ; il y avait un enfeu, un banc et une lisière ornée de ses
armoiries (Déclaration de 1680 - Archives nationales P. 1712). Le seigneur
de la Motte de Nouvoitou avait fondé antérieurement au XVIIème siècle
une chapellenie de trois messes par semaine dans la cathédrale de Rennes;
c'est ce qu'on appelait la chapellenie de Saint-Nicolas ; elle était fondée
de quelques dîmes en Nouvoitou. En 1634, Isaac Loaisel, seigneur de Brie,
la Motte et Chambière, avait également fait une fondation en faveur des
enfants pauvres de Nouvoitou, appelée chapellenie de Chambière ou des
choristes. On voyait jadis dans l'église de Nouvoitou les autels du Rosaire
et de Saint-Roch. Vers 1691, Julien Micault et Jean Sottin, sieur de Mousigné,
firent une fondation en faveur du Rosaire, dont la confrérie fut érigée
au premier de ces autels, le 15 août 1693, par le P. Chéreil, dominicain
de Bonne-Nouvelle (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45 ; 1
H, 5). Quant à l'autel Saint-Roch, appelé autel du Milieu, il se trouvait
adossé à l'une des colonnes séparant les nefs. L'autel actuel de
Notre-Dame, placé au haut du collatéral, possède plusieurs bas-reliefs
fort curieux qui sont les débris d'un retable de la fin du XVème siècle
dont on ne saurait trop déplorer la perte. « Ces bas-reliefs sont en
albâtre peint et doré dans différentes parties. Le sujet qui décore la
porte du tabernacle représente Dieu le Père portant la tiare et le nimbe,
et vêtu d'une tunique et d'une large draperie qui pend sur les genoux ;
d'une main il tient le globe surmonté de la croix, de l'autre il bénit à
la manière grecque ; entre ses genoux il tient son Fils en croix, et sur sa
poitrine est fixée une colombe figurant le Saint-Esprit, troisième
personne de la Sainte-Trinité, ainsi représentée. Six anges les
environnent : deux agitent des encensoirs près de la tête du Père ; deux,
sur la tête desquels il appuie ses pieds, reçoivent dans un calice d'or le
sang qui coule des pieds du crucifix, et les deux autres celui qui s'échappe
des mains. Le bas-relief qui fait le côté droit du tabernacle représente
le mystère de l'Annonciation, le Père soufflant son Verbe dans l'oreille
de la Vierge ; du côté de l'épître, l'Adoration des Mages ; plus loin,
sur le retour, est sainte Barbe près de la tour et un autre petit saint. Au
côté gauche du tabernacle on voit encore la Trinité sous la forme de
trois personnes assises l'une auprès de l'autre ; aux pieds du Père Eternel
est la Vierge, également assise devant lui et recevant de ses mains une
triple couronne ; deux petits anges sont en adoration plus bas, et au sommet
est un dais composé de pinacles et d'aiguilles comme au-dessus de tous les
autres bas-reliefs. Le suivant, qui répond à l'Adoration des Mages, figure
encore la glorification de la Vierge : elle est debout, environnée de l'auréole
en amande, et porte une couronne d'or ; au-dessus d'elle apparaît Dieu le Père,
comme sur le premier sujet, et six anges, dont deux jouent de la harpe et de
la cithare, tandis que les quatre autres soutiennent l'auréole lumineuse
qui environne la Vierge ; à ses pieds, un saint personnage agenouillé lui
fait hommage d'une espèce de ceinture, symbole de sa chasteté. Sur le
retour du retable, un peu à gauche, sont le Bon-Pasteur et saint Laurent »
(abbé Brune, Archéologie religieuse, 414, 415). En sortant de l'église de
Nouvoitou, remarquons une pierre tumulaire adossée à la muraille du chevet
; elle offre l'effigie d'une dame reposant sous une arcade trilobée, la tête
appuyée sur un coussin que tiennent deux petits anges ; on appelle cette
pierre la tombe de la baronne et on prétend qu'elle recouvrait les restes
d'une dame de Vauxelle (Pouillé de Rennes). La nef et le chœur datent du XVème siècle. La
chapelle de la Vierge date de 1549. La sacristie date du XVIIème siècle.
La tour-clocher date de 1675. Le bas-côté est refait en 1834. Le porche
sud date du XVIIème siècle. Le cadran solaire date de 1609. Le gisant date
du XIVème siècle. Le panneau du retable date du XVème siècle. Le retable
du maître-autel date du XVII-XIXème siècle. Le confessionnal date de 1835.
Le Christ en Croix date du XVIème siècle. Le vitrail de Saint Pierre et
Saint Jean, oeuvre du maître-verrier Denis, date de 1879 (don de la famille
Poirier). La statue de Sainte Anne et la Vierge, date du XVIIème siècle. Les statues de saint
Pierre et saint Martin, oeuvre du sculpteur Martin Morillon, datent de 1703 ;
Nota : La lumière diffuse du matin met en valeur dans l'église de Nouvoitou les couleurs et les ors du choeur et de l'autel restaurés par M. l'abbé Juhel, recteur. Notre guide nous conduit à la pièce principale : le magnifique rétable d'albâtre. Il nous fait admirer toutes les beautés naïves de ses sculptures. Ce rétable provient d'Angleterre contrairement à ce qui arrivait en France, pendant les guerres de Religion, les Anglais, au moment de la Réforme, ne détruisaient pas les objets d'art mais les négociaient, et, c'est grâce à cette vertu des Anglais, commerçants avant tout, que nous devons posséder cette belle pièce d'art classée comme monument historique. Le tabernacle représente la Sainte Trinité Dieu le Père couronné de la tiare, nimbé, vêtu d'une tunique, tient le globe surmonté de la croix et bénit à la manière grecque. Sur ses genoux, il soutient le Fils en croix ; le Saint-Esprit a disparu, il était fixé tout à fait en saillie sur la poitrine de Dieu le Père. L'emplacement du petit goujon de fixation existe encore. Tout autour sont rangés, six anges avec encensoirs et quatre recueillant dans un calice le sang des mains et des pieds du Christ. Les panneaux qui accompagnent la pièce centrale représentent l'Annonciation : l'ange Gabriel y est dominé par le Saint-Esprit représenté sous la forme humaine soufflant le Verbe dans l'oreille de la Vierge ; l'Adoration des Mages : la Vierge est étendue sur un lit de repos. Les trois mages couronnés présentent leurs dons : l'encens, la myrrhe et l'or, mais il y a au pied un quatrième roi, celui-ci à genoux offre sa couronne à l'Enfant-Jésus. Ne serait-ce pas un royal donateur ? le Couronnement de la Vierge : le Père Eternel tout au haut. Le Fils et le Saint-Esprit, celui-ci (encore figuré sous la forme humaine) soutiennent la couronne de la Vierge, le tout est surmonté d'un dais ajouré ; la Glorification de la Sainte Vierge : la reine du ciel y est auréolée en amande. Dieu le Père au-dessus. Six anges adorateurs dont deux jouent de la harpe et de la cithare. A ses pieds un personnage agenouillé habillé en religieux fait don de sa ceinture « symbole de chasteté ». Peut-être figure-t-il le donateur ? Deux panneaux à un seul personnage de plus grande taille : saint Jean le précurseur, souvent pris là pour le Bon Pasteur. Les deux caractéristiques : l'agneau et la peau de bête, dont cette statue est revêtue ne permettant pas, croyons-nous, de douter de la représentation de saint Jean. De l'autre côté, y faisant pendant, saint Jean l'Evangéliste avec le calice. Deux plus petits personnages, remplissant de petites niches, saint Laurent et un autre petit Saint que l'on a pu identifier. Cette pièce unique surmontait un autel qui fut détruit il y a un an (vers 1929) il vient d'être placé dans le collatéral Nord. Il est dans un très beau cadre de style gothique d'une ligne très correcte. Il est bien placé pour y être admiré de près. Avant l'examen du rétable, M. l'abbé Raison nous parle de l'histoire de la paroisse de Nouvoitou qui, en 1240 était Novetoul ; en 1257, Novo statu en 1565, Nouvoistou. En 1240, Geoffroy de Pouancé, seigneur de La Guerche, mariait sa fille Thomase à André de Vitré. Il fait figurer dans sa dot tout ce qu'il possède dans la paroisse et le bourg de Nouvoitou. Cette église dédiée à saint Martin est composée d'une nef à chevet droit avec fenêtres flamboyantes, au collatéral nord avec arcades en plein cintre. Le chevet est contemporain de celui de Saint-Armel bâti par Le Loisel, seigneur de Nouvoitou. M. l'abbé Raison nous signale l'inscription sur ardoise relative à la construction du choeur : Mil quatre cent quatre vingt six - Pour le profilt des mors et des vifs, - Fut refaict tout de nouveau - L'édifice de cet chanceau. - Les Thésouriers estoient pour voir - Gillet Maulgendre et Jean Maulnoir. En quittant cette charmante église, on remarque dans l'ancien cimetière une pierre tombale adossée au chevet. C'est la tombe de la Baronne, un gisant en bas-relief assez dégradé qui représente peut-être une dame de Vauxelles (E. Evellin, 1930).

![]() la
chapelle (vers 1654) du manoir situé au lieu-dit Le Grand-Corcé. Le manoir
du Grand-Corcé possédait une chapelle privative dès 1513 qui a été
reconstruite au milieu du XVIIème siècle. En effet, Catherine de Corcé,
femme d'Arthur de la Magnanne, possédait en 1513 le manoir de Corcé, décoré
d'une chapelle. Mais plus tard les seigneurs de Corcé, devenus protestants,
laissèrent tomber ce sanctuaire en ruine. C'est pourquoi, vers 1654, Jean
Pellicot, sieur du Chesne et de Corcé, avocat au Parlement, et Perrine Bréal,
sa femme, construisirent une nouvelle chapelle à Corcé et la dotèrent de
75 livres de rente par acte du 22 février 1655, y fondant une messe pour
tous les dimanches et fêtes chômées. N... des Loges en fut chapelain et
eut en 1739 pour successeur Pierre Bigot ; mais en 1765 la chapelle n'était
plus desservie, ce dont se plaignit à l'évêque le recteur de Nouvoitou.
Restaurée au XIXème siècle par la famille Ramé, propriétaire de Corcé,
cette chapelle est entretenue et sert de station aux processions de la
paroisse (Pouillé de Rennes). Propriété successive des
familles Corcé (en 1381), Maignane (au XVIème siècle), Mellet, seigneurs
du Verger (en 1629), Chauvel, sieurs de la Boulaye (en 1653), Pellicot,
sieurs du Chesne (en 1655), Guyet, sieurs du Teil (vers 1691), Primaignier
(en 1718), Touzé, sieurs de la Sentière (en 1779), Ramé ;
la
chapelle (vers 1654) du manoir situé au lieu-dit Le Grand-Corcé. Le manoir
du Grand-Corcé possédait une chapelle privative dès 1513 qui a été
reconstruite au milieu du XVIIème siècle. En effet, Catherine de Corcé,
femme d'Arthur de la Magnanne, possédait en 1513 le manoir de Corcé, décoré
d'une chapelle. Mais plus tard les seigneurs de Corcé, devenus protestants,
laissèrent tomber ce sanctuaire en ruine. C'est pourquoi, vers 1654, Jean
Pellicot, sieur du Chesne et de Corcé, avocat au Parlement, et Perrine Bréal,
sa femme, construisirent une nouvelle chapelle à Corcé et la dotèrent de
75 livres de rente par acte du 22 février 1655, y fondant une messe pour
tous les dimanches et fêtes chômées. N... des Loges en fut chapelain et
eut en 1739 pour successeur Pierre Bigot ; mais en 1765 la chapelle n'était
plus desservie, ce dont se plaignit à l'évêque le recteur de Nouvoitou.
Restaurée au XIXème siècle par la famille Ramé, propriétaire de Corcé,
cette chapelle est entretenue et sert de station aux processions de la
paroisse (Pouillé de Rennes). Propriété successive des
familles Corcé (en 1381), Maignane (au XVIème siècle), Mellet, seigneurs
du Verger (en 1629), Chauvel, sieurs de la Boulaye (en 1653), Pellicot,
sieurs du Chesne (en 1655), Guyet, sieurs du Teil (vers 1691), Primaignier
(en 1718), Touzé, sieurs de la Sentière (en 1779), Ramé ;
![]() la
croix (1865) de la Grande-Corcé ;
la
croix (1865) de la Grande-Corcé ;
![]() la
croix de l'église (vers 1600) ;
la
croix de l'église (vers 1600) ;
![]() la
maison (XVI-XXème siècle), située à La Rivière-aux-Veillaux ;
la
maison (XVI-XXème siècle), située à La Rivière-aux-Veillaux ;
![]() le
château de la Porte (XIXème siècle). Le manoir de la Porte appartenait en
1758 à la famille Borel, sieurs de Boutemont, puis à la famille Hardouin ;
le
château de la Porte (XIXème siècle). Le manoir de la Porte appartenait en
1758 à la famille Borel, sieurs de Boutemont, puis à la famille Hardouin ;

![]() le moulin
de Tertron ou Epron (XVIème siècle-1776-1859-1982) et les moulins à eau d’Ernoux et de la Motte ;
le moulin
de Tertron ou Epron (XVIème siècle-1776-1859-1982) et les moulins à eau d’Ernoux et de la Motte ;
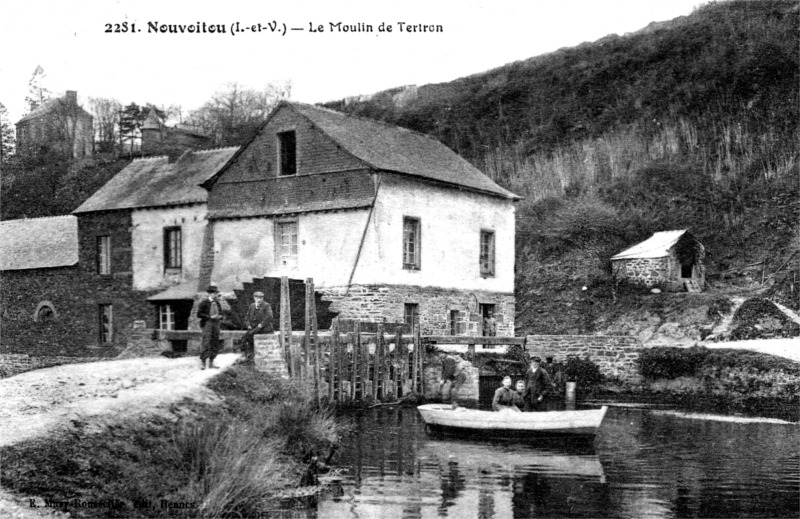
A signaler aussi :
![]() les
vestiges gallo-romains : la villa de Villeneuve, le relais à la Houssaie et
les fermes à Crotigné et au Grand-Beauvais ;
les
vestiges gallo-romains : la villa de Villeneuve, le relais à la Houssaie et
les fermes à Crotigné et au Grand-Beauvais ;
![]() l'oratoire
Saint-Martin (XXème siècle) ;
l'oratoire
Saint-Martin (XXème siècle) ;
![]() l'ancien
manoir de la Motte. Il avait un droit de haute justice. Propriété
successive des familles la Motte (en 1388), la Lande (en 1471),
Tiercent (en 1513), la Monneraye (en 1708), Feudé (en 1787). La Motte
relevait de la seigneurie de Bourgbarré. Elle est unie en 1642 à la
vicomté de la Motte Saint-Armel, en Saint-Armel ;
l'ancien
manoir de la Motte. Il avait un droit de haute justice. Propriété
successive des familles la Motte (en 1388), la Lande (en 1471),
Tiercent (en 1513), la Monneraye (en 1708), Feudé (en 1787). La Motte
relevait de la seigneurie de Bourgbarré. Elle est unie en 1642 à la
vicomté de la Motte Saint-Armel, en Saint-Armel ;
![]() l'ancien
manoir des archidiacres du Désert ;
l'ancien
manoir des archidiacres du Désert ;
![]() l'ancien
prieuré bénédictin, vendu au milieu du XIVème siècle ;
l'ancien
prieuré bénédictin, vendu au milieu du XIVème siècle ;
![]() l'ancien
manoir de Vauxelles. Il était au baron de Châteaugiron en 1453 et en 1600 ;
l'ancien
manoir de Vauxelles. Il était au baron de Châteaugiron en 1453 et en 1600 ;
![]() l'ancien
manoir de Venecelles. Il avait autrefois une chapelle. Propriété
successive des familles Feillée (en 1453), Lorgeril (en 1495), comtesse de
Maure (en 1582 et 1629), Lopriac (en 1648), Aiguillon (en 1662) ;
l'ancien
manoir de Venecelles. Il avait autrefois une chapelle. Propriété
successive des familles Feillée (en 1453), Lorgeril (en 1495), comtesse de
Maure (en 1582 et 1629), Lopriac (en 1648), Aiguillon (en 1662) ;
![]() l'ancienne
chapelle de Malmousse, aujourd'hui disparue. La chapelle de Malemousse est
signalée dans le Rôle diocésain ms. de 1646, ce qui prouve qu'elle était alors fondée de messes ;
l'ancienne
chapelle de Malmousse, aujourd'hui disparue. La chapelle de Malemousse est
signalée dans le Rôle diocésain ms. de 1646, ce qui prouve qu'elle était alors fondée de messes ;
![]() l'ancien
manoir de l'Eclosel. Propriété successive des familles Kéradreux (en
1552), le Provost (en 1598), Poisson, seigneurs de la Meslée (en 1603),
Malescot des Hayes (en 1623), Pépin de Martigné (en 1748), le Prestre,
marquis de Châteaugiron (en 1784), Fournel ;
l'ancien
manoir de l'Eclosel. Propriété successive des familles Kéradreux (en
1552), le Provost (en 1598), Poisson, seigneurs de la Meslée (en 1603),
Malescot des Hayes (en 1623), Pépin de Martigné (en 1748), le Prestre,
marquis de Châteaugiron (en 1784), Fournel ;
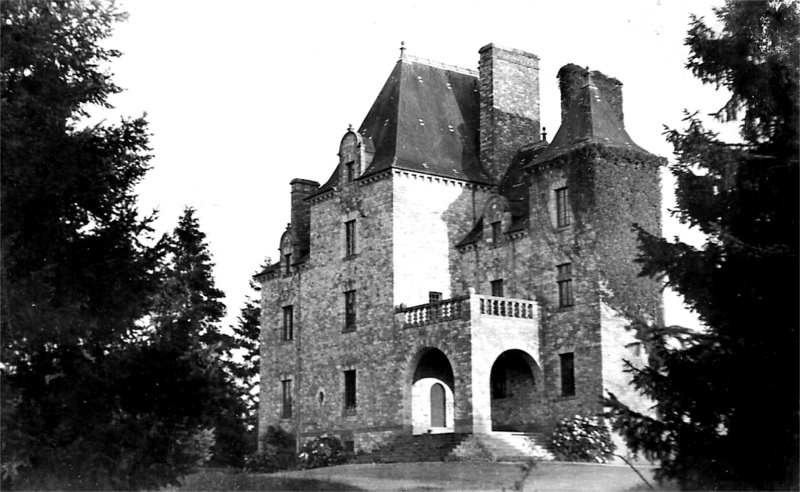
![]() l'ancien
manoir du Petit-Corcé. Il était à la famille Mellet en 1513 ;
l'ancien
manoir du Petit-Corcé. Il était à la famille Mellet en 1513 ;
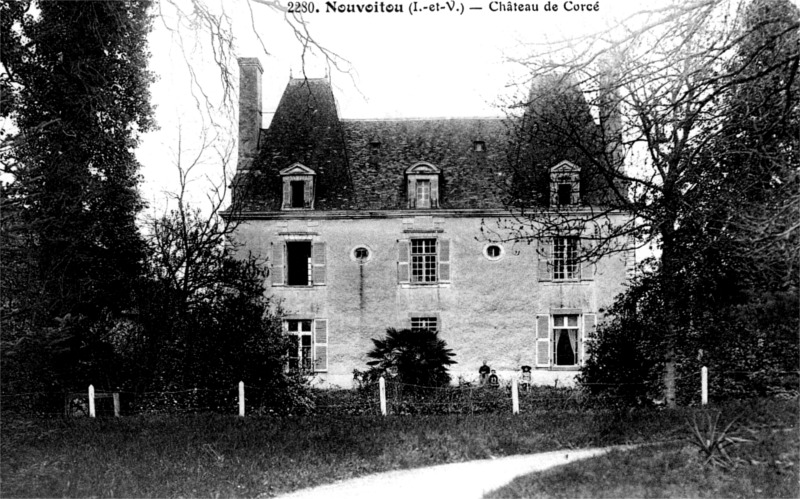
![]() l'ancien
manoir de la Rivaudière. Propriété successive des familles le Moyne (en
1513), Chastellier (en 1541), Poisson (en 1603 et 1626), Louvel, sieurs de la Chauvelière (en 1649 et 1680) ;
l'ancien
manoir de la Rivaudière. Propriété successive des familles le Moyne (en
1513), Chastellier (en 1541), Poisson (en 1603 et 1626), Louvel, sieurs de la Chauvelière (en 1649 et 1680) ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de NOUVOITOU
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.