|
Bienvenue ! |
LE MONT-SAINT-MICHEL SOUS LES DUCS DE NORMANDIE (966-1204) |
Retour page d'accueil Retour "Histoire du Mont-Saint-Michel"
Le Mont-Saint-Michel sous les ducs de Normandie, 966-1204
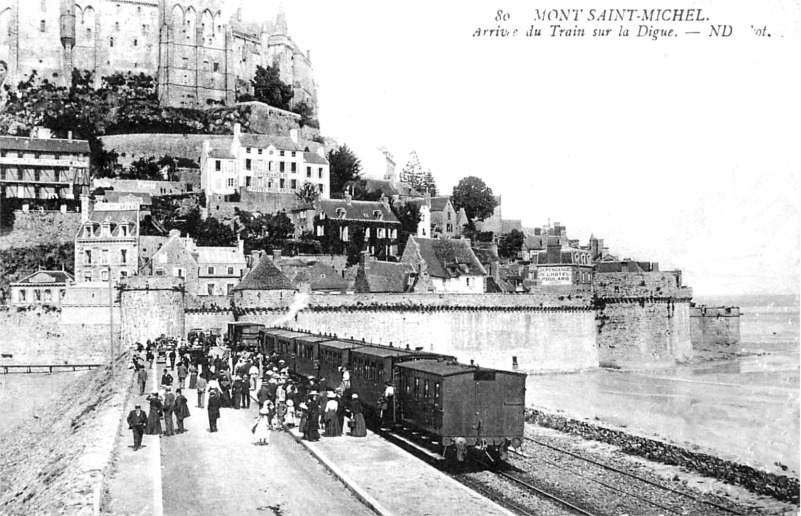
Le petit-fils de Rollon, le duc de Normandie Richard Ier Sans Peur, prit en 965 la décision capitale : il renvoya les premiers chanoines chargés du culte au Mont-Saint-Michel depuis 709, et les remplaça par douze bénédictins appelés de Saint-Wandrille sous la conduite d'un Flamand, l'Abbé Mainard. Cette venue, approuvée par le Pape et par le roi de France Lothaire, allait faire du Mont-Saint-Michel l'un des plus illustres monastères d'Occident — la petite église Notre-Dame-sous-Terre en est l'embryon. Ce n'est que peu à peu qu'il allait atteindre la plénitude de son rayonnement spirituel, intellectuel et artistique.
Un tel essor est dû à la fois à la puissante personnalité de quelques-uns de ses Abbés et au mécénat, parfois autoritaire, des ducs de Normandie, qui firent du Mont un élément clé de leur politique pendant deux siècles et demi. En effet, les « temps forts » de l'histoire du Mont sont tous marqués par la conjonction d'un grand souverain et d'un grand homme d'Eglise.
Après l'an mille, le duc très cosmopolite, Richard II, seconde les vues d'un organisateur génial, le bénédictin Guillaume de Volpiano. Ce moine lombard étend la réforme de Cluny à Fécamp (1001), puis à toute la Normandie. C'est le début, en 1023, de la construction de l'église abbatiale du Mont-Saint-Michel, longue de 70 mètres au haut du rocher, chef-d'œuvre de l'art roman. Toute une colonie d'Italiens, venue dans le sillage de Volpiano, Jean de Ravenne, Suppo, Anastase, Lanfranc, saint Anselme, font du Mont et de l'école d'Avranches, au milieu du XIème s., un lieu de rencontre international. De là, l'esprit clunisien allait se propager en Grande-Bretagne.
A la conquête de l'Angleterre (1066), entreprise sous le signe de la Chanson de Roland et de saint Michel, le duc Guillaume associe les abbayes normandes qui vont fournir les cadres du nouvel Etat, unifier ses structures politiques et cristalliser l'expansion outre-Manche. Le Mont-Saint-Michel y participe avec gloire, comme l'Abbaye du Bec-Hellouin.
La première moitié du XIIème s. correspond à un « temps faible », marqué par des dissensions et des troubles de tous genres — le Mont est assiégé deux fois en 1038 et 1091. Mais la seconde moitié du siècle voit le duc-roi, Henri II Plantagenêt, s'affirmer le souverain le plus puissant de l'Occident, après son mariage avec Aliénor d'Aquitaine. Il prend comme conseiller personnel l'Abbé du Mont-Saint-Michel qui vient de succéder à Bernard du Bec, dit le Vénérable (1131-1149) : c'est Robert de Torigni (1154-1186), homme de grande envergure, formé également à l'Abbaye du Bec-Hellouin, historien, administrateur, bâtisseur, diplomate, qui donne le ton à son époque. Le monastère, grâce à lui, s'impose comme un foyer exceptionnel de foi et de culture. Les créations architecturales vont de pair avec les productions du « scriptorium ». Les plus beaux manuscrits nés sous ses voûtes font la renommée de l'Abbaye appelée la Cité des Livres, qu'entoure la considération des princes et des foules (F. E.).
© Copyright - Tous droits réservés.