|
Bienvenue ! |
LES PREMIERS ABBÉS COMMENDATAIRES (1524-1622) |
Retour page d'accueil Retour "Histoire du Mont-Saint-Michel"
Les premiers abbés commendataires, 1524-1622.
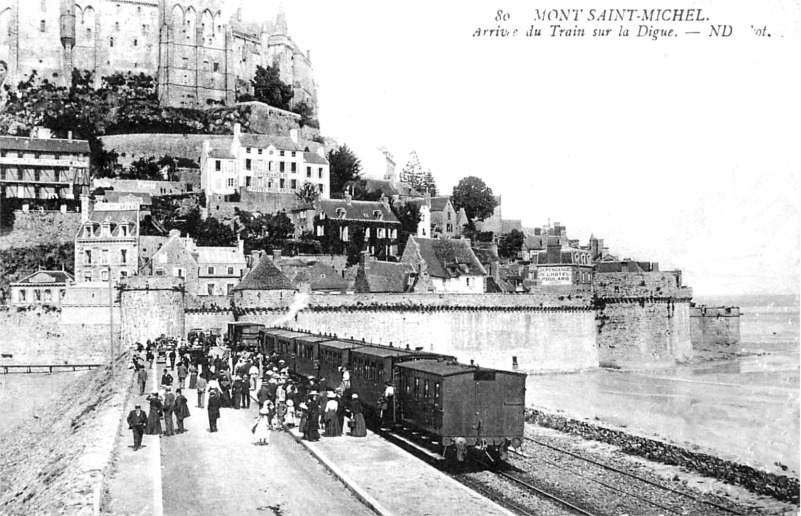
Période des dernières splendeurs et des premières faiblesses, la fin du Moyen Age est à la charnière de deux mondes. Elle croit, avec la Renaissance, faire un retour aux sources de l'humanisme antique. Les monastères n'y gagnent que les abus de l'institution de la commende et subissent les troubles des guerres religieuses de la seconde moitié du XVIème s.
Renaissance ou déclin ? Le Concordat de 1516, exposé ici, signé entre le roi François Ier et le pape Léon X, a institué le fâcheux système de la commende. Les abbés ne seront plus désormais élus par la communauté des moines, mais désignés d'autorité par le roi. Le monastère perd son caractère religieux pour être considéré comme un bénéfice, une charge honorifique, assortie de revenus appréciables, pour les titulaires, favoris de cour, religieux ou laïques, enfants parfois. « Car tel est notre plaisir... ».
La volonté du souverain nomme au Mont un évêque de Lisieux, grand aumônier de France, Jean Le Veneur. Rendons-lui une justice : ce premier abbé commendataire aura une initiative heureuse. En 1532, il provoque la rencontre au prieuré montois de Brion, de François Ier et du navigateur malouin Jacques Cartier. Là, se décide l'expédition du Canada. L'Abbaye du Mont participe même financièrement à l'armement des navires. Après avoir concouru à la conquête de l'Angleterre, en 1066, elle s'inscrivait à la tête de l'aventure qui, près de cinq siècles plus tard, allait aboutir à la découverte du Canada.
Le dernier souverain venu au Mont sera, en 1561, Charles IX, accompagné de son frère Henri III. Aucun roi, désormais, ne fera plus le pèlerinage sur les pas de Louis VII, Louis IX, Philippe le Bel, Louis XI, Francois Ier. Une tradition monarchique s'éteint. Les heures de gloire sont passées. La désaffection des princes s'aggrave de la médiocrité des personnages qu'ils placent à la tête de l'Abbaye.
L'approche des guerres de religion fait naître de nouveaux dangers. L'Abbaye catholique a gardé sa valeur stratégique d'antan. Elle riposte aux tentatives de coups de main des Réformés. Leur chef n'est autre que Gabriel de Montgomery, celui-là même qui, à Paris, en 1559, a blessé mortellement en tournoi Henri II sous les yeux de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis. Poursuivi par la haine de la reine, il s'est réfugié à Ducey et à Pontorson. Après son exécution, en 1574, Place de Grève, à Paris, ses fils reprennent la lutte contre l'Abbaye. Déguisements, stratagèmes, ruses de toutes sortes, sont employés pour en venir à bout. En vain. Les années 1577-1589-1591-1595 marquent les quatre principaux drames. Une dernière tragédie entre ligueurs, cette fois, montre la confusion des esprits et la gravité de ces luttes fratricides. Le marquis de Belle-Isle y trouve la mort en 1596, dans cette salle des Gardes de l'Abbaye, déjà trop ensanglantée.
Les tristesses des guerres civiles s'ajoutent aux désordres et aux abus de la commende. Ruines matérielles, ruines morales. Malgré la pacification tentée par Henri IV, la crise monastique est trop évidente. Elle atteint en France toutes les communautés bénédictines. Le Mont n'y échappe pas. En 1615, il se voit doté d'un nouvel abbé commendataire, un poupon d'un an, Henri de Lorraine. C'en est trop. Une rénovation s'impose. Le « Grand Siècle » tentera de la mener à bien.
Liste complète des abbés commendataires :
1524 Jean Le Veneur [Note 1].
1543 Jacques d'Annebault [Note 2].
1558 François Le Roux
d'Anort [Note 3].
1570 Arthur de Cossé-Brissac [Note 4].
1588 François de Joyeuse [Note
5].
1615 Henri II de
Lorraine, 5ème duc de Guise [Note 6].
1641 Ruzé d'Effiat [Note 7].
1644 Jacques de Souvré
[Note 8].
1670 Etienne
Texier d'Hautefeuille [Note 9].
1703 Karq de Bebambourg [Note 10].
1721 Charles-Maurice de Broglie
[Note 11].
1766
Etienne-Charles de Loménie de Brienne [Note 12].
1788 Louis-Joseph de Montmorency-Laval
[Note 13].
(F. E.).
Note 1 : Le Concordat de 1516, signé entre le pape Léon X et François Ier, instaurait le système dit de la commende. Le roi se réserve désormais la nomination de l'Abbé qui ne sera plus élu par la communauté des moines. Le premier bénéficiaire de cette disposition, dont les conséquences allaient être déplorables, fut l'Abbé Jean Le Veneur. Jean Le Veneur, né vers 1473 et mort le 7 août 1543, est un ecclésiastique, bénédictin, et homme politique français. Il était chanoine de Paris, évêque-comte de Lisieux (1505-1539), abbé du Bec et de l'abbaye de Lonlay, vicaire général de l'évêché d’Evreux, 37ème abbé du Mont-Saint-Michel (1524-1539), grand aumônier de France (1526-1543) et cardinal (1533-1543). Jean le Veneur naquit vers 1473 de l'union de Philippe le Veneur (1413-1486), baron de Tillières, du Homme et du Valquier, avec Marie Blosset, fille de Guillaume, seigneur de Saint-Pierre et de Carrouges, sœur de Jean Blosset (mort en 1531), seigneur de Carrouges. On lui reprochera de venir peu souvent dans son Abbaye et de diminuer le nombre des moines pour augmenter d'autant les revenus qu'il faisait percevoir par ses procureurs. Du moins, eut-il le mérite de présenter au roi François Ier, venu au Mont en 1532, le Malouin Jacques Cartier, comme capable, en raison de ses expéditions au Brésil et à Terre-Neuve, de conduire des navires à la découverte de terres nouvelles. Jean Le Veneur offrit même de participer avec le roi aux frais de l'armement des navires. Le Mont-Saint-Michel était ainsi associé à l'aventure : la découverte du Canada.
Note 2 : Jacques d’Annebault (vers 1500-1558), est un prélat français, évêque-comte de Lisieux (1539-1558), trente-huitième abbé du Mont Saint-Michel (1539-1558) et cardinal (1544-1558). Jacques d’Annebault, fils de Jean V d'Annebault et de Catherine de Jeucourt, est le frère de l'amiral Claude d'Annebault. Aumônier ordinaire du roi de 1524 à 1544, il succéda au cardinal de Meudon en 1543 comme maître de l’oratoire du roi. Il devint évêque et comte de Lisieux (d'abord en tant que vicaire, et en titre après le décès de son oncle en 1543) et abbé du Mont Saint-Michel, à la suite de son oncle le cardinal Jean le Veneur qui se démit de ces charges à son profit en obtenant le 18 août 1539 une bulle papale en ce sens (Histoire géologique, archéologique et pittoresque du Mont Saint-Michel (1843)).
Note 3 : François Le Roux d’Anort, (mort en mars 1572), est un religieux français, trente-neuvième abbé du Mont Saint-Michel, de 1558 à 1570 puis abbé de Saint-Melaine de 1570 à 1572, après permutation avec Arthur de Cossé-Brissac. François Le Roux, seigneur de la maison d’Anort, chapelain ordinaire du roi, et protonotaire apostolique, fut le successeur que François II désigna à Jacques d'Annebault, trente-huitième abbé du Mont Saint-Michel (Histoire géologique, archéologique et pittoresque du Mont Saint-Michel (1843)).
Note 4 : Arthur de Cossé-Brissac, né en 1515 et mort le 7 octobre 1587, est un religieux français, quarantième abbé du Mont Saint-Michel, de 1570 à 1587. Arthur de Cossé, issu de la maison de Brissac, évêque de Coutances et commendataire de plusieurs riches communautés, est d'abord pourvu de l'abbaye Saint-Jouin de Marnes (diocèse de Poitiers) et de l'abbaye Sainte-Trinité de Lessay (Manche). Le roi lui donne ensuite l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes en 1560 qu'il échange contre l'abbaye du Mont-Saint-Michel, dont il prend possession le 6 juin 1570. L'Abbé fut en difficulté avec les moines et le prieur, Jean de Grimonville, au sujet de l'orfèvrerie du trésor, que le prélat prétendit vendre pour payer les taxes imposées par Charles IX sur les abbayes. Procès s'ensuivit, qui l'obligea, en 1574, par arrêt du Parlement de Normandie, à restituer au trésor abbatial les objets précieux enlevés. Arthur de Cossé mourut en octobre 1587 au manoir de Loyselière, dépendant du Mont-Saint-Michel.
Note 5 : François de Joyeuse, né le 24 juin 1562 à Carcassonne et mort le 23 août 1615 à Avignon, est un cardinal et homme politique français. C'est un des membres éminents de la maison de Joyeuse. Né le 24 juin 1562 à Carcassonne d'une famille originaire du Vivarais, François de Joyeuse est le second fils de Guillaume de Joyeuse et de Marie Eléonore de Batarnay. Pendant la période troublée des guerres de religion, François de Joyeuse embrassa comme l'Abbaye le parti de la Ligue, il occupa les plus grandes dignités de l'Eglise à la fin du XVIème s. et au commencement du XVIIème. Il fut cardinal de la Trinité-du-Mont, en 1583 (il avait vingt et un ans), puis de St-Pierre-ès-Liens en 1594. Protecteur de l'Eglise de France à Rome, archevêque de Rouen, de Toulouse et de Narbonne, et abbé commendataire de plusieurs monastères, il résida le plus souvent à Rome, où, en 1589, il consacra l'église St-Louis-des-Français et, en 1595, l'église de la Trinité-du-Mont, dont il avait fait achever la façade et les deux clochers. Prélat diplomate et courtisan, plus soucieux des églises romaines que du sort de son Abbaye normande laissée à l'abandon, le cardinal fut contraint, en 1603, par un arrêt du Parlement de Normandie, devant lequel s'étaient pourvus les moines, à effectuer les travaux d'entretien indispensables, notamment la reconstruction du clocher avec son bulbe à lanternon (1609). Il mourut à Avignon en 1615.
Note 6 : Henri II de Lorraine, duc de Guise, Abbé commendataire du Mont-Saint-Michel (1614-1641). Henri de Lorraine était âgé de seize mois quand il fut nommé Abbé commendataire du Mont. Fils de Charles de Lorraine, duc de Guise, et de Henriette-Catherine de Joyeuse, l'enfant se trouvait être par sa mère petit-neveu de son prédécesseur le cardinal François de Joyeuse. Les abus du système de la commende étaient devenus trop évidents ; une rénovation monastique s'imposait. Grâce à l'intervention du Père de Bérulle, fondateur de l'Oratoire, avec l'appui de la famille de Guise et de la papauté, la Réforme, dite de St-Maur, va être introduite au Mont-Saint-Michel en 1622. Après Jumièges (1616), le Mont était la seconde Abbaye de Normandie à y adhérer. La soeur d'Henri de Lorraine, Mlle de Montpensier, vint en pèlerinage au Mont-Saint-Michel en 1625, et en 1631, Henri de Bourbon, prince de Condé. Henri de Lorraine, fort peu abbé bien que possesseur d'une dizaine d'abbayes, jouit de 400 000 livres de rente. Il est compromis en 1641 dans un complot contre Richelieu. La commende de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel lui est enlevée et donnée, en 1643, à Jacques de Souvré.
Note 7 : Jean Coiffier de Ruzé d’Effiat, né en 1622 et mort le 18 octobre 1698 au château de l’Arsenal, est un religieux français, quarante-troisième abbé du Mont Saint-Michel, de 1641 à 1643 il est également commendataire de Saint-Sernin de Toulouse de 1640 à sa mort. Jean Ruzé d'Effiat est le fils d'Antoine Coëffier de Ruzé d'Effiat (1581-1632), écuyer de Louis XIII, futur maréchal de France (1631) et de Marie de Fourcy, son épouse. Il est le frère cadet de Cinq Mars et l'oncle du dernier marquis d'Effiat (Histoire géologique, archéologique et pittoresque du Mont Saint-Michel (1843)).
Note 8 : Jacques de Souvré, né en 1600 et mort le 22 mai 1670 à Paris, est un militaire et religieux français, prieur de France de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ambassadeur de l'Ordre, commandant des galères de France, et 44ème abbé du Mont Saint-Michel, de 1643 à 1670. Fils cadet de Gilles de Souvré, marquis de Courtanvaux, un des favoris du roi Henri III, précepteur de Louis XIII, maréchal de France, et de Françoise de Bailleul. Abbé laïque, officier des gentilshommes de la suite de Louis XIII, Souvré n'avait rien d'un ecclésiastique. Il eut une carrière brillante et mouvementée d'homme de guerre et de bel esprit. Du moins, sa générosité ne se démentit pas en faveur de l'Abbaye. Elle permit aux Mauristes d'effectuer des travaux de décoration importants, dont un grand autel en bois doré de style baroque, placé à l'entrée du transept, de manière à isoler complètement le choeur des moines (1645). C'est alors que le bénédictin Dom Thomas le Roy écrit au Mont ses Curieuses Recherches, qui complètent l'Histoire générale de l'Abbaye composée en 1640 par son confrère Dom Jean Huynes. L'Abbaye retrouve une certaine prospérité et un certain prestige intellectuel. Jacques de Souvré, mort en 1670 à Paris dans son hôtel somptueux du Temple, où il avait mené une vie de grand seigneur et d'épicurien, fut inhumé dans l'église du Temple. Le célèbre sculpteur Michel Anguier lui éleva un mausolée de marbre blanc.
Note 9 : Louis-Etienne Texier d'Hautefeuille, dit le « Bailli d'Hautefeuille », né le 9 décembre 1626 à Malicorne (Yonne) et mort le 3 mai 1702 à Paris, est un chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Suite au décès de Jacques de Souvré, des lettres royales du le nommèrent abbé du Mont Saint-Michel. Lieutenant-Général des Armées du Roi le Le Bailly d'Hautefeuille, ambassadeur extraordinaire de l'Ordre de Malte, commandeur de la Croix-en-Brie, ... . Abbé commendataire du Mont-Saint-Michel (1670-1703). Sa prélature d'une trentaine d'années termine la relative prospérité de l'Abbaye mauriste, avant la décadence du siècle de Louis XV.
Note 10 : Johann-Friedrich Karq, baron de Bebembourg, seigneur de Kirchsletten, à Beunberg en Franconie, le 19 février 1648 et mort fin 1719, est un religieux allemand, quarante-sixième abbé du Mont Saint-Michel, de 1703 à 1719. A la mort de Texier de Hautefeuille, Jean-Frédéric Karq fut élevé à la dignité d’abbé du Mont Saint-Michel le 26 mars 1703. Ayant reçu ses bulles pontificales le 15 octobre suivant, et prit possession de sa place le 7 février 1704 (Histoire géologique, archéologique et pittoresque du Mont Saint-Michel (1843)).
Note 11 : Charles-Maurice de Broglie, né le 4 octobre 1682 et mort le 21 avril 1766 à Baume-les-Moines, est un religieux français faisant partie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, quarante-neuvième abbé du Mont Saint-Michel, à partir de 1721. Charles-Maurice de Broglie, docteur en théologie, abbé commendataire du Mont-Saint-Michel (1721-1766). Quatrième fils de Victor-Maurice de Broglie, maréchal de France en 1724, et de Marie de Lamoignon (1645-1733), l'Abbé appartenait à une puissante famille bien en cour et comblée des faveurs royales. L'appui dont il jouissait près de la reine Marie Leczinska, n'améliore pas, pour autant, la situation du monastère. Les Bénédictins, au nombre de vingt-quatre à la nomination de Broglie (1721), ne seront plus que sept à sa mort, en 1766.
Note 12 : Etienne-Charles de Loménie de Brienne, né le 9 octobre 1727 à Paris et mort le 19 février 1794 à Sens, est un homme d'Eglise et homme politique français, cardinal et ministre. Issu de la famille de Loménie, originaire de Flavignac en Limousin, et dont on peut remonter la lignée jusqu’au XVème siècle, il est le fils de Nicolas Louis, comte de Brienne, et de Anne Gabrielle de Chamillart. Etienne-Charles Loménie de Brienne est abbé commendataire de 1766 à 1769. Né à Paris en 1727, nommé archevêque de Toulouse en 1763, promu abbé commendataire du Mont-Saint-Michel le 9 juillet 1766, il se démit de la commende du Mont en décembre 1769 par intérêt. Il « reçut à la place l'Abbaye cistercienne de Froidmont dans le diocèse de Beauvais, laquelle valait 29 000 livres et était taxée en cour de Rome à 133 florins, tandis que le revenu du Mont n'était alors que de 24 000 livres, avec une taxe de 400 florins... » (Deschamps du Manoir : Hist. du Mont-Saint-Michel, Avranches, 1877, p. 255). Loménie de Brienne devint archevêque de Sens et fut l'un des quatre prélats qui prêtèrent serment à la constitution civile du clergé. Arrêté à Sens, le 9 novembre 1793, et détenu chez lui, il mourut le 16 février 1794.
Note 13 : Louis-Joseph de Montmorency-Laval, 49ème Abbé, dernier Abbé commendataire du Mont-Saint-Michel, 1788. Louis-Joseph de Montmorency-Laval, né à Bayers le 11 décembre 1724 et mort le 17 juin 1808 à Altona (duché de Holstein, aujourd'hui Allemagne), est un ecclésiastique français, évêque d’Orléans de 1754 à 1758 ; évêque de Condom de 1758 à 1760 puis 94ème évêque de Metz de 1760 à 1801 et grand aumônier de France depuis 1786, nommé cardinal le 30 mars 1789. Issu de l’illustre maison de Montmorency, il est le fils de Guy-André de Montmorency-Laval et de Marie-Anne de Turménies de Nointel. Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, conseiller du roi, il verra la fin de l'ancien régime, et la dissolution de l'Abbaye bénédictine en 1791 (Histoire géologique, archéologique et pittoresque du Mont Saint-Michel (1843)).
© Copyright - Tous droits réservés.