|
Bienvenue chez les Batziens |
BATZ-SUR-MER |
Retour page d'accueil Retour Canton du Croisic
La commune
de Batz-sur-Mer ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BATZ-SUR-MER
Batz (-sur-Mer) est semble-t-il soit d'origine celtique, soit d'origine latine "bassa" (basse). On trouve dans les archives, à partir du IXème siècle, les dénominations d'Isle-de-Baas, Baf, Baz ou Bath Wenran. L'histoire de Batz et de ses origines se fond dans celle de l'île de Batz, citée dans les documents médiévaux. Cette île ou plutôt presqu'île est à considérer en premier lieu comme une unité territoriale comprenant Le Croisic, Batz et Le Pouliguen, soit aujourd'hui le canton du Croisic.

Le nom de Batz est mentionné une première fois vers 840 dans les miracles de saint Philibert (écrits par le moine Ermentaire) qui évoquent l'existence d'une église. Une saline de "l'insula Baf" est donnée à l'abbaye de Redon en 854, une autre l'année suivante, dans l'île dite "Baf Montroï".
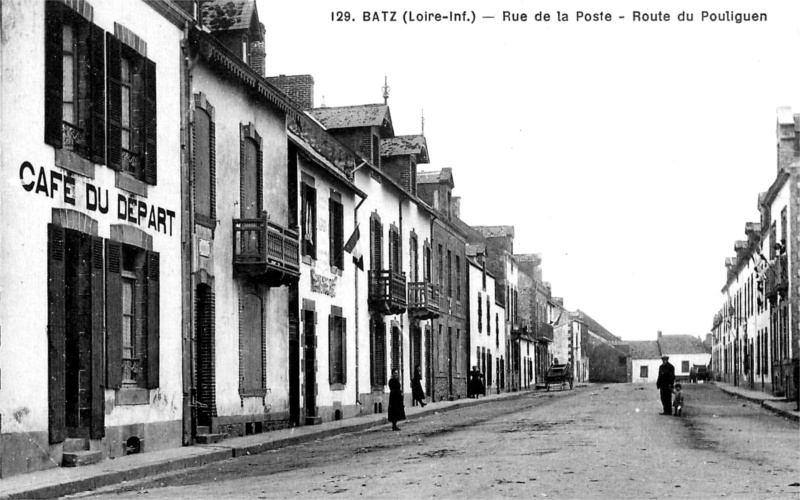
Aux dires de Strabon, l'île de Batz-sur-Mer aurait été jadis "habitée par des femmes Samnites, prêtresses en délire d'une "religion bacchique", d'où les hommes étaient exclus".
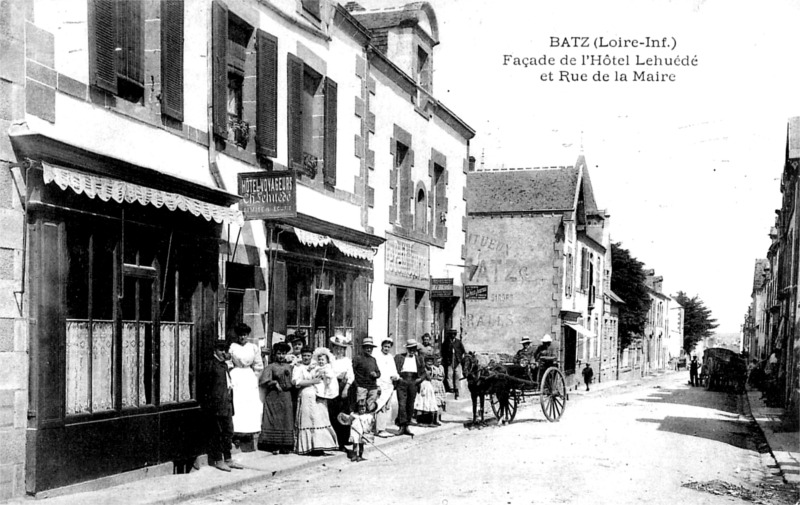
Au Xème siècle (entre 944 et 952), après les invasions scandinaves, la totalité de l'île de Batz (insula quae nominatur Bath Uuenran) est donnée par le duc Alain Barbe-Torte (Alain II) à l'abbé Jean, supérieur de l'abbaye de Landévennec. Pasqueten, frère d'Alain le Grand, fait des donations aux moines de l'abbaye de Redon. Vers 945, les moines édifient un prieuré sous le patronage de saint Guénolé, fondateur et premier abbé de Landévennec. Les moines apportent le culte de leur fondateur, saint Guénolé, qui remplace les saints patrons d'origine saint Cyr et sainte Julitte. Le prieuré est encore mentionné au XVIème siècle. Batz devait demeurer prieuré conventuel de Landévennec jusqu'à la Révolution, mais en principe du moins, car si jusqu'au XVIème siècle la présence de quelques religieux est attestée, après les troubles de la Ligue et la ruine de l'abbaye, l'abbé se contente d'y nommer un "vicaire perpétuel", droit qui dès 1660, lui est contesté, au profit de l'évêque de Nantes. La paroisse primitive de Batz englobait jadis Le Croisic et Le Pouliguen. Batz restera jusqu'en 1783 le chef-lieu paroissial et ecclésiastique de l'île tout entière, c'est-à-dire du Croisic et du Pouliguen qui n'était qu'une simple trève de Batz. C'est Guillaume Macay, prieur de Batz, qui bénit l'église Saint-Nicolas du Pouliguen en 1626.
![]() Le
général de la paroisse de Batz (1732-1738).
Le
général de la paroisse de Batz (1732-1738).

Jusqu'en 1763, le bourg de Batz(-sur-Mer) rassemble dans ses villages (Kervalet, Kermoison, Roffiat et Trégaté) la majeure partie de la population paludière. L'appellation Batz-sur-Mer est choisie en 1931. C'est en 1854 que Le Pouliguen se détache de Batz-sur-Mer.

Note 1 : les principales anciennes familles de Batz-sur-Mer sont les Aubrée, Bauchot, Bloyet, Brouard, Charault, Goupil de Mesmé, Miquel de Beaulieu, Raphael, Tartoué, Lemerle, Le Roux, Forget, Gaudin. Les gros villages autour de Batz-sur-Mer sont : Kervalet, Roffiat, Trégaté, Kermoisan et Kerbouchard. En 1515, on relève sur les registres d'état civil les noms de quelques vieilles familles de Batz-sur-Mer : Brohand, Le Callo, Lehuédé, Le Breton, Le Gal et Leblanc.

Note 2 : liste non exhaustive des maires de la commune de Batz-sur-Mer : Noël Brouard (de 1793 à 1800), Renée Aubrée (de 1800 à 1804), Le Roux, René Monfort, Bloyet, Le Blanc (de 1822 à 1834), Jacques Gambert, Yves Bellamy, Jean Lehuédé, Guillaume Bertrand, Gabriel Le Gal, Saffré, Charles Lehuédé, Le Gars (1871 à 1888), Lehuédé, Le Callo, J.B. Bertrand, Vauvert, Xavier Cavalin, Charles Lehuédé, Le Callo, André Bertrand, Désiré Guitton, Barbin, Pierre Fréour, Chollet, Bourdic.

Note 3 : liste non exhaustive des villages de Batz-sur-Mer : Kerdour, Kervalet, Kerdréan, Kerlaun, Penker, Trégaté, Pradvelin, Skall, Manerik, Govelle. Le maître d'école du bourg de Batz, en 1782, se nommait Jacques Le Huédé (Archives départementales, E1436).

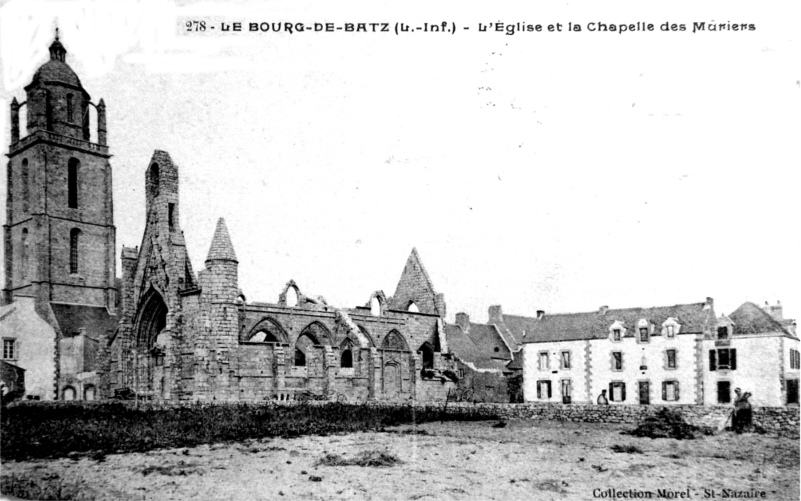
![]()
PATRIMOINE de BATZ-SUR-MER
![]() l'église
Saint-Guénolé (XV-XVII-XIXème siècle), située place du Garnal. Elle
porte le nom de saint Guénolé, moine fondateur de l'Abbaye de Landévennec
en 485 dans la presqu'île de Crozon en Finistère. Il s'agit d'un don
d'Alain Barbetorte à l'abbé Jean de Landévennec, au Xème siècle, depuis
lors prieuré conventuel de l'abbaye, avec présence de quelques moines. Le prieuré fondé au Xème
siècle est établi, semble-t-il, près d'un ancien sanctuaire dédié à
saint Cyr et à sainte Julitte. L'église actuelle porte trace de nombreux
agrandissements et remaniements depuis les XII-XIIIème siècle. Les moines édifient une église vers le
XIIIème siècle. L'église est reconstruite vers 1400 et 1428, date à
laquelle la nef est rebâtie. La voûte lambrissée, ses bas-côtés voûtes
et le transept datent de 1460 environ. Les parties Nord sont remaniées au
XIXème siècle. Le porche ouest date du XVème siècle. Le porche nord est
l'une des plus vieilles parties de l'ancienne église de Batz-sur-Mer, de
style ogival et datée de la fin du XVème siècle : on le nomme porche de
Garnal (mot breton signifiant cimetière). Le porche du Garnal
s'ouvrait jadis sur le cimetière : des bancs de pierre permettaient aux
vieillards de s'asseoir en attendant les offices. C'est une oeuvre de
caractère avec le dais gothique de pierres sculptées et de guirlandes de
granit, avec ses fermes nervures, ses chapiteaux ouvragés, ses colonnes
armées de noeuds et ses bancs de granit. Dans la niche du trumeau de la porte d'entrée, on
vénérait jadis une statue en bois représentant la Vierge Marie. L'intérieur de l'église
comprend trois nefs. Dans le bas-côté du nord les clefs de voûte sont
curieuses : un château-fort, les armes des Le Pourceau de Tréméac, un
cochon qui joue du biniou, un homme nu dévoré par les sept péchés
capitaux. La tour, élevée à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer, est édifiée de
1658 à 1677, et remplace une ancienne flèche en bois couverte d'ardoises.
Détruite par la foudre une première fois le 11 juin 1603, et de nouveau le
17 juillet 1657, elle est reconstruite en pierre de taille par René
Allaire. En 1685, une cloche appelée "Renée" annonçait l'office
aux paludiers sur le marais. En 1738, deux autres cloches sont ajoutées.
Toutes les trois cloches sont brisées par les Révolutionnaires en 1793.
Aujourd'hui le carillon du gros bourdon et les quatre cloches de la tour de
l'église saint Guénolé sonnent encore les joies et malheurs de la
population paludière. La nouvelle tour (XVIIème siècle), haute de 57 mètres,
domine le marais salant : elle est terminée en 1677 par Jean Haurée. Elle a longtemps servi d'amer aux pêcheurs et aux
marins. L'édification de cet imposant ouvrage en pierres de taille fut
financée par la levée d'un impôt spécial, le "billot" de six
deniers par pot de vin vendu au détail sur la paroisse. Le cimetière qui
bordait l'église au Nord a été désaffecté au XIXème siècle. Les
portes sculptées de la sacristie sont contemporaines de Louis XIV. Les
boiseries sont l'œuvre, semble-t-il, de Hupel (le buffet des grandes
orgues, la chaire datée de 1682, les retables des autels et la balustrade
des chœurs). Le tombeau vénéré d'un chapelain de Pouliguen, Georges Hervé,
sieur Dupuyt, se trouve sous le vitrail du Baptême des Saxons, devant
l'autel Saint-Jean. Ce dernier est décédé en odeur de sainteté le 13
octobre 1724. La porte Saint-Jean est une ouverture fort ancienne dans le côté
Est du transept. Une partie du transept date du XXème siècle et remplace
un vieux mur du Xème siècle, sur lequel s'appuyait la toiture d'une
ancienne dépendance du Prieuré et qui menaçait ruine. Si les voûtes sont
neuves, il n'en va pas de même du mur et des piliers sur lesquels elles
s'appuient. D'importants vestiges se voient encore dans le mur ou les
piliers du collatéral Sud. On y distingue une crédence bouchée et la
trace d'une porte obstruée (dans le mur de la troisième travée). Au
dessus du baptistère, entouré d'anges, un fragment de tableau (peinture
sur bois) représente le Père Eternel et le Saint-Esprit. Certains piliers
de la nef centrale sont entaillés du côté Ouest : il s'agit de
l'emplacement des anciens autels votifs avec fondation de messes. La représentation
des "Péchés Capitaux" date du XVème siècle. L'enfeu situé
dans la muraille, près de l'autel latéral du chevet, est celui des Prieurs
de Batz-sur-Mer, religieux bénédictins venus de l'abbaye de Landévennec
et qui par suite d'une donation du duc Alain Barbe-Torte desservirent la
paroisse de l'an 945 à 1660. Un peu plus loin, on trouve l'enfeu des
seigneurs de Kerbouchard qui est situé dans la chapelle Notre-Dame du
Rosaire et qui date du XVème siècle. La statue de saint Adrien (découverte dans
un enfeu de la chapelle Notre-Dame du Mûrier) date du XVème siècle. La
statue en bois de Notre-Dame du Précieux Sang (qui provient de la chapelle
Notre-Dame du Mûrier) date du XVIème siècle : elle était primitivement
placée à l'entrée du porche du Garnal. La statue en bois de saint
Guénolé date du XVIIème siècle. La peinture intitulée "le
pape Nicolas V au caveau de saint François d'Assise" date du XVIIème
siècle. Le retable du maître-autel date de 1677-1763 (le maître-autel en
marbre situé au milieu de la nef a été acheté au XVIIIème siècle par
Fleury, Riallant, Guibert et Audrain). Il est supporté par six colonnes de marbre de différentes couleurs, avec
bases et chapiteaux corinthiens dorés, encadrant les statues de saint Guénolé
(abbé mitré, avec crosse et livre fermé), saint Paul avec le glaive, saint Michel
terrassant le diable en chaîne, et saint Jean l'Evangéliste. L'autel est
couronné par un calvaire avec sa croix massive, son Christ majestueux en
bois doré, et ses deux statues de la Vierge et de saint Jean. Le maître-autel
date de 1677, mais l'autel proprement dit date de 1763. Cet autel comporte
des bas-reliefs dorés, deux tabernacles superposés surmontés eux-mêmes
d'une tour que domine un Christ triomphant, de nombreuses colonnettes sculptées,
de balustres, de statuettes d'anges présentant l'instrument de la Passion,
de saints honorés à l'île de Batz-sur-Mer et des panneaux reliquaires où
s'épanouissent parmi les guirlandes de feuillage, des liserons, pâquerettes et
roses, acanthes et chardons bleus. En 1763, un second
retable en bois doré est placé devant le premier. On trouve des
reliquaires à droite et à gauche du retable du maître-autel : à droite,
reliques de saint Corentin, saint Guénolé et saint Guéthénoc, à gauche,
reliques de saint Ronan, saint Pol Aurélien et saint Hervé. Les stalles et la clôture
du chœur datent du XVIIème siècle. La porte, œuvre du sculpteur Huppel,
date de 1682. L'orgue, qui date du XVIIème siècle, est restauré en 1929
par la maison Gloton-Debierre (pour la somme de 50 000 F de l'époque) : le buffet d'orgue date de 1731 et l'ensemble
est surmonté par une statue de saint Michel. Les
grandes orgues de 1731 (oeuvre de Nyssen, élève de François Henri
Clicquot) avaient remplacé d'autres orgues qui existaient déjà
au XVIIème siècle et en 1428, lors de la consécration de l'église. Elles sont logées dans un
buffet en chêne sculpté et sont composées de 17 jeux, avec 20 registres,
se jouant sur deux claviers. Les tuyaux (bois et métal) sont au nombre de
1174. L'orgue est inauguré sous la présidence de Monseigneur l'Evêque de
Nantes, le 12 août 1928. Le 13 juillet 1973, l'orgue est nettoyé, révisé
et accordé par la maison Renaud-Bouvet de Nantes pour la somme de 11 407, 20 F. Le retable de Saint-François
d'Assise date du XVIIIème siècle, mais l'autel est daté de 1478. Le retable de Saint-Jean-Baptiste,
situé à la droite du choeur, date du XVIIIème siècle : deux statues de Sainte Anne et de Saint Jean-Baptiste
encadrent un tableau représentant le baptême de Notre Seigneur. Les fenêtres toutes gothiques ont des verrières
posées par les différents recteurs du XIXème siècle : Fardel, Charbonnier, Séroux,
Dalibert, Mahé, Maugast. On y trouve une scène représentant Jeanne d'Arc
à Chinon. Le vitrail de saint Guénolé et de la Vierge, œuvre du maître
verrier François Gérard, date de 1886. L'ex-voto Notre-Dame de
l'Assomption, en bois polychrome, date du XIXème siècle. Le collatéral
Sud (côté épître) porte encore le nom de la nef des Chouans ;
l'église
Saint-Guénolé (XV-XVII-XIXème siècle), située place du Garnal. Elle
porte le nom de saint Guénolé, moine fondateur de l'Abbaye de Landévennec
en 485 dans la presqu'île de Crozon en Finistère. Il s'agit d'un don
d'Alain Barbetorte à l'abbé Jean de Landévennec, au Xème siècle, depuis
lors prieuré conventuel de l'abbaye, avec présence de quelques moines. Le prieuré fondé au Xème
siècle est établi, semble-t-il, près d'un ancien sanctuaire dédié à
saint Cyr et à sainte Julitte. L'église actuelle porte trace de nombreux
agrandissements et remaniements depuis les XII-XIIIème siècle. Les moines édifient une église vers le
XIIIème siècle. L'église est reconstruite vers 1400 et 1428, date à
laquelle la nef est rebâtie. La voûte lambrissée, ses bas-côtés voûtes
et le transept datent de 1460 environ. Les parties Nord sont remaniées au
XIXème siècle. Le porche ouest date du XVème siècle. Le porche nord est
l'une des plus vieilles parties de l'ancienne église de Batz-sur-Mer, de
style ogival et datée de la fin du XVème siècle : on le nomme porche de
Garnal (mot breton signifiant cimetière). Le porche du Garnal
s'ouvrait jadis sur le cimetière : des bancs de pierre permettaient aux
vieillards de s'asseoir en attendant les offices. C'est une oeuvre de
caractère avec le dais gothique de pierres sculptées et de guirlandes de
granit, avec ses fermes nervures, ses chapiteaux ouvragés, ses colonnes
armées de noeuds et ses bancs de granit. Dans la niche du trumeau de la porte d'entrée, on
vénérait jadis une statue en bois représentant la Vierge Marie. L'intérieur de l'église
comprend trois nefs. Dans le bas-côté du nord les clefs de voûte sont
curieuses : un château-fort, les armes des Le Pourceau de Tréméac, un
cochon qui joue du biniou, un homme nu dévoré par les sept péchés
capitaux. La tour, élevée à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer, est édifiée de
1658 à 1677, et remplace une ancienne flèche en bois couverte d'ardoises.
Détruite par la foudre une première fois le 11 juin 1603, et de nouveau le
17 juillet 1657, elle est reconstruite en pierre de taille par René
Allaire. En 1685, une cloche appelée "Renée" annonçait l'office
aux paludiers sur le marais. En 1738, deux autres cloches sont ajoutées.
Toutes les trois cloches sont brisées par les Révolutionnaires en 1793.
Aujourd'hui le carillon du gros bourdon et les quatre cloches de la tour de
l'église saint Guénolé sonnent encore les joies et malheurs de la
population paludière. La nouvelle tour (XVIIème siècle), haute de 57 mètres,
domine le marais salant : elle est terminée en 1677 par Jean Haurée. Elle a longtemps servi d'amer aux pêcheurs et aux
marins. L'édification de cet imposant ouvrage en pierres de taille fut
financée par la levée d'un impôt spécial, le "billot" de six
deniers par pot de vin vendu au détail sur la paroisse. Le cimetière qui
bordait l'église au Nord a été désaffecté au XIXème siècle. Les
portes sculptées de la sacristie sont contemporaines de Louis XIV. Les
boiseries sont l'œuvre, semble-t-il, de Hupel (le buffet des grandes
orgues, la chaire datée de 1682, les retables des autels et la balustrade
des chœurs). Le tombeau vénéré d'un chapelain de Pouliguen, Georges Hervé,
sieur Dupuyt, se trouve sous le vitrail du Baptême des Saxons, devant
l'autel Saint-Jean. Ce dernier est décédé en odeur de sainteté le 13
octobre 1724. La porte Saint-Jean est une ouverture fort ancienne dans le côté
Est du transept. Une partie du transept date du XXème siècle et remplace
un vieux mur du Xème siècle, sur lequel s'appuyait la toiture d'une
ancienne dépendance du Prieuré et qui menaçait ruine. Si les voûtes sont
neuves, il n'en va pas de même du mur et des piliers sur lesquels elles
s'appuient. D'importants vestiges se voient encore dans le mur ou les
piliers du collatéral Sud. On y distingue une crédence bouchée et la
trace d'une porte obstruée (dans le mur de la troisième travée). Au
dessus du baptistère, entouré d'anges, un fragment de tableau (peinture
sur bois) représente le Père Eternel et le Saint-Esprit. Certains piliers
de la nef centrale sont entaillés du côté Ouest : il s'agit de
l'emplacement des anciens autels votifs avec fondation de messes. La représentation
des "Péchés Capitaux" date du XVème siècle. L'enfeu situé
dans la muraille, près de l'autel latéral du chevet, est celui des Prieurs
de Batz-sur-Mer, religieux bénédictins venus de l'abbaye de Landévennec
et qui par suite d'une donation du duc Alain Barbe-Torte desservirent la
paroisse de l'an 945 à 1660. Un peu plus loin, on trouve l'enfeu des
seigneurs de Kerbouchard qui est situé dans la chapelle Notre-Dame du
Rosaire et qui date du XVème siècle. La statue de saint Adrien (découverte dans
un enfeu de la chapelle Notre-Dame du Mûrier) date du XVème siècle. La
statue en bois de Notre-Dame du Précieux Sang (qui provient de la chapelle
Notre-Dame du Mûrier) date du XVIème siècle : elle était primitivement
placée à l'entrée du porche du Garnal. La statue en bois de saint
Guénolé date du XVIIème siècle. La peinture intitulée "le
pape Nicolas V au caveau de saint François d'Assise" date du XVIIème
siècle. Le retable du maître-autel date de 1677-1763 (le maître-autel en
marbre situé au milieu de la nef a été acheté au XVIIIème siècle par
Fleury, Riallant, Guibert et Audrain). Il est supporté par six colonnes de marbre de différentes couleurs, avec
bases et chapiteaux corinthiens dorés, encadrant les statues de saint Guénolé
(abbé mitré, avec crosse et livre fermé), saint Paul avec le glaive, saint Michel
terrassant le diable en chaîne, et saint Jean l'Evangéliste. L'autel est
couronné par un calvaire avec sa croix massive, son Christ majestueux en
bois doré, et ses deux statues de la Vierge et de saint Jean. Le maître-autel
date de 1677, mais l'autel proprement dit date de 1763. Cet autel comporte
des bas-reliefs dorés, deux tabernacles superposés surmontés eux-mêmes
d'une tour que domine un Christ triomphant, de nombreuses colonnettes sculptées,
de balustres, de statuettes d'anges présentant l'instrument de la Passion,
de saints honorés à l'île de Batz-sur-Mer et des panneaux reliquaires où
s'épanouissent parmi les guirlandes de feuillage, des liserons, pâquerettes et
roses, acanthes et chardons bleus. En 1763, un second
retable en bois doré est placé devant le premier. On trouve des
reliquaires à droite et à gauche du retable du maître-autel : à droite,
reliques de saint Corentin, saint Guénolé et saint Guéthénoc, à gauche,
reliques de saint Ronan, saint Pol Aurélien et saint Hervé. Les stalles et la clôture
du chœur datent du XVIIème siècle. La porte, œuvre du sculpteur Huppel,
date de 1682. L'orgue, qui date du XVIIème siècle, est restauré en 1929
par la maison Gloton-Debierre (pour la somme de 50 000 F de l'époque) : le buffet d'orgue date de 1731 et l'ensemble
est surmonté par une statue de saint Michel. Les
grandes orgues de 1731 (oeuvre de Nyssen, élève de François Henri
Clicquot) avaient remplacé d'autres orgues qui existaient déjà
au XVIIème siècle et en 1428, lors de la consécration de l'église. Elles sont logées dans un
buffet en chêne sculpté et sont composées de 17 jeux, avec 20 registres,
se jouant sur deux claviers. Les tuyaux (bois et métal) sont au nombre de
1174. L'orgue est inauguré sous la présidence de Monseigneur l'Evêque de
Nantes, le 12 août 1928. Le 13 juillet 1973, l'orgue est nettoyé, révisé
et accordé par la maison Renaud-Bouvet de Nantes pour la somme de 11 407, 20 F. Le retable de Saint-François
d'Assise date du XVIIIème siècle, mais l'autel est daté de 1478. Le retable de Saint-Jean-Baptiste,
situé à la droite du choeur, date du XVIIIème siècle : deux statues de Sainte Anne et de Saint Jean-Baptiste
encadrent un tableau représentant le baptême de Notre Seigneur. Les fenêtres toutes gothiques ont des verrières
posées par les différents recteurs du XIXème siècle : Fardel, Charbonnier, Séroux,
Dalibert, Mahé, Maugast. On y trouve une scène représentant Jeanne d'Arc
à Chinon. Le vitrail de saint Guénolé et de la Vierge, œuvre du maître
verrier François Gérard, date de 1886. L'ex-voto Notre-Dame de
l'Assomption, en bois polychrome, date du XIXème siècle. Le collatéral
Sud (côté épître) porte encore le nom de la nef des Chouans ;
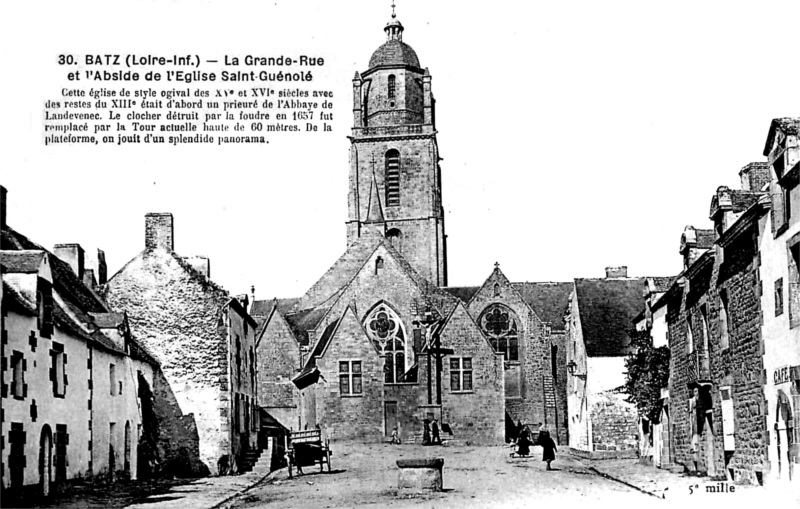
voir
![]() "L'église
de Saint-Guenolé de Batz-sur-Mer"
"L'église
de Saint-Guenolé de Batz-sur-Mer"
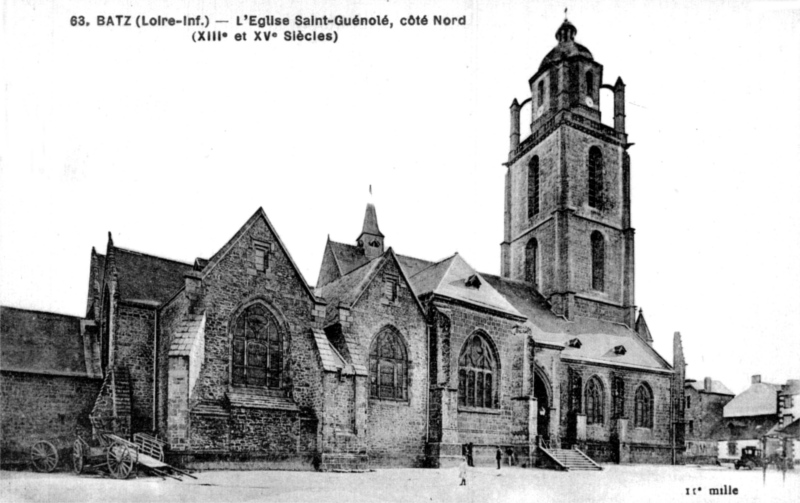
![]() les
vestiges du prieuré (vers le XVème siècle), situés rue Maupertuis. Le
prieuré de Batz-sur-Mer est fondé en 945 par les moines de l'abbaye de
Landévennec. Les bâtiments étaient situés au sud de l'église ;
les
vestiges du prieuré (vers le XVème siècle), situés rue Maupertuis. Le
prieuré de Batz-sur-Mer est fondé en 945 par les moines de l'abbaye de
Landévennec. Les bâtiments étaient situés au sud de l'église ;
![]() la
chapelle Saint-Marc-de-Kervalet (XVème siècle - 1790). Construite au
XVème siècle sur un rocher émergeant des marais, la chapelle
Saint-Marc est située au centre du village de Kervalet. On y retrouve les
principales caractéristiques du XVème siècle breton : voûte en nef
renversée, poutre de gloire portant le crucifix, chevet plat contrebuté
par des contreforts surmontés de gargouille. Sur la façade méridionale,
on découvre une belle porte gothique dont les voussures portent en leur
sommet une vierge à l'Enfant. Tout à côté, une vieille croix rustique a
été dressée en 1925, au-dessus de laquelle on peut voir un cadran solaire
en schiste de 1693. En 1442, le pape accorde deux ans d'indulgences, favorisant
les dons en argent. En 1790, l'édification du clocher a peut-être été
l'occasion d'un raccourcissement de la nef qui a nui à son caractère et à
son harmonie. La chapelle, dédiée aux quatre évangélistes, est dotée
d'un campanile en 1790. Sur l'autel de marbre noir et blanc, se trouvent deux
reliquaires contenant les reliques de Saint Prime, saint Grat, saint
Veregoud et saint Laudat, envoyées de Rome et exposés pour la première
fois le jour de la saint Marc en 1758. Sur le côté ont été posées, dans
les années 1930, les statues des trois évangélistes qui avaient été
"placées" chez des habitants du village à la fin du siècle
dernier. Seul le quatrième, saint Jean, n'a jamais été retrouvé ;
la
chapelle Saint-Marc-de-Kervalet (XVème siècle - 1790). Construite au
XVème siècle sur un rocher émergeant des marais, la chapelle
Saint-Marc est située au centre du village de Kervalet. On y retrouve les
principales caractéristiques du XVème siècle breton : voûte en nef
renversée, poutre de gloire portant le crucifix, chevet plat contrebuté
par des contreforts surmontés de gargouille. Sur la façade méridionale,
on découvre une belle porte gothique dont les voussures portent en leur
sommet une vierge à l'Enfant. Tout à côté, une vieille croix rustique a
été dressée en 1925, au-dessus de laquelle on peut voir un cadran solaire
en schiste de 1693. En 1442, le pape accorde deux ans d'indulgences, favorisant
les dons en argent. En 1790, l'édification du clocher a peut-être été
l'occasion d'un raccourcissement de la nef qui a nui à son caractère et à
son harmonie. La chapelle, dédiée aux quatre évangélistes, est dotée
d'un campanile en 1790. Sur l'autel de marbre noir et blanc, se trouvent deux
reliquaires contenant les reliques de Saint Prime, saint Grat, saint
Veregoud et saint Laudat, envoyées de Rome et exposés pour la première
fois le jour de la saint Marc en 1758. Sur le côté ont été posées, dans
les années 1930, les statues des trois évangélistes qui avaient été
"placées" chez des habitants du village à la fin du siècle
dernier. Seul le quatrième, saint Jean, n'a jamais été retrouvé ;
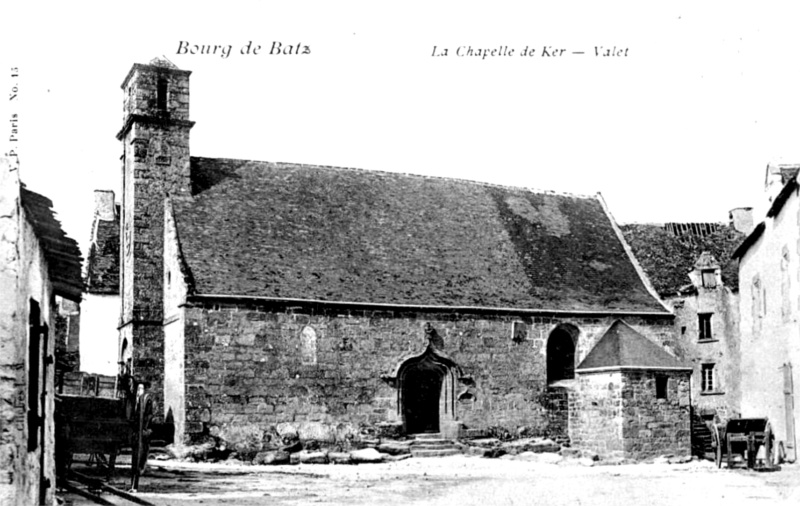
![]() la
chapelle Notre-Dame-du-Murier ou Notre-Dame-du-Mourier ou
Notre-Dame-du-Marais (1496), située place du Murier et édifiée
au XVème siècle suite à un vœu fait par les habitants du bourg de Batz
(réédifier l'ancien sanctuaire de la Vierge si la peste les épargnait).
Une autre légende raconte que "pendant la guerre de Succession de
Bretagne, Rieux de Ranrouet, prisonnier des Anglais, s'évada de captivité.
Assailli par une tempête, sur les côtes de Bretagne, il fit vœu d'élever
une chapelle là où il aborderait.". Les formes les plus anciennes du
nom (capella beatoe Marie de Morario [1563-1564, 1578], Nostre
Damme du Morier [1452], capella beatoe Marie du Mourier
[1442]) montreraient que "mourier" représenterait bien
le mûrier, arbre qui poussait en pays de Guérande. Enfin, selon la légende
recueillie en 1834, la chapelle doit son nom au sanctuaire primitif où un mûrier
abritait une statue de la Vierge. Et, si l'on en juge par le nombre de
barques placées sous l'invocation de Notre-Dame, la Vierge était très en
vogue auprès des marins guérandais entre 1385 et 1454. Le duc Jean V rédige
en faveur des habitants de Batz-sur-Mer une supplique au pape Eugène IV, en
date du "5 des ides de juillet
1442" : il y proclame sa dévotion à Notre-Dame-du-Murier et
demande à Sa Sainteté d'accorder à perpétuité "sept
ans et sept quarantaines d'indulgences" aux pèlerins
ou à ceux qui aideront la construction. En 1442, le pape
accorde deux ans d'indulgences, favorisant les dons en argent. Dès 1478, la
chapelle est consacrée et le culte y est célébré. Pendant
la Révolution, la chapelle sert de salle au Conseil Municipal. En 1496, la
chapelle est achevée, mais non meublée. Le prieur de Batz-sur-Mer était
alors Pierre de Kerguz, moine de Landévennec. C'est sans doute parce que
l'on a considéré Pierre de Kerguz comme un grand bâtisseur qu'il eut
droit d'inscrire à l'une des voûtes du collatéral de Saint-Jean, ses
armoiries que la Révolution a effacées. L'édifice, long de 27 mètres et
large de 15 mètres, comportait un chevet à pans coupés, mais pas de
sacristie. Deux rangées de six piliers cylindriques partageaient le
vaisseau en trois nefs, dont les deux latérales, plus petites étaient
flanquées de deux portes finement ornées. Le chevet était éclairé par
un vitrail et fut restauré en 1677. Le long des murailles courait une
banquette de granit. Les nervures des arceaux naissaient directement des
piliers, sans chapiteaux. La grande nef était divisée en deux parties égales
par l'arc triomphal s'élançant des troisièmes piliers jusqu'à la voûte.
Une poutre d'honneur portant le crucifix avec la Vierge et saint Jean
marquait l'entrée du "chanceau". Un jubé en bois sculpté
s'appuyait à cette poutre et fermait l'entrée du sanctuaire. En 1925, le
recteur Fourrage, découvre (en fouillant les restes d'un enfeu, sis dans la
muraille du côté de l'épître) une statue de saint Adrien en pierre
calcaire du Poitou, séparée en trois morceaux se raccordant entre eux par
des chevilles de bois : saint Adrien "est
coiffé d'un turban oriental, le saint tient à la main droite une sorte de
maillet, de la gauche il entrouve sa tunique, laissant voir une profonde
blessure au ventre par laquelle ses entrailles se sont échappées à ses
pieds. Sur le sol gisent, le cœur et les viscères". On trouva
aussi une grande quantité de vieux ossements, de barres de fer et de
plaques de schiste qui supportaient les cercueils, quelques débris de
porcelaine, de tasses, quelques pièces de monnaie de Louis XV et de Louis
XVI. Sur la paroi, au-dessus de l'enfeu, on gratta les restes d'une fresque
polychrome (deux priants agenouillés, un homme à droite, et une femme à
gauche, coiffée d'une sorte de hennin). Il s'agit certainement de l'enfeu
des fondateurs de la chapelle, car on y a découvert aussi un blason portant
un écu "au champ d'or" au-dessus de la tête du priant (peut-être
l'enfeu des Guilloré de Kerlan "d'or à aigle de sable" ou de
Kerpoisson "d'or au lion de gueule"). La fête de Notre-Dame du
Murié se célébrait le 25 mars. En 1698, on répare la verrière du porche
occidental. Vers 1750, la grande verrière du levant est bouchée en partie
pour laisser la place à un grand autel avec retable. La chapelle est délaissée
à partir de 1820 par le recteur Prosper Charbonnier. Sous le ministère de
ce dernier, a lieu la vente et la dispersion de nombreux archives du
prieuré de Batz-sur-Mer. En 1819, un ouragan emporte une partie de la toiture.
Bientôt, les restes de la charpente en cèdre, du lambris et le pavé sont
pillés par les riverains. Les portes et les fenêtres sont murées. La
population transforme l'édifice religieux en carrière et en décharge.
Aussi la Fabrique utilise-t-elle les pierres de la chapelle Saint-Michel
pour murer les portes et les fenêtres de Notre-Dame. Entre 1839
et 1847, les ruines manquent de disparaître : le conseil de
fabrique du Pouliguen propose à la commune de Batz d'en acheter les pierres
pour bâtir au Pouliguen une église en remplacement de la chapelle
Saint-Nicolas édifiée en 1627. Après la fermeture de la chapelle en 1820, le mobilier en
est dispersé. Un haut relief du XVème siècle, en bois polychrome, est
donné au musée Dobrée de Nantes. Une tête de Christ va au musée de la
porte Saint-Michel à Guérande. En 1907, quelques familles possédaient des
éléments du lambris dans leur grenier ;
la
chapelle Notre-Dame-du-Murier ou Notre-Dame-du-Mourier ou
Notre-Dame-du-Marais (1496), située place du Murier et édifiée
au XVème siècle suite à un vœu fait par les habitants du bourg de Batz
(réédifier l'ancien sanctuaire de la Vierge si la peste les épargnait).
Une autre légende raconte que "pendant la guerre de Succession de
Bretagne, Rieux de Ranrouet, prisonnier des Anglais, s'évada de captivité.
Assailli par une tempête, sur les côtes de Bretagne, il fit vœu d'élever
une chapelle là où il aborderait.". Les formes les plus anciennes du
nom (capella beatoe Marie de Morario [1563-1564, 1578], Nostre
Damme du Morier [1452], capella beatoe Marie du Mourier
[1442]) montreraient que "mourier" représenterait bien
le mûrier, arbre qui poussait en pays de Guérande. Enfin, selon la légende
recueillie en 1834, la chapelle doit son nom au sanctuaire primitif où un mûrier
abritait une statue de la Vierge. Et, si l'on en juge par le nombre de
barques placées sous l'invocation de Notre-Dame, la Vierge était très en
vogue auprès des marins guérandais entre 1385 et 1454. Le duc Jean V rédige
en faveur des habitants de Batz-sur-Mer une supplique au pape Eugène IV, en
date du "5 des ides de juillet
1442" : il y proclame sa dévotion à Notre-Dame-du-Murier et
demande à Sa Sainteté d'accorder à perpétuité "sept
ans et sept quarantaines d'indulgences" aux pèlerins
ou à ceux qui aideront la construction. En 1442, le pape
accorde deux ans d'indulgences, favorisant les dons en argent. Dès 1478, la
chapelle est consacrée et le culte y est célébré. Pendant
la Révolution, la chapelle sert de salle au Conseil Municipal. En 1496, la
chapelle est achevée, mais non meublée. Le prieur de Batz-sur-Mer était
alors Pierre de Kerguz, moine de Landévennec. C'est sans doute parce que
l'on a considéré Pierre de Kerguz comme un grand bâtisseur qu'il eut
droit d'inscrire à l'une des voûtes du collatéral de Saint-Jean, ses
armoiries que la Révolution a effacées. L'édifice, long de 27 mètres et
large de 15 mètres, comportait un chevet à pans coupés, mais pas de
sacristie. Deux rangées de six piliers cylindriques partageaient le
vaisseau en trois nefs, dont les deux latérales, plus petites étaient
flanquées de deux portes finement ornées. Le chevet était éclairé par
un vitrail et fut restauré en 1677. Le long des murailles courait une
banquette de granit. Les nervures des arceaux naissaient directement des
piliers, sans chapiteaux. La grande nef était divisée en deux parties égales
par l'arc triomphal s'élançant des troisièmes piliers jusqu'à la voûte.
Une poutre d'honneur portant le crucifix avec la Vierge et saint Jean
marquait l'entrée du "chanceau". Un jubé en bois sculpté
s'appuyait à cette poutre et fermait l'entrée du sanctuaire. En 1925, le
recteur Fourrage, découvre (en fouillant les restes d'un enfeu, sis dans la
muraille du côté de l'épître) une statue de saint Adrien en pierre
calcaire du Poitou, séparée en trois morceaux se raccordant entre eux par
des chevilles de bois : saint Adrien "est
coiffé d'un turban oriental, le saint tient à la main droite une sorte de
maillet, de la gauche il entrouve sa tunique, laissant voir une profonde
blessure au ventre par laquelle ses entrailles se sont échappées à ses
pieds. Sur le sol gisent, le cœur et les viscères". On trouva
aussi une grande quantité de vieux ossements, de barres de fer et de
plaques de schiste qui supportaient les cercueils, quelques débris de
porcelaine, de tasses, quelques pièces de monnaie de Louis XV et de Louis
XVI. Sur la paroi, au-dessus de l'enfeu, on gratta les restes d'une fresque
polychrome (deux priants agenouillés, un homme à droite, et une femme à
gauche, coiffée d'une sorte de hennin). Il s'agit certainement de l'enfeu
des fondateurs de la chapelle, car on y a découvert aussi un blason portant
un écu "au champ d'or" au-dessus de la tête du priant (peut-être
l'enfeu des Guilloré de Kerlan "d'or à aigle de sable" ou de
Kerpoisson "d'or au lion de gueule"). La fête de Notre-Dame du
Murié se célébrait le 25 mars. En 1698, on répare la verrière du porche
occidental. Vers 1750, la grande verrière du levant est bouchée en partie
pour laisser la place à un grand autel avec retable. La chapelle est délaissée
à partir de 1820 par le recteur Prosper Charbonnier. Sous le ministère de
ce dernier, a lieu la vente et la dispersion de nombreux archives du
prieuré de Batz-sur-Mer. En 1819, un ouragan emporte une partie de la toiture.
Bientôt, les restes de la charpente en cèdre, du lambris et le pavé sont
pillés par les riverains. Les portes et les fenêtres sont murées. La
population transforme l'édifice religieux en carrière et en décharge.
Aussi la Fabrique utilise-t-elle les pierres de la chapelle Saint-Michel
pour murer les portes et les fenêtres de Notre-Dame. Entre 1839
et 1847, les ruines manquent de disparaître : le conseil de
fabrique du Pouliguen propose à la commune de Batz d'en acheter les pierres
pour bâtir au Pouliguen une église en remplacement de la chapelle
Saint-Nicolas édifiée en 1627. Après la fermeture de la chapelle en 1820, le mobilier en
est dispersé. Un haut relief du XVème siècle, en bois polychrome, est
donné au musée Dobrée de Nantes. Une tête de Christ va au musée de la
porte Saint-Michel à Guérande. En 1907, quelques familles possédaient des
éléments du lambris dans leur grenier ;
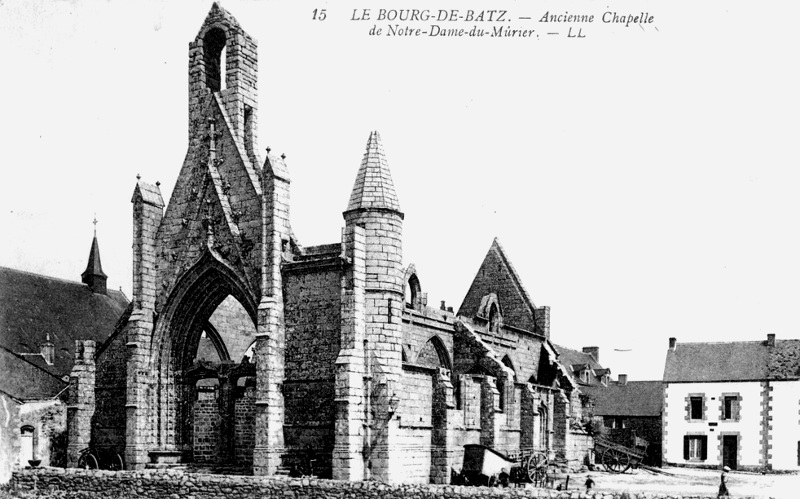
voir
![]() "La chapelle
de Notre-Dame du Murié (ou du Murier) à Batz-sur-Mer"
"La chapelle
de Notre-Dame du Murié (ou du Murier) à Batz-sur-Mer"
![]() l'ancienne
chapelle du Saint-Esprit (XIIIème siècle), située jadis dans le bourg,
non loin du prieuré et de la chapelle du mûrier.
Elle servait aux pensionnaires de l'hôpital et était contiguë aux
bâtiments du Prieuré. Elle est détruite en 1839 et rasée en 1869. On a
découvert des ossements sur son emplacement ;
l'ancienne
chapelle du Saint-Esprit (XIIIème siècle), située jadis dans le bourg,
non loin du prieuré et de la chapelle du mûrier.
Elle servait aux pensionnaires de l'hôpital et était contiguë aux
bâtiments du Prieuré. Elle est détruite en 1839 et rasée en 1869. On a
découvert des ossements sur son emplacement ;
![]() l'ancienne
chapelle Saint-Michel, située au Sud du bourg. Elle est démolie en 1832 ;
l'ancienne
chapelle Saint-Michel, située au Sud du bourg. Elle est démolie en 1832 ;
![]() l'ancienne
chapelle de Saint-Laurent, située jadis au Nord de Saint-Michel. On avait
élevé sur son emplacement un calvaire, entouré de 14 piliers, qui
renfermait dans une grotte, du côté Sud, une statue de la Vierge. Deux
escalier en granit conduisaient à un autel transporté ensuite dans le
cimetière actuel. Le calvaire a été démoli parce qu'il gênait le moulin
à vent voisin. Les matériaux de l'ancienne chapelle devaient servir de
1751 à 1757 à l'édification de la cure sur ce terrain nommé
"Vicarial". En 1838, les pierres de la chapelle
Saint-Laurent sont remployées dans les fondations de deux maisons particulières
de la Grand'Rue ;
l'ancienne
chapelle de Saint-Laurent, située jadis au Nord de Saint-Michel. On avait
élevé sur son emplacement un calvaire, entouré de 14 piliers, qui
renfermait dans une grotte, du côté Sud, une statue de la Vierge. Deux
escalier en granit conduisaient à un autel transporté ensuite dans le
cimetière actuel. Le calvaire a été démoli parce qu'il gênait le moulin
à vent voisin. Les matériaux de l'ancienne chapelle devaient servir de
1751 à 1757 à l'édification de la cure sur ce terrain nommé
"Vicarial". En 1838, les pierres de la chapelle
Saint-Laurent sont remployées dans les fondations de deux maisons particulières
de la Grand'Rue ;
![]() l'ancienne
chapelle de Kerhalan, située jadis au hameau de ce nom ;
l'ancienne
chapelle de Kerhalan, située jadis au hameau de ce nom ;
![]() la
croix des douleurs (IXème siècle), située rue du Général de Gaulle ;
la
croix des douleurs (IXème siècle), située rue du Général de Gaulle ;

![]() le
calvaire de Kervalet (vers le XIIIème siècle), situé rue de la Chapelle ;
le
calvaire de Kervalet (vers le XIIIème siècle), situé rue de la Chapelle ;

![]() la
croix Refuge (vers le XVIIème siècle), située au Grand Traict du Croisic
;
la
croix Refuge (vers le XVIIème siècle), située au Grand Traict du Croisic
;
![]() la
croix (XIXème siècle), située rue des Saulniers au village de Roffiat ;
la
croix (XIXème siècle), située rue des Saulniers au village de Roffiat ;
![]() la
fuie (XVIIème siècle), située rue du 19 Mars 1962. Il s'agit de l'ancien
colombier du manoir de Trémondais (ou Trémonday) ;
la
fuie (XVIIème siècle), située rue du 19 Mars 1962. Il s'agit de l'ancien
colombier du manoir de Trémondais (ou Trémonday) ;
![]() la
maison paludière (XVIIIème siècle), située rue des Marais au village de
Kervalet ;
la
maison paludière (XVIIIème siècle), située rue des Marais au village de
Kervalet ;
![]() le
presbytère (1752), situé rue Maupertuis ;
le
presbytère (1752), situé rue Maupertuis ;
![]() la
fontaine (XIXème siècle), située rue des Tamaris ;
la
fontaine (XIXème siècle), située rue des Tamaris ;
![]() le
moulin de la Falaise (XVIème siècle - fin du XXème siècle), situé route
du Croisic. Ce moulin provient, semble-t-il, de la commune de Guérande où
il a été démonté en 1903 puis remonté en 1925 à cet endroit. Il a été
restauré en 1992 ;
le
moulin de la Falaise (XVIème siècle - fin du XXème siècle), situé route
du Croisic. Ce moulin provient, semble-t-il, de la commune de Guérande où
il a été démonté en 1903 puis remonté en 1925 à cet endroit. Il a été
restauré en 1992 ;
![]() le
moulin (XVIème siècle - 1890), situé Villa Le Prieuré Saint-Georges et
œuvre de l'architecte Georges Lafont ;
le
moulin (XVIème siècle - 1890), situé Villa Le Prieuré Saint-Georges et
œuvre de l'architecte Georges Lafont ;
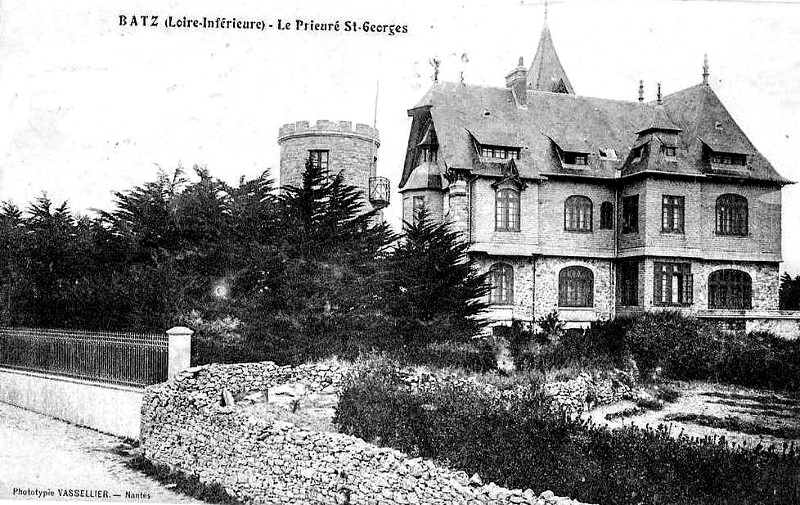
![]() d'autres
moulins : le moulin d'Abbas, les deux moulins de Saint-Michel et le moulin de Beauregard ;
d'autres
moulins : le moulin d'Abbas, les deux moulins de Saint-Michel et le moulin de Beauregard ;
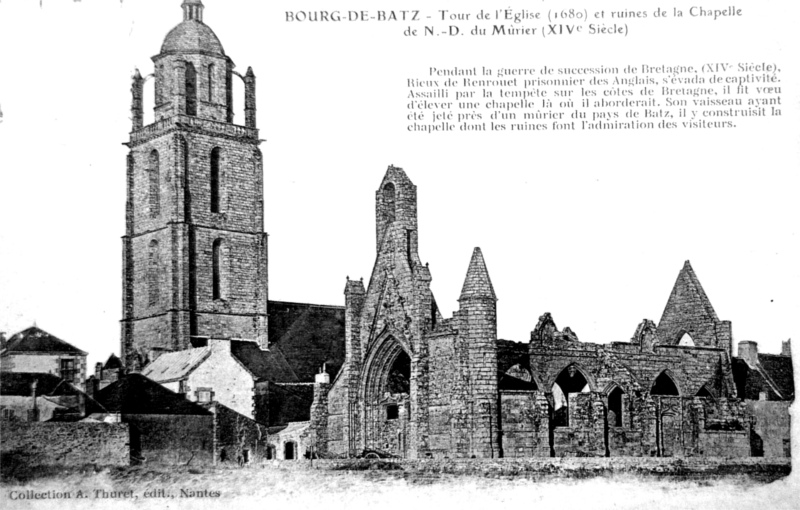
A signaler aussi :
![]() la
Pierre Longue (époque néolithique), située plage Saint-Michel ;
la
Pierre Longue (époque néolithique), située plage Saint-Michel ;
![]() l'ancien
manoir de Kerbouchard, situé à l'Est du bourg. Propriété de la famille Bouchard qui avait leur
enfeu dans l'église paroissiale depuis 1428. Les membres de cette famille
sont demeurés illustres : Alain (auteur des Grandes Chroniques de Bretagne)
et Nicolas (maître-maçon du duc Jean V) ;
l'ancien
manoir de Kerbouchard, situé à l'Est du bourg. Propriété de la famille Bouchard qui avait leur
enfeu dans l'église paroissiale depuis 1428. Les membres de cette famille
sont demeurés illustres : Alain (auteur des Grandes Chroniques de Bretagne)
et Nicolas (maître-maçon du duc Jean V) ;
![]() l'ancien
manoir de Kerdour. Propriété successive des familles Le Pennec, de
Sesmaisons, de Becdelièvre, de Bourmont, Legal, Pétard et Amiau. Il
subsiste un puits et des murailles ;
l'ancien
manoir de Kerdour. Propriété successive des familles Le Pennec, de
Sesmaisons, de Becdelièvre, de Bourmont, Legal, Pétard et Amiau. Il
subsiste un puits et des murailles ;
![]() l'ancien
manoir de Kerlan. Propriété de la famille Guilloré. Il subsiste une fuie,
un puits et des murailles ;
l'ancien
manoir de Kerlan. Propriété de la famille Guilloré. Il subsiste une fuie,
un puits et des murailles ;
![]() l'ancien
manoir de Kerdréon ou Kerdréan (fin du XVème siècle). Propriété
successive des familles Quello, de Combles et
Jacquelot de La Motte (ou de Campzillon). Il est donné en dot à Jeanne de
Laval et il est vendu, en 1685, au profit du Trésor Royal car il
appartenait à des Huguenots. Il est démoli en 1795 et il ne reste que
quelques ruines. Son moulin était celui de la
Masse, aménagé au XIXème siècle par l'architecte André Chauvet ;
l'ancien
manoir de Kerdréon ou Kerdréan (fin du XVème siècle). Propriété
successive des familles Quello, de Combles et
Jacquelot de La Motte (ou de Campzillon). Il est donné en dot à Jeanne de
Laval et il est vendu, en 1685, au profit du Trésor Royal car il
appartenait à des Huguenots. Il est démoli en 1795 et il ne reste que
quelques ruines. Son moulin était celui de la
Masse, aménagé au XIXème siècle par l'architecte André Chauvet ;
![]() l'ancien
manoir de Trémonday. Il conserve une fuie et le cerne d'un moulin. Les
sieurs de Trémonday étaient protestants et l'édifice est rasé suite à
l'Edit de Nantes en 1685. Le seigneur Aubin de Trémonday est enterré dans
le jardin. Il s'agit de la seigneurie des Charault et de Verneuil ;
l'ancien
manoir de Trémonday. Il conserve une fuie et le cerne d'un moulin. Les
sieurs de Trémonday étaient protestants et l'édifice est rasé suite à
l'Edit de Nantes en 1685. Le seigneur Aubin de Trémonday est enterré dans
le jardin. Il s'agit de la seigneurie des Charault et de Verneuil ;
![]() l'ancien
manoir de Kermabon, situé à l'Est du bourg. Propriété de la famille des Trémonday, détenteurs
d'une fuie ou d'un colombier encore bien conservé. Aubin de Trémonday était un
protestant comme les Coligny. Il subsiste un puits encore appelé puits de Kermabon ;
l'ancien
manoir de Kermabon, situé à l'Est du bourg. Propriété de la famille des Trémonday, détenteurs
d'une fuie ou d'un colombier encore bien conservé. Aubin de Trémonday était un
protestant comme les Coligny. Il subsiste un puits encore appelé puits de Kermabon ;
![]() l'ancien
manoir du Drézeuc. Il garde une belle porte romane et appartient aux
Dubochet du Drézeuc ;
l'ancien
manoir du Drézeuc. Il garde une belle porte romane et appartient aux
Dubochet du Drézeuc ;
![]() l'ancien
manoir de Kerhué. Il s'agit de la demeure de la famille des Cramzel,
alliée aux Bouchaud de La Pignonerie et des Hérettes, parents de l'Elvire
de Lamartine ;
l'ancien
manoir de Kerhué. Il s'agit de la demeure de la famille des Cramzel,
alliée aux Bouchaud de La Pignonerie et des Hérettes, parents de l'Elvire
de Lamartine ;
![]() l'ancien
manoir de Kerlan, jadis propriété de Xavier de Courville ;
l'ancien
manoir de Kerlan, jadis propriété de Xavier de Courville ;
![]() l'ancien
Manoir Huguelin, situé dans le bourg. Un vieux portail surmonté d'un
linteau en est le principal ornement ;
l'ancien
Manoir Huguelin, situé dans le bourg. Un vieux portail surmonté d'un
linteau en est le principal ornement ;
![]() l'ancien
manoir de Kerliviny ou du Rouellez (XIVème siècle), situé jadis au-dessus
du village de Kermoisan. Seules une fontaine et une auge rappellent le
souvenir du village et du manoir ;
l'ancien
manoir de Kerliviny ou du Rouellez (XIVème siècle), situé jadis au-dessus
du village de Kermoisan. Seules une fontaine et une auge rappellent le
souvenir du village et du manoir ;
![]() la
citerne (XVIIème siècle), située rue de Trémondais (ou Trémonday). Elle dépendait du
manoir de Trémondais (ou Trémonday) et servait, semble-t-il, a conservé le vin produit
dans la région ;
la
citerne (XVIIème siècle), située rue de Trémondais (ou Trémonday). Elle dépendait du
manoir de Trémondais (ou Trémonday) et servait, semble-t-il, a conservé le vin produit
dans la région ;
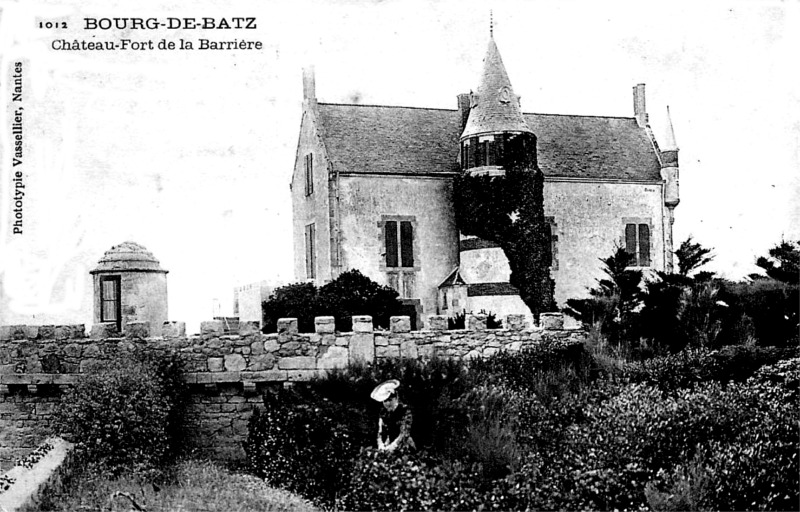
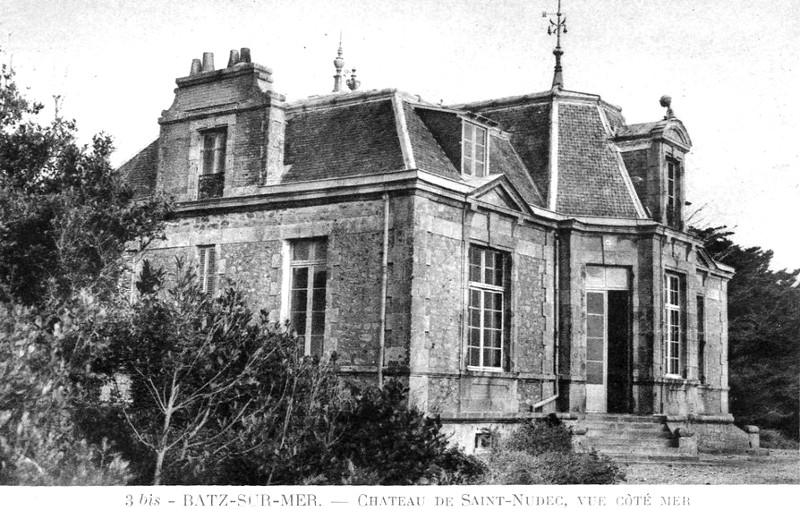
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de BATZ-SUR-MER
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.