|
Bienvenue chez les Badenois |
BADEN |
Retour page d'accueil Retour Canton de Vannes
La commune de Baden ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BADEN
Baden et Larmor sont, semble-t-il, des démembrements de l'ancienne paroisse primitive de Plougoumelen.
Baden dépendait primitivement de la seigneurie de Largouët. Le territoire de Baden compte, sous l'Ancien Régime, près d'une vingtaine de seigneuries différentes mais seules quatre d'entre elles sont vraiment importantes : Lohac, Cardelan, Kergonano et Tréverat (aujourd'hui en Larmor-Baden). Baden s'est séparé de Larmor en 1924.
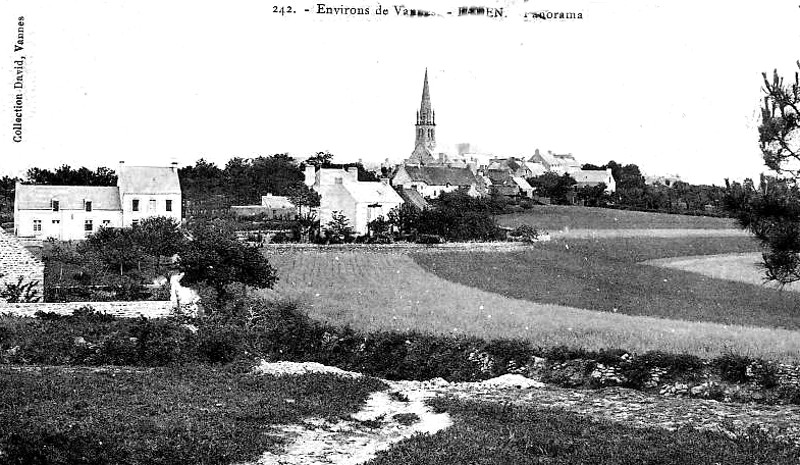
Note 1 : au village de Moustérian ou Moustéran, on remarque quelques vestiges qui passe pour être ceux d'une chapelle de saint Gildas. C'est là, dit-on, que se serait embarqué saint Bieuzy (blessé à mort et se rendant chez l'abbé de Rhuys) dont la "vie" a été écrite qu'en 1659. Il est fort possible qu'il y ait eu à cet endroit un établissement monastique détruit par les Normands au Xème siècle.
Note 2 : Baden est limité au nord par Plougoumelen, à l'ouest par la rivière d'Auray, au sud et à l'est par le golfe du Morbihan. La mer, en s'élançant deux fois par jour contre ses côtes, et en profitant de l'affaissement graduel du sol, a profondément creusé le littoral, comme le témoignent les anses du Blair, de Locmiquel, de Kerdelan. C'est sans doute à cette double cause qu'est due la formation des îles de Breder, Gavriniz, Longue, Radenec, Réno, Séniz, Luhernic, Veizit et Grégan, qui dépendent toujours de son territoire. Dans sa forme actuelle, la commune de Baden possède une superficie de 2571 hectares, dont un tiers environ de landes ; le reste fournit du froment, du seigle et d'excellents pâturages. En 1891, la population est de 2775 habitants, qui sont généralement marins sur la côte et cultivateurs à l'intérieur. Le bourg, situé sur une hauteur, est à 14 kilomètres de Vannes. La période celtique a laissé sur ce sol des traces importantes. On trouve en effet un dolmen ruiné à Crafel ; un autre à Toulvern, fouillé par M. Bain ; un troisième au Couédic, fouillé par M. Hartney ; un quatrième dans l'île Réno, fouillé par M. de Closmadeuc ; un cinquième au Rohello, exploré par le même ; un sixième à Breder, fouillé par M. Dillon. Un dolmen, enfoui sous un grand galgal, dans l'île Longue, n'a été qu'imparfaitement ouvert, et mériterait d'être soigneusement fouillé. Enfin, le dolmen à galerie de Gavriniz, enfoui sous un galgal, et ouvert depuis longtemps, est sans contredit le plus intéressant de tous les dolmens du Morbihan, à cause de la variété et de la quantité de ses signes gravés (Bull. 1884, p. 169, 180. — 1886, p. 63. — Catal. p. 45, 31, 17). La période romaine est signalée par une voie venant de Vannes, passant à Pontper, et se dirigeant sur Locmariaquer ; on peut citer en outre un retranchement situé près de Locmiquel, des statuettes en terre blanche trouvées sous le dolmen de Toulvern, et des briques à rebords rencontrées à Toulindac, à Kergonano et ailleurs. Les Bretons ont occupé ce pays dès le commencement du VIème siècle, et ils y ont maintenu leur langue jusqu'à nos jours. Presque tous les noms de villages sont bretons, comme par exemple Kergonano, Kerdelan, Kerplous, Toulvern, Guern, Trévrat, etc... Au Moustéran, en face de l'Ile-aux-Moines, on remarque quelques vestiges d'une construction, qui passe pour avoir été une chapelle de saint Gildas ; c'est là, dit-on, que se serait embarqué saint Bieuzy, blessé à mort et se rendant auprès de l'abbé de Rhuys. Il est très possible, en effet, que les moines aient eu ici un petit établissement, qui aurait été ruiné par les Normands du Xème siècle, et dont le souvenir serait resté dans le nom même du village de Moustéran. Dès le XIIème siècle, il y avait à Gavriniz une chapelle et un établissement religieux, que la tradition attribue aux Moines rouges ou aux Templiers. Ce qui confirme l'existence d'un couvent en ce lieu, c'est que toutes les sépultures trouvées depuis autour de la chapelle, aujourd'hui ruinée, appartiennent exclusivement à dès hommes adultes. Les cercueils étaient en pierres plates, posées sur champ, et étaient accompagnés de vases à encens. C'est de là que provient un crucifix en cuivre, de style bizantin, remontant au moins au XIIème siècle, et conservé jadis chez M. le Dr de Closmadeuc (Bull. 1812, p. 85. — 1885, p. 134). Au village de Toulvern se rencontrent d'autres ruines, que la tradition locale attribue aussi aux Moines rouges ; mais aucune fouille n'y a été pratiquée (Joseph-Marie Le Mené - 1891).
![]()
PATRIMOINE de BADEN
![]() l'église Saint-Pierre (XIIème siècle), fondée par la famille
Rolland de Cardelan. Cette église est reconstruite en 1835-1836 et entre
1860 et 1864, date à laquelle elle a été complétée par un
clocher avec flèche. Le retable du choeur date du XVIIème siècle. Les seigneurs de Cardelan
avaient autrefois leurs enfeus dans la chapelle Saint-Jean, du côté de
l'Epitre de l'ancienne église ;
l'église Saint-Pierre (XIIème siècle), fondée par la famille
Rolland de Cardelan. Cette église est reconstruite en 1835-1836 et entre
1860 et 1864, date à laquelle elle a été complétée par un
clocher avec flèche. Le retable du choeur date du XVIIème siècle. Les seigneurs de Cardelan
avaient autrefois leurs enfeus dans la chapelle Saint-Jean, du côté de
l'Epitre de l'ancienne église ;
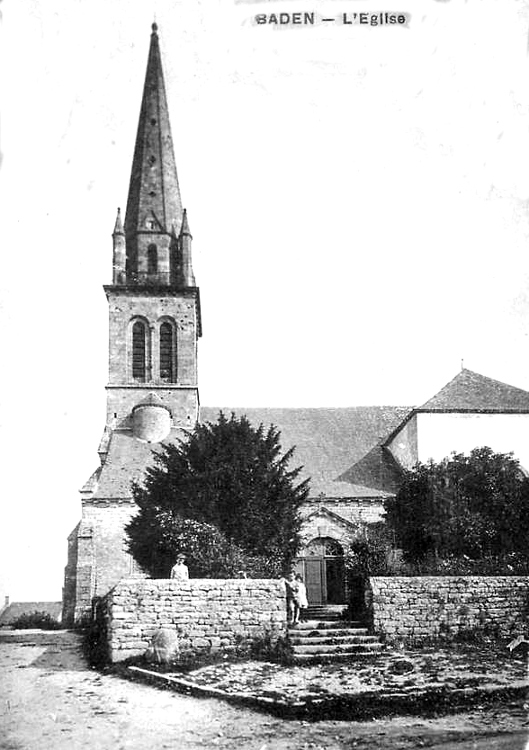
Nota : L'église paroissiale, dédiée à saint Pierre-aux-Liens, avait deux chapelles : celle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, du côté de l'évangile, et celle de Saint-Jean, du côté de l'épître ; la première renfermait les enfeus de Kergonano et de Toulvern, la seconde ceux des seigneurs de Kerdelan. Cette église, tombant de vétusté, fut reconstruite en 1835 et 1836, en forme de croix latine, avec deux bas-côtés. Le vieux clocher, ayant été démoli plus tard, pour élargir un chemin, l'église prit une forme trapue et trop courte. La nouvelle tour, surmontée d'une élégante pyramide, le tout en belles pierres de taille, s'aperçoit de très loin. Les chapelles frairiennes sont : — 1. Saint-Mériadec, au village de ce nom. — 2. Saint-Michel, au village de Locmiquel. — 3. Notre-Dame, au village de Penvern ou Penmern. — 4. Saint-Julien, près du village de Lohac, aujourd'hui en ruine. Le quartier de Larmor, voisin de Locmiquel, ayant construit une chapelle, obtint, le 11 janvier 1860, son érection en succursale. Depuis, on y a bâti une église paroissiale, en forme de croix latine, qui a été bénite le 29 juillet 1880. Le quartier fait toujours partie de la commune de Baden. Il y avait, en outre, des chapelles privées aux châteaux de Kergonano, de Kerdelan et de Bois-bas. Les chapellenies étaient : — 1. Celle de Saint-Julien, fondée vers 1660 par les seigneurs de Lohac. — 2. Celle de Sainte-Marguerite, fondée en 1695 par la dame de Kerdelan. — 3. Celle de Notre-Dame, fondée par Jean Tatibouet. — 4. Celle des soeurs Louédec, desservie au maître-autel. — 5. Celle du Rosaire, fondée par N. Bréjan. Le recteur était à la nomination du pape ou de l'évêque, suivant le mois de la vacance. Il dîmait à la 33ème gerbe, et, en 1756, son revenu net était évalué à 1,200 livres. Baden dépendait de la seigneurie de Largoet, de la sénéchaussée d'Auray et du territoire ecclésiastique de Vannes. En 1790, il fut érigé en commune, du canton d'Arradon et du district de Vannes. Son recteur, Guillaume Jéhanno, refusa le serment en 1791 et dut se cacher l'année suivante. La révolution vendit la dotation des chapellenies, une métairie appartenant à la fabrique et une prairie dépendant de la cure. La population, poussée à bout, fournit un certain nombre de volontaires à la Chouannerie. En 1801, Baden fut rattaché au canton de Vannes-ouest, ou de Saint-Pierre : ce qui fut accepté par l'Evêque en 1802 (Joseph-Marie Le Mené - 1891).
Voir aussi
![]() "L'histoire de la paroisse de Baden et ses recteurs"
"L'histoire de la paroisse de Baden et ses recteurs"
![]() la chapelle Saint-Mériadec (XVIIIème siècle),
située au village de Mériadec et restaurée au
XIXème siècle (en 1812 et en 1856). Il s'agit d'un édifice de forme
rectangulaire et couvert d'un lambris. Une peinture et une statue
anciennes représentent saint Mériadec avec mitre et crosse. Cette chapelle est aussi
dédiée à saint Isidore ;
la chapelle Saint-Mériadec (XVIIIème siècle),
située au village de Mériadec et restaurée au
XIXème siècle (en 1812 et en 1856). Il s'agit d'un édifice de forme
rectangulaire et couvert d'un lambris. Une peinture et une statue
anciennes représentent saint Mériadec avec mitre et crosse. Cette chapelle est aussi
dédiée à saint Isidore ;

![]() la chapelle Notre-Dame
(XVème, XVIIIème et XIXème siècles), située à Penmern,
restaurée aux XVIIIème et XIXème siècles. Les contreforts et les portes à accolade semblent remonter au XVème
siècle. Elle possède un retable du début du XXème siècle dont la peinture
représentant l'Assomption, oeuvre du peintre
Pobéguin de Vannes, date de 1857. L'église abrite aussi une peinture
intitulée "Les Pèlerins d'Emmaüs", oeuvre de Gabriel Girodon (1884-1941), et
plusieurs statues : une Pietà, la Vierge à l'Enfant (XVIème siècle),
saint Gildas et saint Bruno. Cette dernière statue proviendrait
de l'ancienne chapelle, aujourd'hui disparue, du château de Cardelan (ou
Kerdelan) ;
la chapelle Notre-Dame
(XVème, XVIIIème et XIXème siècles), située à Penmern,
restaurée aux XVIIIème et XIXème siècles. Les contreforts et les portes à accolade semblent remonter au XVème
siècle. Elle possède un retable du début du XXème siècle dont la peinture
représentant l'Assomption, oeuvre du peintre
Pobéguin de Vannes, date de 1857. L'église abrite aussi une peinture
intitulée "Les Pèlerins d'Emmaüs", oeuvre de Gabriel Girodon (1884-1941), et
plusieurs statues : une Pietà, la Vierge à l'Enfant (XVIème siècle),
saint Gildas et saint Bruno. Cette dernière statue proviendrait
de l'ancienne chapelle, aujourd'hui disparue, du château de Cardelan (ou
Kerdelan) ;

![]() la chapelle Saint-Michel (XVIIIème siècle), située
au village de Locmiquel. Il s'agit d'une construction du XVIIIème siècle,
en forme de croix latine. Ses fondations dateraient du
XIIème siècle. La chapelle abrite
des ex-voto ;
la chapelle Saint-Michel (XVIIIème siècle), située
au village de Locmiquel. Il s'agit d'une construction du XVIIIème siècle,
en forme de croix latine. Ses fondations dateraient du
XIIème siècle. La chapelle abrite
des ex-voto ;
![]() les croix de Celino (XVIIIème siècle), de Lohéac, de Saint-Julien,
de Kergonano, de Penmern, Mané-er-Groéz ;
les croix de Celino (XVIIIème siècle), de Lohéac, de Saint-Julien,
de Kergonano, de Penmern, Mané-er-Groéz ;
![]() le château de Kergonano (XVIIème
siècle). Siège d'une ancienne seigneurie appartenant successivement aux
familles Baden, Loënan ou Laouënan (à la fin du XIVème siècle), et Dondel (du
XVIIIème jusqu’au XXème siècle, suite au mariage de Marie Hyacinthe
de Laouënan avec Pierre Dondel), puis à un banquier
belge de Maare (en 1912) et à la famille Duquesne (depuis 1979). On
mentionne Silvestre Louenan en 1427, Jehan Levenan en 1464 et Jehan Louenan
en 1481. Il possédait autrefois une chapelle privée, disparue vers 1920 ;
le château de Kergonano (XVIIème
siècle). Siège d'une ancienne seigneurie appartenant successivement aux
familles Baden, Loënan ou Laouënan (à la fin du XIVème siècle), et Dondel (du
XVIIIème jusqu’au XXème siècle, suite au mariage de Marie Hyacinthe
de Laouënan avec Pierre Dondel), puis à un banquier
belge de Maare (en 1912) et à la famille Duquesne (depuis 1979). On
mentionne Silvestre Louenan en 1427, Jehan Levenan en 1464 et Jehan Louenan
en 1481. Il possédait autrefois une chapelle privée, disparue vers 1920 ;
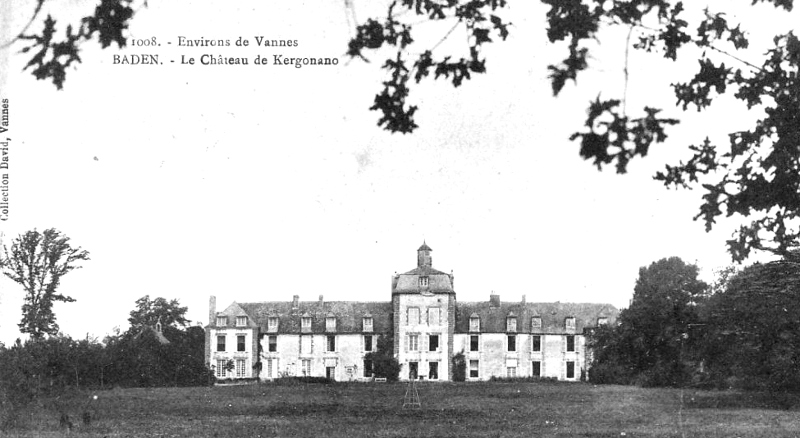
![]() l'ancien
château de Kerplouz ou Kerplous, en ruine dès 1863 ;
l'ancien
château de Kerplouz ou Kerplous, en ruine dès 1863 ;
![]() le château de Rohello (1850), édifié
entre 1850 et 1856 par le vicomte de
Gouvello. L'édifice a été cédé en 1879 au comte de l'Ecuyer (Louis
l'Ecuyer de la Papotière, époux de Lucie du Fos de Méry). L'édifice devient
ensuite la propriété d'Anne de l'Ecuyer (née en 1880) et épouse du vicomte
Octave de Beaufranchet ;
le château de Rohello (1850), édifié
entre 1850 et 1856 par le vicomte de
Gouvello. L'édifice a été cédé en 1879 au comte de l'Ecuyer (Louis
l'Ecuyer de la Papotière, époux de Lucie du Fos de Méry). L'édifice devient
ensuite la propriété d'Anne de l'Ecuyer (née en 1880) et épouse du vicomte
Octave de Beaufranchet ;
![]() le manoir de Kerdelan ou de Cardelan (XVème siècle),
propriété semble-t-il de Guillaume de Keralbault (en 1420), puis de
la famille Rolland (jusqu’en 1536) et de la famille Keralbaud ou
Keralbault. Les seigneurs de Cardelan avaient leurs enfeus
dans la chapelle saint Jean, du côté de l'Epitre, dans l'ancienne église
paroissiale saint Pierre-aux-Liens de Baden détruite en 1835. Ce manoir possédait autrefois une chapelle privée. A la fin du
XVIIème siècle, Kerdelan représente un domaine de 19 tenues, 5 métairies
et plusieurs moulins. Le manoir en ruine
appartient aujourd'hui à la famille Guillemot ;
le manoir de Kerdelan ou de Cardelan (XVème siècle),
propriété semble-t-il de Guillaume de Keralbault (en 1420), puis de
la famille Rolland (jusqu’en 1536) et de la famille Keralbaud ou
Keralbault. Les seigneurs de Cardelan avaient leurs enfeus
dans la chapelle saint Jean, du côté de l'Epitre, dans l'ancienne église
paroissiale saint Pierre-aux-Liens de Baden détruite en 1835. Ce manoir possédait autrefois une chapelle privée. A la fin du
XVIIème siècle, Kerdelan représente un domaine de 19 tenues, 5 métairies
et plusieurs moulins. Le manoir en ruine
appartient aujourd'hui à la famille Guillemot ;
![]() le manoir du Bois-Bas
(XV-XVIème siècle), propriété des familles
Malestroit, Le Doux (en 1535), Renaud, Lucas, Le Douarn, Le
Meilleur (au XVIIème siècle), La Chasse (en 1775), puis Jacques Le Rohellec. Le manoir a été acheté en 1960
par M. Jean Duthoo et Melle de Bruc de Montplaisir. Un calvaire
en pierre précède l'entrée. Il possède une chapelle privée et une
tour-escalier à l'arrière du manoir ;
le manoir du Bois-Bas
(XV-XVIème siècle), propriété des familles
Malestroit, Le Doux (en 1535), Renaud, Lucas, Le Douarn, Le
Meilleur (au XVIIème siècle), La Chasse (en 1775), puis Jacques Le Rohellec. Le manoir a été acheté en 1960
par M. Jean Duthoo et Melle de Bruc de Montplaisir. Un calvaire
en pierre précède l'entrée. Il possède une chapelle privée et une
tour-escalier à l'arrière du manoir ;
![]() le
manoir de Lohac. Siège d'une ancienne seigneurie appartenant à la famille
Quelen en 1427, Du Dresnay (en 1477, suite au mariage de Jean du Dresnay
avec Jeanne de Quelen), Marie du Dresnay, épouse de Pierre de Coat en Drez (en
1619) et Vacher en 1640 ;
le
manoir de Lohac. Siège d'une ancienne seigneurie appartenant à la famille
Quelen en 1427, Du Dresnay (en 1477, suite au mariage de Jean du Dresnay
avec Jeanne de Quelen), Marie du Dresnay, épouse de Pierre de Coat en Drez (en
1619) et Vacher en 1640 ;
![]() le
manoir de Toulven. Siège d'une ancienne seigneurie appartenant à la
famille Loénan ou Laouënan de 1426 à 1536. Il est remplacé entre 1809 et 1852 par un logis de
ferme ;
le
manoir de Toulven. Siège d'une ancienne seigneurie appartenant à la
famille Loénan ou Laouënan de 1426 à 1536. Il est remplacé entre 1809 et 1852 par un logis de
ferme ;

![]() la fontaine (1778), située près de la chapelle
Saint-Mériadec ;
la fontaine (1778), située près de la chapelle
Saint-Mériadec ;
![]() les vestiges des manoirs de
Kervernir, Lanester, Langario ;
les vestiges des manoirs de
Kervernir, Lanester, Langario ;
![]() le puits de Toulindac (1836) ;
le puits de Toulindac (1836) ;
![]() les fermes de Kerbourleven (XVIIème siècle), de Keryhuel, de Parun,
Tourlavec, Toul Broc’h, Kervernir ;
les fermes de Kerbourleven (XVIIème siècle), de Keryhuel, de Parun,
Tourlavec, Toul Broc’h, Kervernir ;
![]() une chaumière du XVIIème siècle ;
une chaumière du XVIIème siècle ;
![]() le moulin à marée de Pomper
(XVIIIème siècle) ;
le moulin à marée de Pomper
(XVIIIème siècle) ;
![]() les moulins à eau de Toulvern, du Pont-Neuf ;
les moulins à eau de Toulvern, du Pont-Neuf ;
A signaler aussi :
![]() de nombreux monuments mégalithiques à Crafel, Toulvern, Le
Couëdic, l'île Reno, Le Rohello, Lanester ;
de nombreux monuments mégalithiques à Crafel, Toulvern, Le
Couëdic, l'île Reno, Le Rohello, Lanester ;
![]() le dolmen de Couëdic (époque néolithique) ;
le dolmen de Couëdic (époque néolithique) ;
![]() le tumulus de Toulvern ;
le tumulus de Toulvern ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de BADEN
Les seigneuries de Baden étaient :
1. Bois-bas, vers l'est, aux Renaud, Lucas et Le Douarin.
2. Bourgerel, vers l'est, aux Guydo en 1640.
3. Brangon. 4. Bréafort.
5. Crapel. 6. Kercadio.
7. Kerdelan, aux Rolland, puis en 1536 aux Keralbaut.
8. Kergonano, aux Baden, puis aux Loénan et aux Dondel.
9. Kerhervé. 10. Kerplous, vers l'est.
11. Kerverner. 12. Kervouren. 13. Langario.
14. Locqueltas, au sud-est.
15. Lohac, manoir du XVIème siècle, aux Vacher en 1640.
16. Parun (le), vers le sud-ouest, au Meilleur en 1630.
17. Port-Blanc (le), en face de l'Ile-aux-Moines.
18. Toulvern, au sud, aux Loénan dès 1426.
19. Trévrat, vers le sud, aux Keralbaut en 1700.
Le duc Jean V possédait le moulin de Pontper, et en 1430 il le donna au chapitre de Vannes, comme gage d'une rente de 50 livres (de Joseph-Marie Le Mené).
A la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles à Baden : Thomas d'Aradon et Allain Legal (bourg de Baden), Ollivier Louenan (Kerihuel), Jehan Le Nynic (Lanesterre), Silvestre Louenan et son fils Jehan (Lanesterre), le sieur de Peillac (le manoir Diben et de Trévrat, en Kereden), Jehan Le Mirael et le sieur de Breneant (Loqueltas), Rolland Le Pouldou (Bourgerel), Silvestre Louenan (Bréafort), la dame de Bazvallan (le manoir de Kergananou, en Kercadio), Silvestre de Quelen (Kerbourleven, frairie de St Julien), Henry de Quelen et son fils Jouachim (Lohac), Silvestre Boteven (Briel), Ponsal (le manoir de Kerisper, en Kerhervé).
A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 7 nobles de Baden :
![]() Jehan,
sieur de PEILLAC (700 livres de revenu) ;
Jehan,
sieur de PEILLAC (700 livres de revenu) ;
![]() Ollivier
KERAL (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade
(casque), armé d'une vouge et d'une épée ;
Ollivier
KERAL (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade
(casque), armé d'une vouge et d'une épée ;
![]() Jehan
LEVENAN (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade
(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;
Jehan
LEVENAN (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade
(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;
![]() Thomas
du ROCHELLO (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade
(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;
Thomas
du ROCHELLO (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade
(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;
![]() Ollivier
PRAMOUR (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade
(casque), comparaît armé d'un arc et d'une épée ;
Ollivier
PRAMOUR (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade
(casque), comparaît armé d'un arc et d'une épée ;
![]() Yves
de QUELEN, mineur (200 livres de revenu), remplacé par Jehan Kerverret :
porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une
vouge et d'une épée ;
Yves
de QUELEN, mineur (200 livres de revenu), remplacé par Jehan Kerverret :
porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une
vouge et d'une épée ;
![]() Jehan
ROLLAND, sieur de Kerdelan ou Cardélan (300 livres de revenu) : excusé ;
Jehan
ROLLAND, sieur de Kerdelan ou Cardélan (300 livres de revenu) : excusé ;
A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 13 nobles de Baden :
![]() Jehan,
seigneur de PEILLAC (700 livres de revenu), remplacé par Jehan de la
Rivière : comparaît en archer ;
Jehan,
seigneur de PEILLAC (700 livres de revenu), remplacé par Jehan de la
Rivière : comparaît en archer ;
![]() Jehan
ROLLAND, tuteur de Jacques Rolland (400 livres de revenu), remplacé par
Simon : comparaît en archer ;
Jehan
ROLLAND, tuteur de Jacques Rolland (400 livres de revenu), remplacé par
Simon : comparaît en archer ;
![]() Jehan
du DRESNAY (200 livres de revenu) ;
Jehan
du DRESNAY (200 livres de revenu) ;
![]() Jehan
LOUENAN (40 livres de revenu), remplacé par Jehan Kerpezron : porteur d'une
brigandine, comparaît en archer ;
Jehan
LOUENAN (40 livres de revenu), remplacé par Jehan Kerpezron : porteur d'une
brigandine, comparaît en archer ;
![]() Thomas
PRAMOUR (6 livres de revenu) : comparaît armé d'une javeline ;
Thomas
PRAMOUR (6 livres de revenu) : comparaît armé d'une javeline ;
![]() Ollivier
KERGAL (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
Ollivier
KERGAL (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
![]() Les
héritiers Thomas de ROHELLO (7 livres de revenu), remplacés par Barnabé
Lorveloux : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une vouge ;
Les
héritiers Thomas de ROHELLO (7 livres de revenu), remplacés par Barnabé
Lorveloux : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une vouge ;
![]() Louis
du GARFF ou GAFF (20 livres de revenu), remplacé par Mathelin de la Barre :
porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une javeline ;
Louis
du GARFF ou GAFF (20 livres de revenu), remplacé par Mathelin de la Barre :
porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une javeline ;
![]() Eon
de PEILLOUR (20 livres de revenu) ;
Eon
de PEILLOUR (20 livres de revenu) ;
![]() Thomas
LE BOURSEC (7 livres de revenu), remplacé par son fils Ollivier :
comparaît armé d'une pertuisane ;
Thomas
LE BOURSEC (7 livres de revenu), remplacé par son fils Ollivier :
comparaît armé d'une pertuisane ;
![]() la
veuve Jehan MADIO (40 livres de revenu), remplacé par Guyon Madio : porteur
d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
la
veuve Jehan MADIO (40 livres de revenu), remplacé par Guyon Madio : porteur
d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
![]() Jehan
MASSON (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
Jehan
MASSON (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
![]() Henry
LOUENAN (25 livres de revenu), remplacé par Ollivier Le Bodoiec ou Le
Bodors : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
Henry
LOUENAN (25 livres de revenu), remplacé par Ollivier Le Bodoiec ou Le
Bodors : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
© Copyright - Tous droits réservés.