|
Bienvenue chez les Vannetais |
TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DE VANNES |
Retour page d'accueil Retour Ville de Vannes
La commune de Vannes ( |
LE VANNES HISTORIQUE
L'antique capitale des Venètes, le siège de leur commerce et de leur sénat, n'a laissé que des souvenirs assez vagues dans l'histoire. On ignore son nom primitif. Sa situation même est incertaine : les uns la placent à Locmariaker, les autres à Vannes. Les premiers paraissent avoir raison : ils s'appuient sur l'existence des nombreux et gigantesques monuments celtiques de Locmariaker, sur la nécessité pour un peuple maritime d'avoir un centre commercial au bord de la mer, et sur l'impossibilité de remonter alors jusqu'à Vannes avec de grands navires, le golfe du Morbihan n'étant pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Mais sous la domination romaine, la capitale des Venètes était certainement la ville actuelle de Vannes, appelée alors Darioritum. C'est de là que partaient six voies romaines, se dirigeant, la 1ère vers Locmariaker, la 2ème vers Hennebont, la 3ème vers Corseul, avec embranchement sur Carhaix, la 4ème vers Rennes, la 5ème vers Rieux, et la 6ème vers Arzal, avec embranchement sur Port-Navalo. Vers l'an 140, le géographe Claude Ptolémée, d'Alexandrie, s'exprime comme il suit, dans la description de la Gaule : « Le rivage occidental, au-dessous des Ossismiens, est occupé par les Venètes, dont la ville est Darioritum, ou Dariorigum ». Une carte routière, rapportée communément au IIIème siècle, copiée au moyen âge, et possédée longtemps par la famille de Peutinger, mentionne la même ville sous le nom légèrement altéré de Dartoritum. A la fin du IVème siècle, ce nom disparut pour faire place à celui de Vennes ou Vannes, tiré du nom du peuple Venète : pareil changement se faisait alors dans toutes les cités gauloises. Les Bretons ont à peine modifié cette appellation, dont ils ont fait Wenet ou Guéned. C'est cette ville qu'il s'agit d'étudier ici, en examinant successivement ses murs, ses églises, ses châteaux, ses établissements, etc.... Vannes comprend trois parties distinctes : - 1° la ville close, encore entourée de son enceinte fortifiée, dominée par sa cathédrale, et divisée en rues sombres et tortueuses, où l'on retrouve le caractère d'une cité bretonne du moyen âge ; - 2° le quartier de Saint-Patern, presque aussi vieux que la ville, renfermant de nombreuses maisons en bois du XVIème siècle, et de plus, la préfecture, les casernes, la gare, etc. ; - 3° le quartier de Saint-Salomon, comprenant toute la partie de Vannes située à l'ouest des murs, avec ses divers établissements. Trois plans topographiques donnent la configuration de ces trois parties, et sont nécessaires pour en suivre la description détaillée. Leur réunion donne le plan général de la ville. Ces préliminaires posés, entrons en matière.
I. Première enceinte
Vannes
était une ville ouverte, sans fortifications, comme beaucoup
d'autres cités de la Gaule. Mais en 276, les barbares
de la Germanie, ayant traversé le Rhin, dévastèrent une soixantaine de
villes. L'empereur Probus les tailla en pièces et repoussa le reste au
delà du fleuve. Puis,
pour réparer les ravages et en prévenir le retour, dans
une certaine mesure, il ordonna aux villes frontières de
relever, et au besoin de restreindre leur enceinte ; il permit
aux autres villes d'en faire autant, et d'employer aux
remparts les pierres des tombeaux anciens, qui étaient trop éloignés
de la cité pour être protégés. Une
foule de cités de la Gaule se mirent immédiatement à
l'oeuvre, comme le prouvent les débris de sculptures d'autels,
d'inscriptions, etc... englobés dans la base de leurs murs. Tout dans
ces débris annonce le Ier et le IIème siècles et le commencement du IIIème
(Voir M. de Caumont). Il paraît que la ville de Dariorit éleva ses remparts à cette époque,
c'est-à-dire à la fin du IIIème siècle ou au commencement
du IVème. Ces murs
primitifs, si l'on en juge par les vestiges
subsistants, formaient un triangle à pointes émoussées,
dont la cathédrale actuelle occupe à peu près le centre. Le
côté nord du triangle longe la rue du Mené, et les deux autres
viennent se rejoindre sur les Lices (Voir le plan). A
la base des murs, principalement au nord et à l'ouest, on voit encore
plusieurs assises de pierres d'assez grand
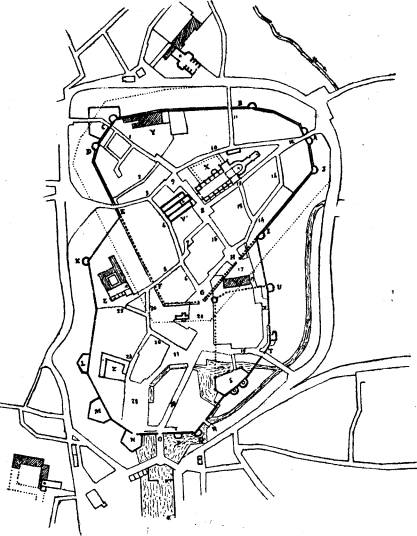
VANNES - Saint-Pierre
appareil, jusqu'à la hauteur de deux mètres cinquante centimètres, et au-dessus on remarque des pierres de petit appareil, séparées par des cordons de briques. Cette première enceinte a subi dans le cours des âges de nombreuses modifications : les murs ont été en partie refaits, les douves élargies, les tours et les portes relevées au fur et à mesure des besoins, mais sans jamais toucher au plan général des remparts. A la chute de l'empire en 409, Vannes fit partie de la Confédération Armoricaine, et son gouverneur Eusèbe portait en 500 le titre de roi. Vers le même temps elle accepta l'alliance ou plutôt la suprématie des Francs. — Elle avait un évêque depuis 465. Le comte breton Waroch II s'en empara en 577, et la transmit à ses successeurs. Pépin la reprit en 753, et y mit des comtes francs. Nominoé, en 826, y rétablit l'influence bretonne jusqu'à l'incendie de la ville par les Normands en 919. Privée désormais de ses comtes particuliers, Vannes releva directement des ducs de Bretagne, et jouit sous leur gouvernement d'une paix de quatre siècles. Dans cet intervalle, on croit que le duc Jean Ier (1237-1286) fit exécuter divers travaux aux murs de la ville ; dans tous les cas, son fils Jean II (1286-1305) y fit faire des réparations importantes, comme le constatent diverses quittances données à ses exécuteurs testamentaires. La portion du mur E F, voisine du couvent des Cordeliers, portait en 1400 le nom de mur Sarrasin, en mémoire de ces deux princes, qui avaient pris part à la croisade de 1270 contre les infidèles de Tunis. A l'ouverture de la guerre de Succession, en 1341, la ville de Vannes se déclara pour Jean de Montfort, qui lui semblait avoir le meilleur droit. Par suite, Charles de Blois vint l'assiéger dès le commencement de 1342 ; il donna un assaut à la ville et livra un rude combat auprès d'une des portes, où les deux partis perdirent beaucoup de monde. Les assiégés demandèrent une trêve pour le lendemain, et le Conseil des bourgeois résolut de se rendre. Geoffroy de Malestroit, qui commandait la garnison, n'ayant pu les détourner de ce dessin, sortit par une porte, pendant qu'on traitait à une autre, et se retira à Hennebont. Charles de Blois entra dans la ville, pourvut à la sûreté de la place, et partit au bout de cinq jours pour Carhaix. Quelque temps après, Robert d'Artois, que la comtesse de Montfort avait envoyé en Angleterre pour en ramener des renforts, débarqua près de Vannes, et résolut de reprendre cette place. A la tête de 10.000 hommes, il attaqua les barrières, sans pouvoir les briser ; à la nuit il fit allumer des feux devant les deux principales portes de la ville, et les battit furieusement, pour y attirer toute la garnison. Pendant ce temps, Gautier de Mauny et le comte de Quenfort s'approchèrent d'un quartier abandonné, escaladèrent la muraille avec leurs troupes, et prirent à dos les assiégés. La lutte devint alors impossible : une partie de la garnison réussit à s'échapper ; le reste tomba entre les mains des vainqueurs, et la ville rentra sous l'obéissance du comte de Montfort. Cependant Hervé de Léon et Olivier de Clisson, irrités d'avoir été surpris et chassés de Vannes, résolurent de réparer leur honneur en rentrant dans la place. Ils prirent si bien leurs mesures, qu'ils réunirent 12.000 hommes, et se présentèrent inopinément devant la ville. Robert d'Artois n'eut pas le temps de solliciter des secours ; il se défendit néanmoins avec une bravoure admirable, mais il ne put empêcher les ennemis de forcer les barrières et les portes. La ville fut reprise, et Robert d'Artois y reçut une blessure dont il mourut en retournant en Angleterre. Le roi Edouard III, sensiblement affligé de la mort de son lieutenant, jura de le venger, et vint en personne assiéger Vannes, en novembre 1342. C'était le quatrième siège de l'année. En y arrivant, il livra un terrible assaut, qui fut vaillamment soutenu pendant six heures. Bientôt le roi de France, Philippe VI de Valois, vint en Bretagne et s'avança jusqu'à Ploërmel. Une lutte décisive allait peut-être avoir lieu, quand deux légats du Pape Clément VI intervinrent entre les belligérants, et obtinrent une trêve de trois ans, qui fut signée à Malestroit le 19 janvier 1343. Le siège de Vannes fut levé et la ville remise provisoirement aux cardinaux légats (D. Morice, Histoire de Bretagne, I, 258). En 1347, Charles de Blois ayant été fait prisonnier à la Roche-Derrien, fut conduit à Vannes, et de là expédié en Angleterre l'année suivante. Il en revint en 1356, mais il perdit la vie à la funeste bataille d'Auray, livrée le 29 septembre 1364, et son concurrent, Jean de Montfort, fut proclamé duc de Bretagne.
II. Seconde enceinte
Les
quatre sièges subis par Vannes avaient, on le comprend, endommagé ses portes
et ses murailles. Le nouveau duc Jean IV, qui avait pour cette ville une
affection particulière, et qui la trouvait plus centrale que Nantes et Rennes,
résolut d'y faire de grosses réparations, d'agrandir son enceinte vers le
port, et d'y construire un château ducal sous le nom de l'Hermine. L'entreprise
était considérable et demandait de longues années. La porte A donnant sur le
faubourg Saint-Patern fut refaite à neuf, et flanquée de deux tours
monumentales, avec pont-levis et accessoires. La portion du mur I J, parallèle
à la rue des Vierges, fut retouchée et perdit les traces de la construction
gallo-romaine. C'est à partir de la tour I que la nouvelle enceinte prit la
direction du midi. Cette portion de mur était achevée en 1373, quand le duc
dut quitter la Bretagne pour se réfugier en Angleterre, d'où il ne revint que
six ans après. Un acte de fondation, du 20 mars 1374 (N. S. 1375), renferme à
ce sujet quelques détails intéressants. — « Sachent touz que par notre
court de Venues en droit personalment établi Mr Geffroy Talevaz, presbtre,
souschantre de l'église de Saint-Père de Vennes, et recteur de l'église
St-Salemon, cognut et confessa que Mr. Phélipes Talevaz, presbtre, son oncle,
donna autrefois au chapitre de la dite église, pour son anniversaire, une rente
de trente et deux soulz, levablo sur son manoir et herbregement, où il solcit
demorer en la ville de Vennes, sur la rue par où les cherrètes soleint aller
du port de Vennes à la porte St-Pater, et sur les courtilz et exues devant et
derrière et autres appartenances dou dit herbregement, par lequel herbregement
est maintenant la closture de la dite ville, par quoy les courtilz dou dit
herbregement sont demorez dehors la d. closture, et les maisons et places
demorez par dedans, les d. maisons sises entre un herbregement qui fut à
Geffroy de Clèce (V), et ores est à Geffroy Denis, par raison de sa femme,
d'une part, et un autre herbregement et place, qui jadis fut à Eon L'orfèvre
et ores est à Guillet Collin et ses fraresches, d'autre part... Laquelle
donnoison celi Mr Geffroy, comme principal hoir de son dit oncle, a approuvé,
loé et ratifié. — Et en oultre cognut
et confessa avoir esleu sa sépulture, quand le cas avendra, en la d. église,
jouste celle de son d. oncle, et a donné
et donne au d. chapitre, pour son anniversaire avoir en la d. église, après
son déceis, chacun an, perpétuelment autres trente et deux soulz de
rente, sur le dit manoir et herbregement
et sur les dites appartenances... » (Chapitre. Fondations. G.) Les
travaux de la nouvelle enceinte paraissent avoir été interrompus pendant l'éloignement du duc. Après
son retour en 1379, il reprit son plan. Dès
le 22 novembre 1380, il donna à l'abbaye de St-Gildas
de Rhuys son moulin de Pencastel en Arzon,
pour avoir en échange le moulin et l'étang situés au midi de la
ville, parce qu'il en avait besoin pour continuer les remparts et pour protéger
son futur château de l'Hermine. Peu après, il eut besoin du four de Calmont,
appartenant à la même abbaye, et il
s'engagea à payer en retour une somme annuelle de deux livres sur sa recette d'Auray.
Sans parler ici de la construction
du château de l'Hermine dont l'histoire se
trouvera plus loin, on peut dire que les travaux
se continuèrent par le sud et se terminèrent à l'ouest, de manière
à renfermer le couvent des Cordeliers. Une
note, tirée d'un registre de ce couvent, donne une date précise : Conventus
Sancti Francisci Venetensis, anno 1385, multum fuit amplificatus a
generosissimo principe Johanne IV. La nouvelle muraille, qui enfermait ainsi le couvent dans
la ville
et qui aboutissait à la porte de Saint-Salomon (E), rendait inutile la portion des murs sarrasins situés entre
E
et F. Le duc céda les douves de cette portion de murailles aux
Cordeliers, en toute propriété, et contribua de cette façon à
l'agrandissement du monastère. Les
vieilles murailles de la ville, du côté du sud, étant devenues inutiles,
furent démolies. De nouvelles douves furent
creusées le long des murs neufs, et les déblais purent servir à
combler les anciens fossés et à exhausser le sol de la nouvelle enceinte. En
1483, des charretées de décombres furent retirées du cloître de la cathédrale,
et portées « près les murs de la ville, près du chasteau de l'Ermine, vers
la porte de Calmont » (Comptes). La faible hauteur
du sol dans la nouvelle ville permettait à la mer de refouler le
ruisseau de la Garenne,
et de pénétrer par les douves jusqu'à Saint-Nicolas et à la rue du Mené
d'un côté et jusqu'à la porte Saint-Salomon de l'autre. Après l'extinction
des ducs de Bretagne et l'union de la province à la France, la communauté de
la ville de Vannes dut prendre à sa charge l'entretien des remparts. C'est
ainsi qu'en 1576, au moment de la révolte du duc d'Alençon et des Malcontents,
on la vit ordonner de réparer les murs et de curer les douves. Pendant la
Ligue, sous l'inspiration du duc de Mercœur, on construisit deux bastions ou éperons
de forme pentagonale, pour le service de l'artillerie. Le bastion L, dit de Kaer
et de Brozillay, fut achevé en 1593, suivant une inscription contemporaine. Le
bastion C de la Porte-Neuve fut élevé vers 1596, mais il n'eut son enveloppe
de pierres de taille qu'en 1616. C'est également en 1616 que la communauté de
ville fit commencer l'éperon M, vers le sud-ouest, l'éperon N, devant la porte
de Gréguiny, et l'éperon R, devant la porte de Calmont. Dix ans après, en
1626, elle entreprit l'éperon T, entre le château de l'Hermine et la tour du
Connétable. La ceinture murale de Vannes était complète. Elle ne recevra plus
d'augmentation ; au contraire, elle subira de déplorables mutilations dans la
suite des âges. Il est donc à propos de profiter du moment pour examiner en détail
ses tours et ses portes.
III. Tours et portes
Pour
éviter la confusion, il faut avoir sous les yeux le plan qui accompagne cette
étude, et suivre de proche en proche les points marqués par les lettres de
l'alphabet.
A.
— Porte Saint-Pater, ou de Saint-Patern, la plus imposante de la ville, avec
ses deux tours, ses machicoulis, sa voûte ogivale et son écusson de Bretagne.
Elle a été parfois appelée Porte Avane. Affectée à la détention des
hommes, jusqu'en 1828, elle en a conservé le nom de Porte-Prison. Depuis 1886,
elle est privée de sa tour méridionale, la ville ayant refusé de la racheter.
B. — Porte de Saint-Jean, en face de la chapelle de ce nom ; elle s'appelait anciennement Porte de l'Ane, on ne sait pourquoi, et elle avait été fermée avant 1358. Rétablie en 1686, elle reçut les noms successifs de Porte du Mené, du Bourreau, et du Nord. La tour voisine s'appelait Tour des Filles, parce qu'elle servait de prison aux femmes ; le bourreau y fut ensuite logé.
C.
— Porte de Notre-Dame, sur la rue de ce nom, aujourd'hui rue de l'Hôtel-de-Ville.
Au-dessus de la porte, du côté de la ville, était une statue de Notre-Dame,
surmontée d'un petit toit ou ballet ; de là le nom de rue et de porte du Balli,
qu'on trouve dès 1387. La porte ayant été refaite en 1429, fut appelée désormais
Porte-Neuve ; elle a été démolie en 1784.
La construction du bastion C eut pour conséquence la création d'une seconde porte, à l'ouest de la première, avec douve, pont-levis et barrière. La tour la plus voisine de la rue Notre-Dame et dépendante du château de la Motte, fut englobée dans le bastion ; celle du sud, D, appelée Tour Bertranne, fut épargnée et ne disparut que vers 1657.
E. — Porte Saint-Salomon, située sur la rue conduisant au faubourg et à l'église de ce saint. Elle n'a jamais changé de nom, et elle avait à son sommet, comme les autres portes, une guérite ou sentinelle. Elle n'a été démolie qu'en 1791 ; on voit encore dans la cour voisine (N° 15) la poterne servant aux piétons, et l'amorce d'un escalier descendant chez les Cordeliers.
F. — Porte Mariolle, située sur la rue Saint-François ou rue Noé. Elle tirait probablement son nom de quelque propriétaire du voisinage ; elle disparut après la construction de la seconde enceinte, et aujourd'hui il n'en reste aucune trace.
G.— Ce point représente, d'une manière approximative, l'emplacement d'une porte correspondant d'une part à la rue des Halles, et d'autre part « à la rue par où les cherrètes soleint aller de la porte Saint-Pater au port » (1375).
H. — Place d'une porte présumée, pour mettre en communication le centre de la ville avec les diverses maisons mentionnées en 1375. Le Rentier du Chapitre en 1387 cite une porte Hubiou, qu'on ne sait où placer.
Telle était la série des tours et des portes de la première enceinte. Passons maintenant à la seconde.
K. — Tour Saint-François. Son nom vient du couvent des Cordeliers, qui l'avoisinait ; on la trouve en 1666 désignée sous le nom de Tour des Filles, mais c'est probablement par erreur, car elle n'a jamais servi de prison aux femmes ; les religieux en avaient la jouissance dans les derniers temps.
L. —
Bastion de Kaer, dit aussi éperon de Brozillay, achevé en 1593, et délaissé plus tard aux Cordeliers, à titre
de jouissance seulement ; il a
été presque entièrement démoli en
1896, pour faire place à un nouvel hôtel des Postes.
M. — Bastion anonyme, dit parfois éperon de Haute-Folie, achevé en 1618, et voisin en 1640 de la maison de Marin Millet ; il subsiste toujours dans son intégrité, mais il est masqué par des maisons modernes.
N.
— Porte de Gréguenic, située au bas de la Poissonnerie ; on l'appelait aussi porte de
Kaer, parce
qu'elle conduisait à
la terre de ce nom, sur la rive droite du port. Le bastion commencé
en 1616, en dehors de cette porte, l'a mis hors de service.
Entre cette porte et la suivante, il y avait dans la muraille une voûte, fermée d'une grille de fer, pour le passage du ruisseau venant du moulin des Lices.
O.—
Porte de Saint-Vincent, en face du port, à l'extrémité de la rue du même nom. Ouverte sous la Ligue, puis
bouchée pendant les troubles, elle ne fut achevée qu'en 1621 et 1622. Elle comprenait une grande porte et une
poterne, avec pont-levis ; au-dessus du cintre on plaça la statue de saint Vincent Ferrier en 1624, et l'image de
Notre-Dame du côté de la ville ; au-dessus de la
muraille fut construit un corps de garde. A la suite du pont-levis, était
un pont dormant, qui s'avançait vers le port et qui se partageait ensuite en deux branches, l'une vers la terre de
Kaer,
l'autre vers Calmont ; les extrémités de ces ponts étaient fermées
de grosses barrières de bois.
La mer rongea bientôt les bases
du pont et de la porte, et en 1704 il fallut tout
restaurer. C'est alors que la porte de
Saint-Vincent fut refaite belle comme on la voit aujourd'hui, avec
sa baie, ses niches et ses colonnes de style renaissance. La
statue du saint, remise en place, fut renversée en 1793, supplantée
par un sans-culotte à bonnet phrygien, et rétablie
après le Concordat. Vers 1838, on a comblé les bassins
de l'avant-port, en ménageant des canaux souterrains, et l'on a créé
la place du Morbihan. En
même temps
P. — Tour Trompette, servant jadis à loger le trompette de la ville, occupée et brûlée en 1597 par les Espagnols, et réparée depuis.
Q.— Tour de Calmont, voisine de la porte de ce nom.
R.— Porte de Calmont, donnant accès au quartier du même nom ; elle fut protégée en 1616 par un bastion qui n'existe plus ; son pont-levis a disparu et la porte elle-même est condamnée.
S. — Château de l'Hermine : son histoire est réservée pour un paragraphe spécial.
T. — Porte-Poterne, ouverte en 1678, lorsque le château de l'Hermine était en ruine ; le pont vers la Garenne, construit d'abord en bois, le fut ensuite en pierres.
T. — Eperon de la Garenne, bâti en 1627, renfermant à l'intérieur une vaste chambre voûtée, et au-dessus une guérite.
U.
— Tour du Connétable, à l'extrémité de la basse-cour du château ; elle
doit son nom au connétable de Richemont : c'est actuellement la plus belle tour
de la Ville, et elle se présente admirablement entre deux longues courtines,
quand on l'examine du côté de la Garenne.
IV.
Eglise cathédrale (X)
Après avoir fait le tour de la ville, pénétrons dans l'intérieur pour étudier ses principaux monuments, et commençons par l'église cathédrale.
En
465, un concile provincial se réunit à Vannes, pour le sacre de saint Patern ;
l'assemblée se tint dans l'église de Vannes, in ecclesia Venetica. Voilà la
première mention, de la cathédrale. Etait-elle construite en pierre, était-elle
en bois, comme beaucoup d'églises de cette époque ? — On l'ignore
absolument.
En
919, les Normands envahirent le pays, mettant tout à feu et à sang ; ils brûlèrent
Vannes et son église, et empêchèrent longtemps toute restauration.
V. Château de la Motte (Y)
Le
château de la Motte était situé vers l'angle nord-ouest de
l'enceinte gallo-romaine, au point culminant de la ville (C.
Y.) Peut-être même avait-on exhaussé le sol avec des terres rapportées,
comme semble l'insinuer le nom de Motte. L'origine de ce château
est assez obscure. A-t-il été construit pendant la domination romaine ? —
C'est peu probable, car les enceintes romaines de Tours, du Mans, d'Orléans,
d'Auxerre..., dessinées par M. de Caumont, ne présentent aucun château, et
on ne voit pas pourquoi Vannes aurait fait exception. Après la chute de
l'empire en 409, la situation changea complètement : chaque cité recouvra
son indépendance primitive, et le gouverneur dut dès lors avoir une demeure séparée
et même fortifiée. Tout porte donc à croire que Eusèbe, qualifié roi de Vannes vers 500, habitait un véritable château,
et que ce château était celui qui a été depuis connu sous le nom de
la Motte. Le
P. Albert le Grand dit que le corps de sainte Trifine fut
apporté, vers 547, au château de la Motte, chez le comte Guérech,
son père, et que là saint Gildas lui rendit la vie. Il admet donc l'existence du château dès cette époque, et il
semble
avoir raison ; mais il se trompe en y plaçant des princes bretons : ils ne
devinrent maîtres de la ville et du château que quelques années plus tard. Le
château de la Motte servit de manoir aux comtes Macliau en 560, Waroch II en
577, et à leurs héritiers. Il fut plus tard occupé par le prince
Nominoé et par plusieurs de ses successeurs, rois ou ducs de Bretagne. Ruiné
par les Normands, il fut restauré par les ducs, et habité passagèrement
par Pierre de Dreux et par Jean Ier. La Chronique de
Saint-Brieuc nous dit qu'en 1286, avant la mort de Jean Ier, arrivée le 8 octobre, la terre trembla
dans toute la Bretagne, pendant
quarante jours, et plusieurs fois par
jour, surtout à Vannes, où le tremblement fut continuel, et
renversa de nombreux édifices ; après la mort du duc, le tremblement
se fit sentir encore près d'un an, particulièrement à Vannes, mais
avec des intervalles (Pr. I. 14.) Le
château ducal de la Motte, déjà négligé par suite de la préférence
que Jean Ier donnait au château de Sucinio en Sarzeau,
endommagé peut-être par ce tremblement de terre ou
par une cause antérieure, fut cédé en 1287 par le duc Jean
II à l'évêque de Vannes, dont le manoir avait sans doute souffert du
bouleversement général. Le
manoir épiscopal avait été jusqu'alors attenant à la cathédrale.
Ses dépendances étant presque nulles, l'évêque Henri Torz l'abandonna, et « fit édifier l'an 1288 la maison
épiscopale
de la Motte ». Ce renseignement, donné par l'archidiacre
Claude Gouault, vers 1640, d'après d'anciens documents,
est précieux, parce qu'il fournit une date précise. Ce
manoir, construit vers la fin du XIIIème siècle, appartenait nécessairement au style ogival, et il devait avoir à ses
angles
et à ses murs de nombreux contreforts, comme les autres édifices épiscopaux
de la même époque. Divers
actes furent passés « au manoir épiscopal de la Motte », en 1372, 1379, 1398 (Prières, — Pr. II, 232 Chapitre)
; ils prouvent que les évêques y demeuraient déjà, et qu'on
a tort de descendre jusque vers 1420 pour les y introduire. C'est
dans la grande salle, de ce manoir que se réunirent
les Etats de Bretagne en 1532 et qu'ils votèrent l'union
de la province à la France. C'est dans le même lieu que se tenaient, tous les ans, à la Pentecôte et à la
Saint-Luc, les
assemblées ou synodes du clergé diocésain. On
entrait dans cette demeure par un portail donnant sur la
rue de Notre-Dame ou du Baly, et l'on traversait une cour
spacieuse pour arriver au manoir, qui était adossé au mur de la
ville. On voyait à droite, vers l'est, un jardin de moyenne grandeur, et à gauche, vers l'ouest, divers bâtiments accessoires,
servant de secrétariat, d'auditoire pour le tribunal des régaires, de
prison, et d'écuries. En 1623, l'évêque Sébastien de Rosmadec afféagea
une bande de terrain située entre ses écuries et son portail, le long de la
rue de Notre-Dame, avec permission d'y construire des maisons (Evêché G).
Cependant le vieux manoir, bâti en 1288, s'en allait de vétusté, quand Mgr
Charles de Rosmadec entreprit de le reconstruire en 1654. Le clergé diocésain,
au synode de la Pentecôte de cette année, lui alloua une somme de 6.000
livres. Pendant les travaux, qui durèrent environ 18 mois, l'évêque logea
dans la maison de l'archidiacre, tout près de la maison de l'Officialité,
qu'on appelait aussi le petit évêché. Le nouveau manoir épiscopal, adossé
au mur de la ville, comme l'ancien, offrait une façade à trois étages,
ayant chacun neuf ouvertures ; un mur de refend le divisait dans toute sa
longueur. Voici quelle était sa distribution intérieure : Au rez-de-chaussée,
au milieu, était la porte d'entrée, ayant à gauche une première et une
seconde cuisine ; à droite de l'entrée, l'office et le secrétariat ; au
nord, entre le corridor et le mur de la ville, il y avait plusieurs celliers ;
le côté oriental avait trois fenêtres. Un perron monumental à double
escalier conduisait de la cour au premier étage, et donnait accès à une
grande salle, ayant deux chambres à l'ouest, et deux autres à l'est ; au
nord de ces appartements étaient plusieurs cabinets donnant sur le mur de la
ville. Au second étage, même distribution. Les évêques ont habité tantôt
le premier, tantôt le second étage. Au troisième, un corridor desservait
deux séries de chambres pour les domestiques et divers services (Procès-verbal
179. N). Mgr Casset de Vautorte fit construire un cabinet sur la terrasse et
refaire le portail de la cour ; il rendit un aveu détaillé pour le tout en
1683 (Evêché G). Mgr d'Argouges acquit en 1688 les douves du Mené, qu'il
convertit en un grand jardin ; plus tard il acquit la moitié du bastion de
Notre-Dame, où il fit faire un pavillon et un jardinet ; en 1716 il légua le
tout à ses successeurs.
VI. Château de l'Hermine
(S).
Depuis
1287, les ducs n'avaient plus de château à Vannes ; quand
ils venaient au pays, ils logeaient à Sucinio et chassaient dans le parc. Ainsi en agirent Jean II, Arthur II
et
Jean III. Mais Jean IV, le vainqueur d'Auray, en bâtissant la
nouvelle enceinte de Vannes, voulut y annexer un château. En
conséquence, il acquit en 1380, comme il a été dit, le moulin et l'étang des Lices, et
donna en échange à l'abbaye de St-Gildas
de Rhuys son moulin de Pencastel en Arzon. Il
prit encore d'autres terres, comme le prouve une clause de
son testament en 1385 : « Item
voulons que toutes les terres, maisons et
autres pièces, qui ont été prises, tant de la terre de l'Eglise que d'autres personnes, pour l'oeuvre
et réparation
de notre chastel de l'Hermine, soient
prisées justement et payées à ceux qu'il appartiendra ». (Pr. II. 497.)
Voici la description de ce château, donnée en 1582 par Bertrand d'Argentré : «
Le duc faisoit lors (1387) bastir le chasteau
de l'Hermine, qui est situé en un costé de la ville de Vennes,
regardant sur un bras de mer, qui donne aux murailles
de la ville. C'est un petit bastiment pour un prince, qui consiste dans
un seul corps de logis, et force petites tours, issantes les unes et autres sur
la douve, grande partie portée en murailles
et demy-tour, et y a outre deux grosses tours par le dehors » (Hist. p.
705.) Cette
description ne concerne que le château proprement dit, réservé au duc et à sa
famille ; sa forme était celle d'un pentagone irrégulier,
avec des douves profondes remplies d'eau. Il y
avait en outre vers le nord et jusqu'à la tour du Connétable
un espace considérable, protégé par des murs
et des douves et appelé la Basse-Cour du château. Il y avait là des bâtiments pour loger
les gens d'armes et les troupes du duc, et des écuries
pour recevoir les chevaux. Tout à côté était le champ de manoeuvres, qui a
conservé jusqu'à nos jours le nom
significatif de place des Lices. C'est sur cette place qu'eut lieu, en 1381, un combat singulier, où cinq Bretons battirent cinq Anglais. (Lobineau,
H. p. 440.) Le château de l'Hermine et son
annexe étaient presque terminés
quand, le 25 juin 1387, le duc les fit visiter par le connétable Olivier de Clisson et d'autres seigneurs.
« Il les
mena
par la main, dit Froissart, de chambre en chambre, et
d'édifice en édifice ; quand ils eurent fait le tour, le duc s'en
vint à la maitresse tour »,
où il fit arrêter Clisson. Pour
avoir un parc en miniature auprès de son château de
l'Hermine, Jean IV avait obtenu du prieur de Saint-Guen, dépendant
de Saint-Gildas, l'afféagement de la Garenne et des terres
voisines, depuis la ville jusque vers l'étang du duc ; et
le 11 janvier 1387 (N. S. 1388) il assigna au dit prieur une rente annuelle de
10 livres, 6 sols et 1 denier sur sa recette de Vannes. C'est au château de l'Hermine que
naquit en 1389 Pierre de Bretagne, qui devint duc en
1399 sous le nom de Jean V. C'est
dans ce château qu'il demeurait, quand il reçut à Vannes
en 1518 saint Vincent Ferrier, et qu'il le vit prêcher sur la place des Lices. C'est dans
ce château que mourut la pieuse duchesse Jeanne de
France le 20 septembre 1433. C'est
là que séjournèrent souvent les ducs François Ier et Isabeau d'Ecosse, Pierre II et la B. Françoise d'Amboise.
C'est
là qu'eut lieu le festin du mariage de François, comte d'Etampes, avec Marguerite de Bretagne, le 16 novembre
1455 (Lobineau.
H. 661). Sous François II, le chancelier Chauvin, poursuivi
par Landais, fut enfermé au château de l'Hermine, et y mourut de misère
le 5 avril 1483. Abandonné aux capitaines ou
gouverneurs de Vannes, pour leur servir de logement, le
château de l'Hermine fut visité
en 1518 et 1532 par le roi François Ier (Pr.
III, 946, 997). Il avait pour capitaine en
1543 et 1556, M. de Monterfil, en
1573 François de Kerméno, seigneur de Keralio, en 1590 René d'
Arradon, seigneur de Kerdréan, et en 1625 Pierre de Lannion. Cependant il s'en allait
graduellement en ruine par insuffisance de réparations
et il commençait à gêner l'expansion de la ville. En 1614, les Etats de
Bretagne réunis à Nantes, pris d'un zèle exagéré
pour la sécurité intérieure du pays, demandent
au roi Louis XIII qu'on démolisse diverses forteresses
de la province, et notamment « que le château de Vannes soit entièrement ruyné du costé de la ville, en sorte que
l'on ne s'y puisse habituer, et la fosse comblée du costé de la ville ». — Le roi concéda cet article, et les
douves
furent comblées. Plus
tard, on bâtit sur les Lices les deux grandes maisons qui
masquent la Basse-Cour, et celles qui cachent l'étang de l'Hermine ; en 1678 on ouvrit la
porte Poterne, pour faire suite à la nouvelle rue
de ce nom ; puis on acheva la rue de Saint-Vincent,
pour loger les membres du parlement exilé à Vannes (1675-1689). Le
château de l'Hermine, malgré ces mutilations, était resté la propriété du roi. Sur
la demande de la communauté de
la ville, Louis XIV, par lettres patentes du mois de mars 1697,
en fit don aux habitants et maire de Vannes, et leur permit de le démolir et d'en
employer les pierres à divers travaux publics. — En vertu de ce don, la
ville fit réparer ses murailles, reconstruisit le
pont de Saint-Vincent, bâtit les quais
de Calmont-Bas (1725-1735) et fournit quelques matériaux
à l'hôtel-Dieu et à la Retraite des hommes (1750). Enfin, le 18 octobre 1784, la
communauté afféagea au sieur Julien Lagorce, traiteur,
l'emplacement du château, avec les restes des murs et des
deux grosses tours, ce qui fut approuvé par l'intendant le 11 mars 1785.
L'acquéreur y fit construire un grand hôtel,
qu'il vendit à M. Castelot le
24 août 1802. Cet édifice, restauré et surélevé, a été acquis en
1874 par l'Etat, pour en faire une école d'artillerie. Depuis ce temps, l'étang des
Lices a été comblé et le moulin
démoli.
VII.
Maison de ville (V)
Tout près de la basse-cour de l'Hermine, au point marqué V sur le plan, se trouve un emplacement de maison, qui a été occupé successivement par des particuliers, par la Cour des Comptes, par le parlement et par la communauté de ville. Le premier propriétaire connu est Geoffroy de Clesse, de la paroisse de Theix, qui vivait en 1350. Geoffroy Denis occupait ce manoir en 1375, comme on le voit par la fondation de Talevaz mentionnée ci-dessus au § II. C'est là que vint s'installer, quelques années plus tard, la Chambre des Comptes des ducs de Bretagne. Elle y siégeait en 1395, 1412, 1429, 1450, 1485. Elle quitta Vannes en 1500, sur l'ordre du roi et de la reine, pour se fixer à Nantes, et y fit transporter ses archives. Au mois de décembre 1534, le rot François Ier considérant que l'ancienne maison des Comptes « seroit commode pour tenir la cour et parlement de Bretagne », l'affecta à cet usage, « à la charge toutefois que les habitans seroient tenus de mettre le dit bastiment en due réparation... ». Le parlement ayant été transféré à Rennes en 1554, la maison redevint libre. C'est alors que la communauté de la ville songea à la demander au roi, pour y tenir ses séances. « On ignore, dit M. Lallemand, l'époque à laquelle les habitants de Vannes furent appelés à se constituer en communauté ou corps politique ; mais il est probable que pendant les guerres de la succession, les bourgeois de la ville, qui y jouèrent un grand rôle, eurent l'occasion de s'organiser et de se donner des représentants. Nous avons vu en effet leur Conseil de ville traiter avec Charles de Blois en 1342, malgré Geoffroy de Malestroit, gouverneur de Vannes pour Montfort, et l'obliger à sortir de ses murs avec les gentilshommes de son parti » (Origines, p. 143). — On ignore également la composition et le lieu de réunion de ce Conseil primitif. Voici la requête adressée au roi en 1558 : « Sire, il y a en notre ville de Vennes une maison qui vous appartient, la maison de la. Chambre des Comptes. Pour ce qu'elle a été longtemps inhabitée, elle est aujourd'huy si caducque et ruynée qu'elle est preste à tumber, de façon qu'elle usera presque autant qu'elle vaut à rebastir. Non obstant laquelle ruyne, pour ce que les habitants n'ont pas de maison commune, pour traiter leurs affaires communes, mesmes pour retirer le peu de munitions de guerre qu'ilz ont, comme il leur est très requis, estant ville limitrofe et de frontière, scituée et assize sur un havre de mer. Et pour ce les dits habitans supplient très humblement Votre Majesté de leur bailler et délaisser la dite maison, pour y faire une maison de ville, à charge d'acquiter la rente deue sur icelle à quelques particuliers, et de vous payer chacun an à votre propre domaine de Vennes la somme de cinquante sols de rente... » (Archives de la Mairie). Cette requête fut agréée en 1560. La ville rebâtit alors la maison telle qu'on la voit aujourd'hui ; il ne reste de l'ancien édifice qu'une porte ogivale à, demi-enterrée. Une tour carrée et massive fut construite en 1583 pour recevoir une grosse cloche ; elle n'a été démolie qu'en 1863. En avant s'étendait une place à peu près carrée, bordée de maisons particulières, qui ont été graduellement supprimées. Le perron qui conduit au premier étage de la maison de ville n'a été placé qu'en 1811. La communauté de ville, lorsqu'elle reçut son développement complet, comprenait le gouverneur de la ville, le président ou sénéchal, l'alloué ou le lieutenant, le doyen des conseillers, le procureur du roi et son substitut, l'évêque ou son grand vicaire, les quatre dignitaires de la cathédrale, le doyen et deux chanoines du chapitre, les quatre recteurs de Vannes, les quatre plus anciens gentilshommes de la ville, le syndic et miseur en charge, les anciens syndics et miseurs, six avocats des plus anciens, les officiers de la milice bourgeoise, douze bourgeois notables, et six anciens notaires ou procureurs. — Une telle assemblée représentait mieux les diverses classes de la société que nos conseils municipaux actuels. La communauté était présidée, depuis 1560 au moins, par le gouverneur de Vannes, et ce droit fut formellement reconnu par le lieutenant du roi en 1628. En son absence, la présidence appartenait au président du présidial ou au sénéchal, qui se la disputèrent longtemps. En 1692 elle fut dévolue au maire, qu'un édit de Louis XIV venait de créer dans chaque communauté de ville. La révolution française supprima la communauté de ville et la remplaça par le Conseil de la commune, dit plus tard Conseil municipal. Le maire, d'abord élu, puis nommé par l'autorité centrale, fut maintenu comme président du Conseil et chef de l'administration urbaine. L'ancienne maison de ville servit de siège à la nouvelle administration municipale, et il en fut de même jusqu'en 1880, où M. Burgault voulut construire une nouvelle mairie, sur la place du Marché, dite aussi place Napoléon. Les plans et devis approuvés montaient à 410.938 francs, mais, comme il arrive presque toujours, les prévisions furent dépassées, et ce luxueux palais coûta 793.698 francs, c'est-à-dire à peu près le double du devis. C'est le 1er août 1886 que l'administration municipale a pris possession du nouvel hôtel de ville et a quitté l'ancienne mairie, qui depuis attend la décision de son sort.
VIII. Halle et Présidial (V')
Entre la rue des Halles et
l'église cathédrale se trouvait le marché couvert, appelé primitivement la
Cohue, et plus tard
la Halle. Au-dessus était le tribunal de la Sénéchaussée, remplacé
ensuite par celui du Présidial. La
Cohue existait dès 1220 au moins. Elle se compose actuellement de trois nefs, ou de trois halles, dont l'âge,
très
respectable, est difficile à préciser. La façade du côté de
la cathédrale, masquée par des maisons, ne laisse plus voir que le portail de la chapelle du présidial ; c'est une
porte
ogivale, entourée d'une archivolte à chevrons, flanquée
de colonnettes et surmontée d'une étroite fenêtre romane,
caractère qui marque la transition ou le commencement du XIIIème siècle. L'intérieur de la chapelle, occupé
aujourd'hui
par les pompes de la ville, présente dans les côtés
deux grandes portes, actuellement bouchées, qui établissaient
jadis une communication avec les nefs latérales de la halle. La façade de l'ouest a été refaite au commencement
du XIXème siècle. La Cohue appartenait primitivement
aux ducs de Bretagne et puis aux rois de France ; aussi
les places étaient-elles louées
à leur profit. Les bouchers, les boulangers, les toiliers
et autres marchands s'y rendaient aux jours de foire et de marché, et ne pouvaient pas
étaler ailleurs sans autorisation.
Ainsi les boulangers de Bohalgo ayant voulu, en 1644,
s'établir sur la place du Marché et au pont de Saint-Vincent, furent
condamnés à revenir à la halle, sous peine d'une
amende de dix livres. Après le départ du parlement en 1689, le commerce baissa et la halle fut
moins fréquentée. Le fermier des places fit
constater, par un procès-verbal du 1er mars 1690, que la plupart
de ses locataires n'y venaient plus
; de dix-sept boutiques, louées en moyenne 18 livres chacune,
il n'y en avait plus que trois ou quatre qui fussent occupées : c'était une perte importante pour lui et pour
le roi. Plus tard la situation s'améliora
et se maintint satisfaisante jusqu'à la Révolution.
Quand vint la liberté du commerce, la halle fut peu à peu délaissée
; seuls les bouchers lui
restèrent fidèles jusque vers 1840, en occupant toute la partie
méridionale. Aujourd'hui la halle est un magasin de décharge
pour la ville. Au-dessus de la halle se
trouvaient plusieurs chambres, dont la principale servait
d'auditoire ou de salle d'audience à
la Sénéchaussée. C'est grâce à ce voisinage que les contestations commerciales pouvaient être jugées sur-le-champ ; des prisons même étaient ménagées au rez-de-chaussée
de la halle. La sénéchaussée était ainsi
nommée du sénéchal, qui
la présidait, et qui était assisté d'un alloué ou
lieutenant, de plusieurs
conseillers et d'un greffier, sans compter un procureur du roi et ses substituts. Sa juridiction, qui
s'étendait primitivement sur tout le pays de Broérech,
avait été graduellement diminuée,
et ne s'exerçait plus en dernier lieu
que de Grand-Champ à la Vilaine et de l'Océan à la Claie. C'est encore à peu près le ressort du tribunal de
première
instance de Vannes. A côté
de la sénéchaussée, le duc François II avait établi, le
27 septembre 1485, à Vannes, un Parlement dit
des Grands jours, siégeant deux mois par an,
ayant juridiction sur toute la
Bretagne, et jugeant toutes les affaires que le parlement des Etats n'avait pas eu le temps de régler. Charles VIII
en 1493, Louis XII en 1500 et
François Ier en 1515 maintinrent ce parlement à Vannes. Il siégeait dans une maison, dite
depuis du Parlement ou Château-Gaillard, située
au haut de la rue Noé, n° 2. C'est un édifice bâti au XVème siècle, où se
trouvent de vastes salles,
des sculptures remarquables, et des peintures représentant la vie des Pères du désert, par
allusion au nom du président Louis des Déserts, qui l'habitait en 1528. Cette maison
appartenait alors à la collégiale de N.-D.
de Nantes, et était louée 40 livres, puis 50 livres par
an. En 1534, le roi François Ier trouva plus économique d'affecter
au Parlement l'ancienne maison de la Cour des comptes, en laissant aux
habitants le soin de la restaurer. Arrive
ensuite Henri II, qui modifie toute cette organisation
judiciaire. Par lettres du mois de mars 1553, il crée un Parlement permanent et le divise
en deux chambres, dont
l'une doit siéger à Rennes et l'autre à Nantes. Pour dédommager Vannes, il y érige, dès le 17 juin 1552, un
tribunal
intermédiaire appelé Présidial, ayant une compétence et un
ressort bien plus étendus que ceux de l'ancienne sénéchaussée.
Les nouveaux magistrats, savoir : un président,
un lieutenant criminel et sept juges ou conseillers, furent installés
le 8 août 1553. En
remplaçant la sénéchaussée, le présidial occupa le même local, au-dessus des halles.
C'est là que se jugeaient les
affaires ordinaires de la sénéchaussée de Vannes et les affaires réservées
des sénéchaussées voisines. C'est là que se réunissaient les Etats de
Bretagne, quand ils siégeaient à Vannes, comme ils le firent en
1567, 1572, 1577, 1582, 1599, 1610,
1629, 1643, 1649, 1667, 1691, 1693, 1695, 1699, 1703. C'est là
que s'assemblait le parlement de Bretagne pendant son exil
à Vannes (1675-1689). C'est là que siégeaient aussi les juridictions de l'Amirauté, des Traites, de la Maréchaussée,
de
la Maîtrise des eaux et forêts, de la Police, et les juridictions
seigneuriales de Boismoraud, de Saint-Guen, de l'Ile-d'Arz, et de
Kermainguy en Grandchamp. Supprimé,
comme toutes les justices seigneuriales, le présidial
de Vannes fut remplacé en 1790 par un tribunal de district, qui subit ensuite de
nombreuses modifications, avant
d'arriver à l'organisation actuelle, qui date de 1811. Délaissée
par les tribunaux, l'ancienne salle du présidial a été transformée en théâtre
municipal, où des troupes de passage
viennent de temps en temps donner des représentations.
IX.
— Couvent des Cordeliers (Z)
Les
Frères Mineurs, appelés plus tard Cordeliers, furent établis
à Vannes en 1260 par le duc Jean Ier. Leur couvent (Z) fut
bâti au sud-ouest de la cathédrale, en dehors du vieux mur
de la ville. Il était presque voisin du manoir de Kaer (Z') dont
les seigneurs lui firent plus tard quelques libéralités, mais
on doit croire qu'il se composait, comme dans les siècles suivants,
d'un carré d'édifices autour d'un cloître.
X. Rues de la ville close
Pour plus de clarté, on
peut suivre les numéros du plan. - 1° Rue Emile Burgault, et auparavant rue de la
Préfecture
; avant la Révolution c'était la
rue Notre-Dame, et antérieurement
rue du Baly ou du Ballay, dite aussi rue de la Porte-Neuve, et rue de la Juiverie.
XI. Eglise de Saint-Patern
En
sortant de la ville close, du côté de l'est, on trouve le quartier de Saint-Patern. Il
y avait là, dès l'époque gallo-romaine, un
centre de population plus ou moins important, comme
l'ont prouvé les briques et autres débris romains trouvés
dans diverses rues et dans les prairies situées entre l'étang au Duc
et le village de Saint-Guen. C'est
probablement peur favoriser ce quartier que saint Patern,
premier évêque de Vannes, demanda, vers 480, à un
riche propriétaire de l'endroit le terrain nécessaire pour y
bâtir une église ; mais il ne put l'obtenir. Plus tard, vers 500,
quand il fut question de ramener à Vannes le corps du saint évêque, mort en
exil, le propriétaire jadis récalcitrant
offrit lui-même le terrain demandé pour une église, et
promit de payer les frais de construction. Cet édifice, élevé
sur l'emplacement de l'église actuelle, reçut le corps de
saint Patern, et en prit le nom ; les reliques du saint y restèrent
pendant quatre siècles. Vers
919, en présence des épouvantables ravages des Normands,
qui mettaient tout à feu et à sang, le corps de saint Patern fut confié à Daoc, abbé de Rhuys, et emporté dans le
Berry. Son église fut brûlée et resta longtemps un monceau de
ruines. Après
l'expulsion des pirates en 937, ou plutôt après les terreurs
de l'an 1000, elle fut relevée dans le style roman de
l'époque, et vers le même temps érigée en église paroissiale
: on sait que, dans les cités épiscopales, il n'y eut point
de paroisses distinctes de la cathédrale avant le XIème
siècle. Cette paroisse comprit tout le faubourg de Saint-Patern et
toute la campagne autour de la ville. Elle
était encore d'érection récente, quand, vers 1081, Maengui,
évêque de Vannes, donna à son chapitre la moitié de cette paroisse, avec la faculté d'y nommer un vicaire
pour
cette portion. Un siècle après, en 1177, l'évêque Rotald ou Rouaud donna
l'autre moitié dans les mêmes conditions.
Cette situation bizarre d'une paroisse, gouvernée par
deux chefs égaux, se prolongea jusque vers 1430, où l'unité fut rétablie
au profit d'un recteur. Durant
le XIIIème et le XIVème siècle, l'église Saint-Patern était l'une des stations du grand pèlerinage des
Sept
Saints, qui consistait à faire
le tour de Bretagne, et le chapitre y faisait
exposer une partie des reliques du patron, qui lui avaient été
rapportées d'Issoudun. La guerre de Succession n'arrêta pas le concours des
fidèles, bien que l'anglais Saint-Alban et le breton Pierre de
Kaer eussent transformé momentanément
l'église en forteresse. A côté de l'église se trouvait
alors le cloître, qui ne s'écroula qu'aux dernières années du XIVème siècle.
L'église
romane, dont la dédicace se célébrait le 21 mai, au
jour de la translation des reliques de saint Patern, était un
édifice en forme de croix latine. Le choeur, accosté d'une sacristie
au nord, avait son autel majeur au fond, et de
chaque côté deux petits autels, dédiés l'un à saint Thomas,
l'autre à sainte Madeleine. La maîtresse vitre devait avoir
à l'origine l'écusson de Bretagne, parce que le duc, et plus tard le
roi, était regardé comme le fondateur de l'église, mais en 1727 il n'y
avait plus que les armes de Rosmadec, soit simples, soit en alliances. En
dehors du sanctuaire, à deux pas de la table de communion,
et au milieu, se trouvait un tombeau, élevé de
deux pieds, orné des écussons de Rosmadec, de Molac, de
la Chapelle, de Pontcroix, de Kerhoent, etc., pour lequel le
seigneur de Carcado-Molac payait à la fabrique une rente de 40 sols par an. Entre ce tombeau et la longère du nord,
se
voyait la tombe prohibitive de la famille Sesbouez ; beaucoup d'autres tombes
formaient le pavé de l'église, mais leur description ne nous est pas
parvenue. A l'inter-transept, quatre gros piliers, dont l'un renfermait un escalier, étaient
réunis par des arcades romanes, et
supportaient une tour carrée, surmontée d'une flèche en pierres.
Le transept nord était dédié à la sainte Vierge, sous le titre de
la Chandeleur ; et les chapelles de ce côté, en
allant vers le bas de la nef, étaient sous les vocables de Saint-Julien,
de Saint-Cado, de Saint-Honoré, etc... Le transept
sud était dédié à saint Sébastien et à saint Isidore ; les
chapelles du bas côté portaient les noms de Saint-Jean devant
la porte Latine, de Sainte-Barbe et de Saint-Fiacre, de Saint-Roch et
de Sainte-Marguerite. Cette
église, au bout de sept siècles, menaçait ruine. En
1721, une furieuse tempête abattit quinze pieds de la tour ; le 9 mai 1726, le reste tomba, en écrasant la moitié de
la
nef et en lézardant le choeur. Il
fallut se résigner à tout reconstruire. L'architecte Delorme
dressa le plan de la nouvelle église, qui devait avoir
le même emplacement et les mêmes dimensions que
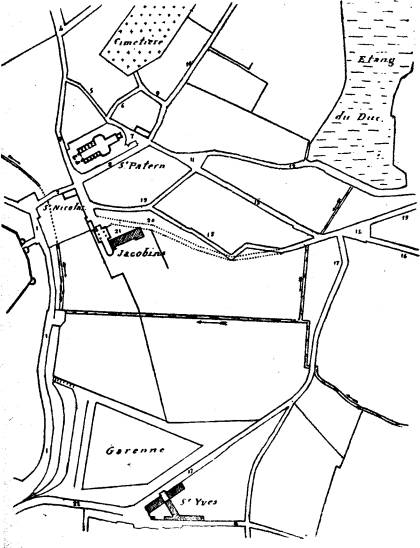
VANNES - SAINT-PATERN
l'ancienne, et être reconstruite par parties et successivement, à commencer par le choeur et continuer par les transepts. La première pierre fut posée le 18 septembre 1727, et dix ans après on put inaugurer la majeure partie de l'édifice. Restaient le bas de la nef, qui fut bâti en 1769, et la tour, qui suivit de près, mais qui ne fut terminée qu'en 1826. Cette église, commode pour le culte, est sans caractère architectural ; ses murs sont en moellons et ses fenêtres sans style. Les chapelles latérales ont conservé une partie des anciens vocables, et les transepts deux retables de la Renaissance. L'autel majeur est en marbre blanc, et les fenêtres ont été récemment garnies de vitraux peints. La tour placée au bas de l'église, et précédée d'un escalier monumental, est toute en pierre de taille, et offre un coup d'oeil-imposant. Le cimetière qui entourait l'église fut fermé en 1792, et remplacé par le cimetière de Boismoreau, qui sert à toute la ville. On voit, parmi les nombreuses tombes qui remplissent ce nouveau champ funèbre, la croix de M. Pierre Rogue, lazariste, guillotiné le 4 mars 1796 ; le tombeau du P. Louis Leleu, jésuite, mort en odeur de sainteté le 1er août 1849, et le monument de Mgr Charles-Jean de la Motte, évêque de Vannes, mort le 5 mai 1860. Tout près de l'église de Saint-Patern, vers l'est, était la chapelle de Sainte-Catherine, dont il reste un pan de mur en belles pierres de taille, enchâssé dans le mur de la maison qui fait le coin de la place. C'est jusqu'à cette chapelle que s'avança la procession de la cathédrale pour recevoir saint Vincent Ferrier en 1419. C'est dans cette chapelle que, se fit le service paroissial pendant la reconstruction de l'église en 1727 et années suivantes.
XII. Hôpital de Saint-Nicolas
On ignore la date précise de la fondation de cet établissement, qui fut mis sous la protection de saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie, mort vers 324. On sait seulement que l'Eglise, dès son origine, s'est toujours préoccupée de venir en aide aux voyageurs et aux malades pauvres. Saint Patern, en montant sur le siège de Vannes en 465, ne manqua point à ce devoir : Il montra, disent les leçons de son office, une charité inépuisable pour nourrir les pauvres et recevoir les étrangers. — Mais son hospice était-il ici ou ailleurs ? — On l'ignore. Plus tard, en 816, le concile d'Aix-la-Chapelle rappela l'obligation pour tous les évêques d'avoir un hospice dans leur ville, et d'en confier la direction spirituelle et temporelle à un chanoine qui leur en rendrait compte tous les ans. En 1312, le pape Clément V accepta le concours des laïcs pour l'administration des hôpitaux, mais il maintint l'obligation de rendre les comptes tous les ans à l'Evêque ou aux propriétaires de ces établissements. C'est alors que commencent les renseignements positifs sur l'hôpital de Saint-Nicolas, dit aussi hôtel-Dieu de Vannes. Il était situé sur le côté sud de la rue Saint-Nicolas, entre la rue actuelle du Roulage et le ruisseau du moulin de l'Evêque. La chapelle, régulièrement orientée, était à l'angle des deux rues ; les salles des pauvres et des malades lui faisaient suite vers le couchant, et pouvaient recevoir de 20 à 30 lits ; au midi s'étendait un jardin, dont la contenance a varié suivant les époques. Conformément au décret de 816, c'était toujours un chanoine de la cathédrale qui en avait l'administration, et qui portait pour ce motif le titre de prieur, comme chef d'une petite communauté. Les archives nous ont conservé les noms de Geoffroy du Pont en 1329, de Prigent Le Chevalier en 1393, de Jean Hervé en 1405, de Geoffroy Beign en 1425, d'Yves de Plumaugat en 1477, tous chanoines de Saint-Pierre et prieurs de Saint-Nicolas. On rencontre ensuite une série de simples prêtres, portant le titre de prieur ou d'aumônier, et gouvernant la maison, comme le faisaient précédemment les chanoines. Cependant la communauté de la ville de Vannes, à l'exemple de plusieurs autres cités, désirait se substituer à l'évêque commendataire pour l'administration temporelle de l'hôpital, et elle fut assez heureuse pour obtenir du parlement de Bretagne, le 5 octobre 1549, le droit de commettre deux administrateurs laïcs, tous les deux ans, pour gérer les biens de la maison, en ne laissant à l'aumônier que l'administration des sacrements, et à un gardien le service des malades. Les administrateurs laïcs, trouvant les dépendances trop restreintes, demandèrent, en 1567, au roi Charles IX la cession des terres situées au midi et arrosées par les ruisseaux venant de l'étang du Duc et de l'étang de l'Evêque. Le roi les accorda par lettres du 12 septembre 1569. Ces terrains marécageux, exhaussés au moyen de déblais, furent convertis en jardin ; et une vingtaine d'années plus tard le duc de Mercœur y ajouta une bande de terrain sur la pente de la Garenne. En 1634, il fut question au conseil de la ville de confier le soin des malades à des religieuses. Le plus grand nombre des conseillers s'y opposa ; mais les plus considérés, et notamment les magistrats, se prononcèrent en faveur des religieuses et prièrent Mgr de Rosmadec de faire venir des Hospitalières Augustines de Dieppe. Celles-ci arrivèrent à Vannes et furent conduites à l'hôtel-Dieu le 25 juillet 1635 ; mais cinq jours après, elles furent expulsées par les opposants, et elles durent se réfugier chez les Carmélites ; enfin le 4 août, elles furent acceptées par l'opposition, mais à des conditions assez dures. Oubliant cet accueil pénible, et rendant le bien pour le mal, les religieuses construisirent à leurs frais, en 1640, une salle pour recevoir les hommes, au midi de la chapelle ; et à la suite une grande maison pour leur communauté; à l'ouest de la chapelle, le logement fut amélioré et réservé aux femmes seules. Plus tard, en 1667, elles achetèrent les immeubles situés entre le ruisseau du moulin de l'Evêque et la rue de la Garenne; en 1670, elles achevèrent de bâtir l'édifice placé au midi de la cour et du côté du jardin. L'hôtel-Dieu était ainsi complet et formait un carré de constructions autour de la cour. Le nombre des religieuses variait entre 20 et 30, et c'est grâce à leurs dots qu'elles pouvaient s'entretenir, construire des bâtiments et améliorer le service : leur présence était une bénédiction pour l'hôpital. Néanmoins la tempête approchait. Le 18 novembre 1790, les 24 religieuses de la maison, interrogées séparément, répondirent qu'elles voulaient persévérer dans leur état. Deux ans après, le 19 décembre 1792, elles furent brutalement mises à la porte, et remplacées par cinq citoyennes. L'année suivante, la maison de la communauté fut convertie en prison, pour y renfermer une centaine de religieuses, de divers ordres, qui ne recouvrèrent la liberté qu'au commencement de 1795. Au mois de janvier de cette année, les malades de l'hôpital de Saint-Nicolas furent transférés au Petit-Couvent, dont la position était plus avantageuse au point de vue hygiénique. L'hôtel-Dieu, ainsi délaissé, sans réparation, souffrit considérablement des injures du temps. Le 16 juillet 1802, on fut obligé de démolir la chapelle, qui tombait en ruines. Enfin, une loi votée le 29 janvier 1805, autorisa l'administration des hospices civils de Vannes à céder au sieur Burgault, maire de Muzillac, les bâtiments de l'hôpital de Saint-Nicolas, avec les jardins et les dépendances, et à recevoir en retour les métairies du Pourpris et de la Porte-de-Bavalan, en la commune d'Ambon. Depuis ce temps, le quartier de Saint-Nicolas a pris, par des constructions successives, l'aspect qu'il présente aujourd'hui. Une rue nouvelle a été ouverte au sud des bâtiments, et le jardin est entré en 1861 dans l'enclos de la préfecture.
XIII. Couvent des Dominicains
Tout près de l'hôtel-Dieu était le couvent des Dominicains ou des Jacobins. Les premiers religieux de cet ordre arrivèrent à Vannes le 29 mai 1633, après avoir obtenu de l'évêque, de la ville et du roi, les autorisations nécessaires pour s'y établir. Ils jetèrent les yeux sur une prairie appartenant à l'hôpital de Saint-Nicolas, et située à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'hôtel de la Préfecture ; ce terrain n'avait qu'un journal et sept cordes environ de superficie, mais il était susceptible d'agrandissement au sud, à l'est et au nord. Ils en obtinrent l'afféagement des représentants de la ville et de l'hospice le 23 novembre 1633, moyennant une rente perpétuelle de 15 livres par an. Pour aller de l'église de Saint-Patern à ce terrain, qui était alors enclavé de tous les côtés, les religieux achetèrent trois immeubles qui leur barraient le passage au bas de la rue du Four. C'est à ce moment qu'intervinrent, à titre de fondateurs, Messire Sébastien de Rosmadec, seigneur du Plessis, de l'Espinay, de Kernicol, de Lesnevé et autres lieux, et dame Julienne Bonnier, sa compagne, demeurant au manoir du Plessis, en la paroisse de Theix. Ils donnèrent une somme de 11.000 livres tournois pour payer les immeubles achetés, et pour construire l'église et la maison conventuelle. En retour ils demandèrent deux services solennels par an, une messe basse tous les lundis et 56 Libera dans le cours de l'année. Comme fondateurs, ils eurent le droit de mettre leurs armes dans les vitres de l'église et ailleurs, d'avoir un caveau funéraire dans le choeur, et de placer deux bancs prohibitifs du côté de l'évangile, l'un dans le choeur pour les hommes et l'autre dans la nef pour les femmes de leur maison. On commença dès 1634 la construction du couvent. Le corps de logis, au sud du cloître projeté, et en face du jardin, fut seul bâti vers cette époque ; les bâtiments qui devaient longer deux autres côtés du cloître futur, furent remis à plus tard, et finalement ne furent jamais édifiés. Quant à l'église, on la plaça sur le côté occidental du cloître, de manière à avoir le chœur tourné du côté de la Garenne, et l'entrée de la nef vers Saint-Patern. La première pierre de cet édifice fut solennellement bénite le samedi 28 octobre 1634, par Mgr Sébastien de Rosmadec, oncle des fondateurs, en présence du clergé, de la noblesse et du peuple de Vannes, et placée par le seigneur du Plessis sous le premier pilier du côté de l'épître ; elle portait une plaque d'argent avec une inscription rappelant la cérémonie. Le choeur de cette église était très allongé et se terminait en hémicycle ; les religieux chantaient ou récitaient leur office au fond, le maître-autel occupait le milieu et la table de communion était en avant. La nef avait la même largeur que le sanctuaire, et elle avait trois chapelles de chaque côté. En 1638, Messire Pierre de Larlan, seigneur de Lanitré et conseiller au parlement de Bretagne, se chargea de la construction de la chapelle la plus rapprochée du choeur, du côté de l'épître, en s'y réservant les droits ordinaires d'armoiries, d'enfeu et de banc prohibitif, et en y faisant une fondation de services pour une rente annuelle de cent livres tournois. En 1641, M. Jacques Sorel, seigneur du Bois-de-la-Salle et de Salarun, entreprit d'achever à ses frais la chapelle la plus haute, du côté de l'évangile, dédiée au Rosaire, à condition d'y avoir également tous les droits honorifiques, et y ajouta une fondation de services, moyennant une semblable rente de cent livres. Cependant les Dominicains n'avaient pas encore d'enclos. Ils demandèrent, dès 1634, au roi, comme héritier des ducs, la cession d'un terrain marécageux situé entre leur couvent et la colline de la Garenne, d'une contenance de cinq journaux, et de plus la cession d'un autre terrain, dit la Petite-Garenne, situé entre le couvent et la Tannerie, contenant deux journaux. — Louis XIII, informé que ces terres étaient incultes, et voulant participer à une bonne oeuvre, en fit l'abandon aux religieux, par lettres patentes du 6 février 1635, à condition d'avoir à perpétuité deux messes chantées par an. Le gouverneur de Vannes, Pierre de Lannion, qui avait la jouissance de ce terrain, abandonna son droit moyennant deux autres services par an. Les formalités remplies, les religieux cédèrent à l'hôtel-Dieu une portion de ces mêmes terrains, suivant un arrangement préparé par eux. D'un autre côté, les Dominicains, dans le but de compléter les édifices de leur couvent, continuaient à acquérir les jardins et les maisons de la rue du Four, du côté du midi, sur une longueur de 354 pieds. En attendant l'exécution de ces grands travaux, ils se contentèrent, en 1669, de construire un pavillon au bout de leur maison du côté de l'est. La communauté comptait alors 27 religieux et le bâtiment primitif était d'une insuffisance manifeste. Bientôt il fallut renoncer à tout projet d'agrandissement : les vocations religieuses devinrent moins nombreuses, et l'opinion publique se laissa prévenir contre les moines. En 1758, pour faciliter l'entrée et la sortie de la ville de Vannes, on ne se gêna point pour tracer à travers l'enclos des Frères Prêcheurs une voie nouvelle, appelée aujourd'hui la rue du Roulage, et marquée sur le plan par deux lignes pointillées. En 1785, les travaux atteignaient les abords du couvent, et en 1786 on construisit près du perron de l'église une maison qui existe encore et qui porte le N° 10. Au mois de novembre 1790, il n'y avait plus que sept religieux ; deux déclarèrent vouloir sortir ; les autres furent expulsés le 1er avril 1791. Les maisons de la rue du Four et les autres immeubles furent vendus en détail. L'enclos et le jardin furent adjugés au sieur Pavec pour 20.400 livres ; la chapelle fut vendue au sieur Houdiart, et servit plus tard aux voitures du roulage ; la maison conventuelle fut affectée au logement de la gendarmerie, et elle a gardé cette destination jusqu'en 1860. C'est alors que le département voulut y transférer l'hôtel de la Préfecture. Il racheta successivement le jardin, l'enclos, la chapelle des religieux et le jardin de l'hôpital. Le 4 octobre 1862, eut lieu l'adjudication des travaux de la préfecture au sieur Normand, pour la somme de 552.580 francs, chiffre qui a été dépassé à cause des modifications apportées au devis primitif. La chapelle et l'ancien couvent ont été démolis pour faire place aux nouvelles constructions. — Inutile de donner ici la description de la préfecture : chacun peut l'examiner et l'apprécier à son point de vue particulier.
XIV. La Garenne
La Garenne est l'extrémité d'un plateau qui s'abaisse doucement vers l'est et le nord, et brusquement vers l'ouest. Si l'on tient compte de son nom, il faut admettre qu'il y avait là jadis des landes et des bruyères, au milieu desquelles les lapins avaient creusé leurs tanières. Au XIème siècle, et au plus tard au XIIème, tout ce terrain, depuis l'étang des Lices jusqu'au ruisseau de Lanoë, et depuis la ruelle du Jointo jusqu'au ruisseau qui descend de l'étang du Duc, probablement même jusqu'à la rue de la Petite-Garenne, fut donné à l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, et servit ensuite à la dotation partielle du prieuré de Saint-Guen. Ce lambeau de territoire se trouvant entre le fief de l'évêque et celui du duc, on se demande naturellement de quel domaine il a été détaché dans l'origine. Si l'on considère que les prieurs de Saint-Guen ont eu constamment juridiction féodale sur leurs terres et leurs hommes, et qu'ils ont toujours reconnu les ducs comme leurs fondateurs, on est porté à croire que la Garenne appartenait primitivement au fief du duc. Vers 1380, Jean IV, faisant construire le château de l'Hermine, voulut prendre environ la moitié de ce terrain, du côté du nord, pour en faire un parc. La ligne de démarcation suivait la rampe de la Garenne et puis le chemin qui conduit à la Tannerie. L'estimation du revenu ayant été faite, le duc, par acte du 11 janvier 1387 (N. S. 1388), assigna au prieur une indemnité annuelle de dix livres, six sols et un denier sur sa recette de Vannes. Les ducs jouirent de ce parc pendant un siècle. Il passa ensuite aux rois de France, qui en abandonnèrent la jouissance aux gouverneurs ou capitaines de Vannes. En 1569, une portion en fut détachée au profit de l'hôpital de Saint-Nicolas. Le surplus était loué à des particuliers ; ainsi le 2 janvier 1602, « la Garaine estant derrière le chasteau de cette ville de Vennes », était affermée à Pierre Moisson, au nom du gouverneur René d'Arradon, pour 25 écus par an, « à la charge de ne rien démolir, ni laisser démolir, ni bescher en aucune façon ». On a vu ci-dessus comment les Dominicains obtinrent de Louis XIII, en 1635, la Petite-Garenne, le marécage intermédiaire et le bas de la Grande-Garenne. Il ne restait plus au roi que le haut de la Garenne et la pente du côté de la ville. En 1678, la communauté de ville proposa d'y établir une promenade publique. Le duc de Chaumes, gouverneur de Bretagne, approuva le projet, mais dés l'année suivante il en suspendit l'exécution, et la colline redevint la pâture des moutons du quartier. En 1698, M. le comte Pierre de Lannion demanda l'afféagement de la Garenne, pour reprendre sa conversion en promenade, et pour laisser au public un témoignage de sa libéralité. Le terrain sollicité avait cinq journaux et 67 cordes. L'affaire réussit. On commença par niveler le sommet de la colline et par y planter des arbres. Dès 1715 on trouve la mention d'allées d'ormeaux. En 1726, le syndic, M. Le Vaillant, représenta à la communauté de ville qu'il serait avantageux aux habitants d'avoir des foires de bestiaux sur la Garenne, tous les mercredis, depuis Pâques jusqu'à Noël. En 1752, en présence d'une disette où il fallait fournir aux pauvres du travail et du pain, l'évêque et la ville réunirent leurs efforts pour conjurer le mal. On accueillit tous les hommes qui se présentèrent, même les femmes, et on les appliqua à tailler en étages la butte de la Garenne du côté de l'ouest, et à y planter des allées d'arbres. Les terres qui en furent tirées servirent à combler la douve en face, et à former le jardin qui court le long des murs de la ville, et qui n'était avant cette époque qu'un marais inondé par l'eau du ruisseau et par celle de la mer. La promenade de la Garenne a été témoin d'un drame sanglant en 1795. C'est là, le long du mur qui borde l'ancien enclos de l'hôpital, que furent conduits, le 30 juillet à sept heures du matin, Mgr de Hercé, évêque de Dol, M. de Sombreuil, quelques royalistes et quatorze prêtres de divers diocèses, tous condamnés à mort, à la suite du désastre de Quiberon. Ils avaient tous les mains liées derrière le dos. Mgr de Hercé demanda qu'on lui ôtât son chapeau, afin de faire plus respectueusement sa dernière prière. Un grenadier se disposant à lui rendre ce service, M. de Sombreuil lui dit : « Laisse, tu n'en es pas digne », et il enleva le chapeau avec les dents, n'ayant pas les mains libres. Quelques instants après, ils tombaient tous sous les balles des républicains, et leurs corps étaient portés au cimetière de Vannes. Plus tard, en 1814, leurs ossements furent exhumés et déposés, avec ceux des autres victimes de la Révolution, dans la chapelle de Saint-Louis à la cathédrale. La croix pectorale de Mgr de Hercé est conservée à l'évêché de Vannes, et le chapitre possède sa custode pour le viatique et son ampoule pour l'extrême-onction. C'est également sur la Garenne que fut amené, le 4 janvier 1805, l'intrépide Pierre Guillemot, surnommé le roi de Bignan, l'un des principaux chefs de la Chouannerie. Il avait été condamné, la veille de ce jour, à la peine de mort, par une commission militaire réunie à la mairie. Comme il ne pouvait marcher, à cause de ses blessures, il fut porté au lieu de l'exécution, et il reçut la mort avec le courage d'un soldat et d'un chrétien. C'est sur la Garenne aussi que furent passés par les armes, le 7 octobre 1806, Edouard de la Haye de Saint-Hilaire et Jean Billy, coupables d'avoir arrêté l'évêque de Vannes sur la route de Monterblanc et de lui avoir extorqué 24.000 francs ; ils avant été pris les armes à la main, après avoir tué un brigadier de gendarmerie (nota : un monument a été élevé sur la Garennes à la mémoire des morts de la grande-guerre 1914-1918).
XV. Hôpital de Saint-Yves
L'hôpital de
Saint-Yves ou
de la Garenne n'a été fondé qu'en
1698. Madame Marie de Berrolles, veuve de Jean Hélo de Kerborgne, avocat au parlement, touchée de compassion
en voyant errer dans la ville et mendier de porte en porte des pauvres atteints de maux
incurables, et voyant qu'on ne pouvait les recevoir dans aucun hôpital de Vannes,
résolut de leur ouvrir un asile sur la Garenne, non loin
de sa maison du Verger. En conséquence elle acheta, dès
le 21 février 1698, de M. Vincent Marquet, sieur de
Kermarquer, au prix de 1.800 livres , les maisons de la
Garenne occupées par Mlle Golvine de la
Chaussonnière, avec cour devant, jardin derrière,
et pré ou verger à la suite, à la charge de foi et hommage
au prieur de Saint-Guen. Au nord de ces maisons et le long
du chemin qui descend vers la Tannerie, il y avait un
terrain de 135 pieds de longueur sur 30 pieds de largeur,
qui servait parfois de cimetière aux pestiférés. La
fondatrice, croyant qu'il appartenait
à la ville, le demanda pour l'établissement de ses pauvres
incurables, et l'obtint, suivant délibération du 6 juin 1698. Mais ayant su plus
tard qu'il appartenait réellement au prieur de Saint-Guen, elle le pria d'en ratifier la concession.
C'est
sur ce terrain qu'elle établit les fondements d'une chapelle
et d'une première salle pour les incurables. Mme la présidente
de Montigny, en 1699, fit bâtir la chapelle, en forme de rectangle, et y mit la statue de
saint Yves, patron de
son fils, et par suite patron de l'établissement. En 1700, le 20 août, Mme de Berrolles-Hélo obtint du prieur
de Saint-Guen, moyennant une rente de 5 sols, l'afféagement « d'un vieux chemin conduisant du bas de la
Garenne à la croix du Jointo, et faisant la séparation de l'enclos des Incurable et de celui du Verger », et conformément à l'autorisation donnée,
elle le boucha et le fit entrer
dans le jardin de l'hôpital. Puis, pour une autre rente de 5 sols, elle obtint une augmentation de terrain à la
suite du cimetière, de manière à avoir un journal en
tout. L'établissement des
Incurables était fondé. Pour le rendre perpétuel, la fondatrice l'offrit en
toute
propriété à la communauté de ville, qui la refusa à cause des charges.
Elle l'offrit, le 10 août 1705, à l'évêque de Vannes, qui l'accepta malgré
les charges et en vue du soulagement des pauvres. Mgr d'Argouges le confia, dès
le 12 décembre 1705, aux Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, établies
dans la rue de Poulho depuis une vingtaine d'années. Voulant ensuite procurer
à la maison une existence légale, il obtint de Louis XIV, au mois de décembre
1711, des lettres patentes confirmant l'hôpital des Incurables, et imposant en
retour une messe chantée au jour de la Saint-Louis de chaque année. Avant de
mourir, en 1716, l'évêque légua 20.000 livres pour l'entretien des pauvres.
Mgr Fagon fit rebâtir en 1735 la salle des hommes, située à l'ouest de la
chapelle, et Mgr de Bertin celle des femmes en 1748. L'hôpital renfermait 20
lits pour les hommes et 40 pour les femmes ; ils avaient été dotés par divers
particuliers, qui, en général, s'étaient réservé, pour eux et leurs héritiers,
le droit de présenter les malades. Les Soeurs également étaient dotées ;
elles étaient au nombre de huit, dont quatre pour l'hôpital, deux pour des
oeuvres annexes, et deux pour la visite des pauvres et des malades en ville. Le
2 juin 1791, elles ne voulurent pas recevoir la visite de l'évêque
constitutionnel, et deux jours après, le directoire du département arrêta
qu'elles seraient renvoyées le plus tôt possible. Deux citoyennes furent chargées
de les remplacer. Les biens meubles et immeubles furent tous attribués à la
Commission des Hospices de Vannes, pour conserver leur destination. Après la
tempête révolutionnaire, l'administration des hospices arrêta, le 7 juillet
1803, que l'établissement de la Garenne serait remis à la disposition et aux
soins des Soeurs de la Charité, et que le préfet serait prié d'approuver
cette mesure. L'approbation fut donnée le jour même. Quatre filles de la
Charité vinrent aussitôt reprendre le service des Incurables ; et en 1806 deux
autres soeurs leur furent adjointes. Le bureau de bienfaisance ayant été
transféré à la Garenne, en 1842, réclama deux nouvelles Filles de la Charité,
l'une pour le quartier de Saint-Patern, l'autre pour celui de Saint-Pierre. De
cette façon le personnel des Soeurs se trouva reconstitué comme avant la Révolution.
Cependant la Commission des Hospices, en vue de faire des économies, songeait
depuis longtemps à supprimer l'hôpital de Saint-Yves. La décision fut prise
en 1866 : les Soeurs de Saint-Vincent de Paul furent appelées à l'hôpital du
Petit-Couvent, pour remplacer les Augustines ; les malades furent partagés
entre le Petit-Couvent et l'hôpital général, et la maison de la Garenne fut
fermée. Cette maison toutefois reprit bientôt une destination religieuse. En
1868, elle fut rachetée par la soeur Félicité Le Quette, supérieure générale
des Filles de la Charité, et immédiatement l'oeuvre de la Providence y fut
transférée. Cette oeuvre, commencée en 1830 par Mme Bernard, Mlle Maillard et
Mlle A. Hervieu, avait pour but de retirer des mains de leurs parents vicieux ou
pauvres les jeunes filles dont la moralité se trouvait compromise. Elle fut
installée en 1834 au n° 7 de la rue du Nord, dans une maison acquise par M.
Hervieu. En 1851, Mlle Ambroisine Hervieu, voyant l'oeuvre prendre des développements,
la confia aux Soeurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Celles-ci
construisirent une chapelle spacieuse, et obtinrent en 1858 la reconnaissance légale
de leur maison. En 1868, elles quittèrent la rue du Nord, pour s'établir à la
Garenne, où il y avait plus d'espace et plus d'air. Elles y ont bâti en 1874
une vaste maison, et démoli l'ancienne qui la masquait. A leur oeuvre de la
Providence, elles ont ajouté des écoles libres pour les externes, un ouvroir
pour les jeunes filles, et une maison de patronage.
XVI. Frères des Ecoles chrétiennes
En descendant la rampe de la Garenne, on voit à gauche l'établissement des Frère des Ecoles chrétiennes. Ces modestes et laborieux instituteurs du peuple ont été fondés par le B. Jean-Baptiste de la Salle, mort à Saint-Yon, près de Rouen, le 7 avril 1719. Dès 1751, Mgr de Bertin, évêque de Vannes, voulut procurer à sa ville épiscopale quelques-uns de ces Frères. Dans l'assemblée de la communauté tenue le 19 avril de cette année, M. Gillot de Kerhardène, avocat, fit la remontrance suivante : « Mgr notre évêque, toujours attentif à tout ce qui peut contribuer à faire le bonheur des habitants de Vannes, et pénétré de tous les désordres que cause l'abandon dans lequel ils élèvent leurs enfants, faute d'instruction, a prié M. le Maire de représenter à la communauté qu'il ne lui a pas paru de moyen plus prompt ni plus efficace, pour remédier à un aussi grave abus, que celui d'une école charitable ; que dans cette vue il a réussi, avec le secours de quelques personnes zélées, à trouver un fonds suffisant pour établir dès à présent trois Frères des Ecoles chrétiennes, autrement dits Frères de Saint-Yon ; que son intention est d'établir dans la suite deux autres Frères, pour former deux écoles, l'une dans le quartier de Saint-Salomon, et l'autre dans celui de Saint-Patent ; le prélat ajoute que connaissant par lui-même la modicité des facultés de la communauté, et son impuissance à contribuer à un établissement aussi utile, il ne lui demande qu'un simple acte de reconnaissance du grand bien qui résultera de cette bonne oeuvre, et d'y consentir à l'effet d'obtenir des lettres patentes à ce nécessaires... ». Le consentement sollicité fut donné sans peine. Ce ne fut cependant qu'en 1754 que les Frères arrivèrent à Vannes et furent installés en la rue de Poulho ou Richemont, dans une maison qui porte aujourd'hui le no 14. Deux Frères furent chargés de l'école de Poulho, et deux autres de celle de Sainte-Catherine près Saint-Patern, avec mission d'enseigner la lecture, l'écriture, l'orthographe et l'arithmétique. Un cinquième Frère fut chargé d'un cours d'hydrographie et de pilotage, science très appréciée dans une ville maritime. La communauté, satisfaite de leur enseignement, leur accorda plusieurs fois des gratifications, et en 1790 elle vota un traitement de 400 francs pour un sixième Frère. L'année suivante, toutes ces classes croulèrent par suite du serment schismatique demandé aux Frères et noblement refusé par eux. Ce n'est qu'en 1817 que les Frères revinrent à Vannes. Le conseil municipal leur affecta pour logement leur ancienne maison, et vota un traitement de 600 francs pour chacun des deux Frères. Il appela un 3ème Frère en 1819, un 4ème en 1821 et un 5ème en 1823, toujours au même taux. L'école de Saint-Patern fut rétablie en 1825, et celle de Poulho transférée en 1828 dans la rue de l'Unité, N° 3 et 5. Cet état de choses se maintint, à la satisfaction générale des familles, pendant un demi-siècle, c'est-à-dire jusqu'aux funestes lois de la laïcisation. Le 7 juin 1882, l'école des Frères de Saint-Patern fut laïcisée, et le 4 avril de l'année suivante, une école chrétienne libre, destinée à la remplacer, fut ouverte dans les appartements qui forment aujourd'hui la Salle Saint-François, au bas de la Garenne. Le 29 juillet 1883, les Frères de Saint-Pierre furent à leur tour remplacés par des maîtres laïcs, et grâce aux souscriptions des catholiques, une vaste maison d'école fut construite sur la pente de la Garenne, et inaugurée le 10 janvier 1884. Le nombre des enfants continuant à augmenter et les maîtres n'ayant pas de logement suffisant, il fallut en 1891 construire une seconde maison, à gauche de l'escalier d'entrée, et même acquérir peu après le terrain sur lequel s'élèvent ces diverses constructions. Les catholiques ont versé pour cet établissement environ 275.000 francs, et ils sont fiers de garder chez eux, à ce prix, les instituteurs qui jouissent de leur confiance. A la suite de la suppression des congrégations enseignantes, les Frères ont dû quitter leur habit religieux et se séculariser pour continuer l'enseignement libre.
XVII. Capucins - Ursulines
Les Capucins furent appelés à Vannes, en 1614, par M. Laurent Peschart, conseiller au parlement, et par Julienne Phélippot, sa femme, sieur et dame de Limoges, de Lourme, de Coetergarf, etc... Ils reçurent d'eux un coin de leur enclos de Limoges, à l'extrémité de la rue de Calmont-Haut ou de Séné. Le terrain, c'était beaucoup ; mais il fallait bâtir. Pour diminuer les frais, les Capucins sollicitèrent et obtinrent du roi Louis XIII, au mois d'août 1614, les pierres du château ruiné de Lestrénic, près de Saint-Laurent, en Séné. Les bâtiments, suivant l'usage, furent disposés autour d'un cloître carré, savoir, au nord l'église, à l'est et au sud les offices et les chambres des religieux. Les travaux n'étaient pas encore complètement terminés quand les Capucins s'y établirent le 19 avril 1615 : c'est du moins la date fournie par une note d'un ancien registre des Carmélites. Il paraît que ces constructions hâtives laissaient beaucoup à désirer, car dès 1630 la communauté de ville « deubment avertie de la ruine de la couverture de l'église des Capucins, et de la ruine de la muraille du chanceau, chargea le procureur syndic de leur donner la somme de mille livres, par les mains de Pierre de Sérent, sieur d'Aguenéac, leur père spirituel, pour aider à la réparation nécessaire, les seigneurs des Comptes suppliés de passer la dite somme en allocation ». — En même temps l'assemblée chargea le syndic de faire faire sept confessionnaux pour les religieux (Mairie, Délibérations). Du reste, les Capucins méritaient cette bienveillance par leurs services. Au commencement de 1633, la peste ravageait la ville de Vannes, et des baraques avaient été établies sur la Garenne, pour isoler les malades pauvres. Les Capucins se dévouèrent au salut de ces malheureux ; deux d'entre eux furent atteints de la peste et y succombèrent, savoir, le P. Anaclet de Rennes, mort le 26 février, et le P. Emmanuel de la Chapelle, mort le 28 du même mois. Ils furent inhumés sur la Garenne, dans le cimetière des pestiférés, comme les autres victimes du fléau. Quatorze ans plus tard, le 10 juin 1647, leurs ossements furent exhumés, puis placés dans une petite châsse en chêne, avec une double inscription sur ardoise, transportés processionnellement à l'église des Capucins, et déposés sous les marches du grand autel, du côté de l'évangile. C'est dans une chapelle de cette église que les seigneurs de Limoges avaient leur sépulture. Là furent enterrés, en 1679, François de Trévegat, conseiller au parlement ; en 1687, Françoise de Quélen, sa veuve ; en 1711, René de Trévegat, son frère, conseiller au parlement ; Françoise de Francheville, femme de René ; en 1728, Vincent de Trévegat, fils de François ; en 1733, Joseph de Trévegat, fils de René, conseiller au parlement, et Jean-Marie de Trévegat, fils de Joseph. On y voit encore cette inscription : « De toute la famille des Trévegat de Limoges il ne reste que les cendres ; la chapelle de ce monastère, dont ils étaient les fondateurs, les renferme. Dieu a récompensé leurs oeuvres. Imitez-les : le Seigneur vous pardonnera. Priez Dieu pour le repos de leurs âmes ». La communauté de ville, qui avait montré sa bienveillance envers les Capucins en plusieurs occasions, en donna une nouvelle preuve le 10 mai 1713, en acceptant l'invitation du P. Gardien d'assister aux fêtes de saint Félix de Cantalice. « La maison de ville assistera et marchera en corps à la procession générale pour l'ouverture des indulgences de la canonisation de saint Félix, dimanche prochain ; et comme les RR. PP. Capucins sont hors d'estat de subvenir à la dépense où ils se sont engagés pour cette canonisation, la communauté a arresté que M. de Glavignac, lieutenant de maire, écrira incessamment à Mgr l'Intendant, pour le supplier de permettre à la communauté de disposer de ce qu'il voudra bien régler, tant pour donner aux religieux Capucins, que pour subvenir aux frais d'un feu de joie et décharge d'artillerie, qu'il aura la bonté de permettre ; et a aussy arresté que les milices prendront les armes... ». En 1790, le couvent n'avait plus que quatre religieux, qui tous déclarèrent vouloir continuer la vie commune. En 1791, plusieurs Capucins étrangers vinrent y chercher un refuge ; mais ils furent tous expulsés le 27 juin et la maison fut fermée. Dès le 30 janvier 1792, l'église, le couvent et l'enclos furent vendus au sieur Danet aîné, pour 11.175 livres.
D'un autre côté, les Ursulines de Muzillac, de la congrégation de Paris, dispersées par la Révolution, s'étaient réunies à Vannes, au nombre de sept, dans une maison dite de la Sentière, sur la Rabine, et dès 1804 elles y avaient ouvert un petit pensionnat. Elles conservaient toujours l'espoir de rentrer dans leur ancien couvent, quand Mgr de Pancemont les engagea à s'établir définitivement à Vannes. Sur son conseil, elles rachetèrent l'ancien établissement des Capucins, et en prirent possession le 1er juillet 1807. Plusieurs soeurs dispersées vinrent les y rejoindre, et au bout de six mois on comptait vingt religieuses anciennes. Depuis ce temps la communauté a été toujours en augmentant ; elle a même doublé le nombre de ses membres. Les Ursulines ont conservé l'église des Capucins dans sa simplicité primitive. Ne pouvant plus conserver pour leur usage le chœur des religieux, situé derrière le maître-autel, elles ont fait construire pour elles un choeur dans l'ancien cloître, et ouvrir une grille du côté de l'épître, afin de voir le prêtre à l'autel. Pour répondre au désir des familles et favoriser le développement de leurs oeuvres, elles ont construit au midi du couvent une vaste maison pour le pensionnat (1857). En 1878, elles ont bâti au nord de la chapelle deux corps de bâtiments pour les demi-pensionnaires, pour les novices et pour différents besoins de la communauté. Violemment expulsées de leur maison le 27 août 1907 ; les Ursulines se sont réfugiées à Cassano, près de Milan, en Italie. Leur établissement, confisqué par l'Etat, a été racheté régulièrement par Mgr Gouraud, évêque de Vannes, et transformé en grand et petit séminaire (nota : les Ursulines sont maintenant au Ménimur, où elles ont un pensionnat).
XVIII. Port de Vannes
Le port de Vannes, dont l'origine, était simplement le lit commun des ruisseaux de Rohan et de Bilair, ou en d'autres termes, de l'étang de l'Evêque et de l'étang du Duc. La mer est venue graduellement élargir ce lit, soit en rongeant les terres molles, soit en profitant de l'affaissement du sol. Ce phénomène de la lente immersion de nos côtes, constaté dès la période celtique à l'île d'Er-Lannig, à Locmariaker et ailleurs, s'est continué pendant la période romaine, et semble durer encore. Depuis quelques siècles néanmoins, il est entravé dans le port de Vannes par l'arrivée des égouts et par le dépôt des vases marines. C'est dans les archives du prieuré de Saint-Martin de Josselin qu'on trouve les premières mentions du port de Vannes au moyen âge. Ainsi, en 1164, on voit Eudon de Porhoët, comte de Bretagne, donner à ce prieuré le tiers des droits perçus sur les vins débarqués à Vannes, et Alain II, vicomte de Rohan, son cousin, donner un autre tiers de ce même droit de vinage ou de bouteillage, ce qui fut confirmé en 1205. Plus tard, en 1338, on trouve un accord passé entre le prieur de Saint-Martin et les bourgeois de Vannes, et fixant à cinq deniers le droit à percevoir sur chaque tonneau de vin. En 1392, les revenus du prieur ayant été saisis, sous prétexte qu'il devait entretenir un gardien du port, et contribuer au curage du canal, une enquête prouva que ces charges ne le concernaient aucunement, et le duc Jean IV lui rendit ses droits. — En 1475, on lui chercha une autre querelle à propos du balisage, qu'on voulait mettre à sa charge, au moins en partie, et il montra par ses titres que jamais ses prédécesseurs n'y avaient été soumis. Les droits de Saint-Martin passèrent aux Carmélites de Nazareth. C'est dans le port de Vannes que saint Vincent Ferrier s'embarqua, une douzaine de jours avant sa mort, pour retourner en Espagne ; mais la maladie s'étant aggravée tout d'un coup, il fut obligé de revenir au port, et il fut accueilli au son de toutes les cloches de la ville. En souvenir de ce retour joyeux, on bâtit plus tard, en face de la porte de Calmont, sur une petite place, une chapelle qui fut appelée le Féty ou le Fétis, nom dérivé peut-être du latin Festivus. Sur l'autre rive du port, près de l'endroit où se trouve aujourd'hui le kiosque de la musique, on édifia une autre chapelle en l'honneur de saint Julien et on y ajouta un cimetière, avec une maison pour un chapelain. En 1567, le quai correspondant au commencement de la Rabine actuelle était un chantier de construction pour les navires ; il fut demandé au roi par divers particuliers pour y bâtir des maisons. Cette demande fut renouvelée en 1598 par Julien de Montigny, sieur de la Hautière, et en 1609 par le sieur Hillaire, mais toujours la communauté de ville y mit opposition. Au delà de ce terrain, en face de la chapelle actuelle de l'évêché, il y avait un ruisseau et un pont et une grande vasière jusqu'à la mer. Plus loin se trouvait la chapelle de Saint-Julien avec ses dépendances. Beaucoup plus loin était le manoir de la Sentière, au delà duquel le canal du port tournait brusquement vers l'ouest, avant de se diriger vers le sud. Dès 1680, la communauté de ville voyant les vases encombrer le port de plus en plus et arrêter la marche des grands navires, demanda l'autorisation de construire une écluse. L'autorisation fut accordée, les plans de l'écluse furent dressés, puis... les guerres arrêtèrent tout. Vers 1718, les habitants de Vannes revinrent à la charge, et demandèrent la permission « de faire curer le canal du port jusqu'au lieu de la croix rouge, en face du chemin des Capucins, de faire des talus des deux côtés pour arrêter les vases, de continuer les quais jusqu'au lieu de la Sentière, et enfin de faire construire une écluse dans le lieu le plus utile, et d'emprunter une somme de 30.000 livres, pour subvenir aux premières avances ». C'est alors qu'on transféra le chantier de construction au delà de la croix rouge, et qu'après avoir nivelé son ancien emplacement, on y planta des allées d'arbres, depuis un pâté de maisons isolées jusqu'au lais de mer situé devant les Carmes. Telle est l'origine de la belle promenade de la Rabine. Peu après (1725-1735), on construisit le quai du côté de Calmont-Bas, avec les pierres provenant du vieux château de l'Hermine. Vers 1760, on voulut couper la butte de Kerino, afin de rectifier le canal et d'éviter le circuit que faisaient les navires vers Trussac en entrant ou en sortant du port. Mais le lieu, parait-il, avait été mal choisi, et les travaux furent abandonnés en 1761 par ordre du duc d'Aiguillon. Les terres provenant de cette butte servirent à combler les fonds vaseux voisins de la chapelle de Saint-Julien,. et l'on y planta de nouvelles rangées d'arbres pour prolonger la promenade de la Rabine. Le quai de ce côté fut également prolongé. En 1824 on reprit le projet du percement de la butte de Kerino, et cette fois l'entreprise fut menée à bonne fin. L'entrée du vieux canal de Trussac fut bouchée, une partie des terrains de la Sentière fut acquise et la promenade de la Rabine reçut un nouveau prolongement. Le quai de Calmont-Bas, qui avait déjà reçu quelques arbres, fut régulièrement planté, en 1847, jusqu'au chantier de construction. Ce chantier a été prospère jusqu'à nos jours, grâce au bon marché du bois et à celui de la main-d'oeuvre. On y a construit des navires d'un assez fort tonnage ; mais aujourd'hui il est à peu près désert. Le port lui-même, qui recevait jadis de nombreux navires, a vu son commerce diminuer sensiblement par la concurrence victorieuse des chemins de fer. Les navires d'un tonnage moyen peuvent toujours y arriver, en profitant de la marée. C'est en 1884 qu'on a nivelé la butte de Kerino du côté de Trussac, ce qui a permis de prolonger la Rabine jusqu'au Pont-Vert, et de rectifier la route de Conleau.
XIX. Père Eternel - Saint-Louis
La maison religieuse dite du Père-Eternel doit son origine à Mlle Jeanne de Quélen de Monteville. Cette noble et pieuse fille, voulant procurer aux femmes un asile pour y faire des retraites spirituelles, acquit en 1668 et 1669 « une grande maison, située proche la chapelle de Saint-Julien et le couvent des Carmes Déchaussés, sur le port de Vannes, avec une cour et un grand jardin derrière », pour le prix de 6.200 livres, sans compter les réparations qui montèrent à près de 3.000 livres. Dès le 30 octobre 1671, par acte notarié, elle donna cette maison « au Père-Eternel, pour y recevoir en retraite des femmes et des filles », et la mit à cet effet à la disposition de l'évêque, de l'archidiacre et du recteur de Saint-Patern, et de leurs successeurs. Bientôt elle renonça aux retraites, pour laisser le champ libre à Mlle de Francheville, qui avait entrepris la même oeuvre, et, en 1674, elle ouvrit sa maison pour y recevoir cinq filles pauvres et nobles qui voudraient vivre en communauté, sous la règle du Carmel. C'est là qu'elle mourut pieusement, au milieu de ses filles, le 25 mai 1689, à l'âge de 65 ans, laissant comme oeuvre principale l'Adoration du Saint-Sacrement. En 1703 ses filles obtinrent du pape et de l'évêque l'érection de leur maison en monastère, la substitution de la règle de saint Augustin à celle des tertiaires du Carmel, et le remplacement de leurs vœux simples par des vœux solennels. Puis elles obtinrent du roi Louis XIV l'autorisation de dépasser leur nombre primitif de cinq religieuses de choeur, et de s'adjoindre des soeurs converses et tourières, comme dans les autres communautés. Tant que la communauté avait été peu nombreuse, l'adoration du Saint-Sacrement avait été forcément diurne et intermittente. Le nombre des sujets ayant, avec le temps, pris une certaine extension, les religieuses demandèrent à l'évêque d'ériger canoniquement l'Adoration perpétuelle de jour et de nuit pour leur communauté. Le 30 mars 1761, Mgr de Bertin statua ce qui suit : - 1° Il y aura toujours et à perpétuité, à chaque heure du jour et de la nuit, une des religieuses devant le Saint-Sacrement. - 2° Chaque religieuse, en finissant son heure d'adoration, le jour ou la nuit, tintera cinq coups de cloche, afin de prouver qu'on est toujours vigilant à remplir ce saint exercice. - 3° Chaque fille qui sera reçue à l'avenir dans cette maison fera le voeu particulier de se consacrer à l'adoration perpétuelle, lequel sera joint aux autres voeux de l'état religieux... Enfin, pour se rendre de plus en plus utiles au public, les religieuses du Père-Eternel consentirent à recevoir des dames pensionnaires, et, ce qui est bien plus charitable, de pauvres femmes qui avaient perdu la raison, et qui étaient confiées par leurs familles à leur dévouement éprouvé. En 1790, le couvent donnait asile à vingt pensionnaires et renfermait sept folles. A cette époque, la communauté comprenait 26 personnes, dont 18 professes, 6 converses et 2 novices. Toutes déclarèrent vouloir persévérer dans le genre de vie qu'elles avaient librement choisi. Elles n'en furent pas moins brutalement chassées de leur maison et jetées sur le pavé le 1er octobre 1792. Le 15 décembre de la même année, le couvent, l'église et l'enclos furent vendus nationalement au sieur Bécheu, pour la somme de 10.100 livres. Après la Révolution, dès la fin de 1802, ces immeubles furent rachetés par Mme Marie-Louise-Elisabeth de Lamoignon, veuve de M. Molé de Champlatreux, qui avait suivi Mgr de Pancemont à Vannes, et qui se proposait de rétablir la vie religieuse dans cette ville. Le 25 mars 1803, elle reçut le voile des mains de l'évêque, en même temps que six autres compagnes, qu'elle avait recrutées à Paris et prit le nom de soeur Saint-Louis. Elle avait alors 40 ans. Son but était, non seulement de travailler à sa sanctification et à celle de ses soeurs par la pratique des voeux de religion, mais encore d'instruire gratuitement les enfants pauvres et de les placer ensuite avantageusement dans le monde. A l'instruction elle joignit le travail manuel, la couture et la dentelle. Ce côté charitable de l'oeuvre fut celui qui d'abord attira sur elle l'attention du public, et qui lui valut bientôt la reconnaissance officielle du gouvernement. Son institut prit le nom de la Charité de Saint-Louis, et en moins de deux ans compta 18 religieuses. Aux dames de choeur, la fondatrice joignit plus tard des soeurs converses, chargées plus spécialement du matériel de la maison. Quand Mgr de Pancemont mourut (13 mars 1807), elle obtint que son corps fût inhumé dans un oratoire de son enclos, où sa tombe se voit encore aujourd'hui. Outre la maison principale de Vannes, Mme Molé fonda l'établissement d'Auray en 1807, et celui de Pléchatel en 1816, et sur son lit de mort, en 1825, elle signa l'acquisition de l'ancienne abbaye de Saint-Gildas de Rhuys. Depuis cette époque, la congrégation a fondé des succursales à Lorient en 1837, à Paimpont en 1846, à Guer en 1851, à Pontivy en 1852, à Crédin en 1855, à Rohan en 1877, à Belz, à Cléguer et à Etel. La maison-mère elle-même a reçu d'importantes améliorations. Au couvent du Père-Eternel, reconnaissable à ses petites fenêtres, on a ajouté vers l'ouest un spacieux bâtiment, et vers l'est, en face de l'entrée, un nouveau corps de logis. Pour remplacer l'ancienne chapelle de l'Adoration, on a construit en 1877, sur les plans de M. Charier, une église de style ogival, en forme de croix latine, avec un autel sculpté et des vitraux peints. Elle a été consacrée en 1880. L'enclos lui-même a été agrandi et suffit largement aux besoins de la communauté. Aux oeuvres primitives, on a récemment ajouté des écoles libres, qui ont été fermées par l'application de nouvelles lois.
XX. Carmes - Evêché
Tout
près du couvent du Père-Eternel, se trouve celui des Carmes déchaussés,
devenu plus tard l'Evêché. Les Carmes déchaussés sont une branche de
l'Ordre des Carmes. Ils
ont commencé en Espagne en 1568, sous l'inspiration de sainte Thérèse et de saint
Jean de la Croix, et ont pénétré en France en 1611. Messire
Jean Morin, seigneur du Bois-de-Tréhant, président
du présidial de Vannes, et Jeanne Huteau, sa femme, voyant
deux de leurs enfants entrés chez les Carmes déchaussés de Paris, résolurent
de fonder un couvent de leur ordre à Vannes.
Après avoir obtenu l'autorisation de l'évêque et celle de la communauté
de ville pour l'établissement, ils offrirent
aux religieux leur maison située dans le quartier du
port, près de la chapelle de Saint-Julien, avec les jardins et
la prairie y attenants ; ils y ajoutèrent la propriété de l'île
de Lerne, dans le golfe du Morbihan ; et pour remplacer
les quêtes, ils leur assignèrent une rente annuelle de 500
livres tournois, qu'ils hypothéquèrent sur leur propriété du Trest en Sarzeau, se réservant à eux et à leurs successeurs
la faculté de retirer cette hypothèque, pour la transférer sur une
autre terre. Les
Carmes arrivèrent à Vannes, au nombre de six, le 1er juin 1627, et furent mis en possession des immeubles
par les fondateurs. L'établissement fut accepté par les supérieurs de l'Ordre en 1629, et sanctionné peu après
par le roi Louis XIII. La
première construction entreprise par les Carmes déchaussés
fut celle de l'église, dont la première pierre fut solennellement posée par
le prince de Condé, le 3 mai 1629, pendant
la tenue des Etats de Bretagne, et bénite par l'évêque. La seconde construction fut celle
du couvent, dont la première pierre fut placée, le
14 juin 1632, par le fondateur, Jean
Morin. La maison occupa l'ouest et le sud du cloître ; celui-ci,
placé au midi de l'église, se composa de piliers massifs
et carrés, réunis par des arcades en plein cintre. Outre l'enclos, les Carmes reçurent
une grande prairie, qui lui était contiguë vers
l'ouest. De plus, pour s'affranchir de tout voisinage
importun, ils acquirent, en 1632, la maison Bidé
située à l'entrée de la rue Drézen, avec les maisonnettes et
jardins adjacents. Ainsi se trouva définitivement construit le couvent,
avec ses possessions immédiates. L'église
des Carmes déchaussés reçut bientôt de nombreuses
sépultures. Le fondateur, Jean Morin, fut inhumé dans le choeur en
1646 ; son beau-frère, Jacques Huteau, sieur
de la Haye-Pallée, choisit sa sépulture dans la première chapelle de
la nef du côté de l'évangile, dédiée à saint Joseph ; d'autres furent
enterrés dans la chapelle suivante, la première à gauche en entrant dans
l'église ; Maurile de Bréhant, comte de
Mauron, fut inhumé en 1688 dans la
chapelle de l'Ange-Gardien, la première à droite en entrant ; la
chapelle au-dessus, dédiée à la sainte Vierge, reçut
la dépouille mortelle de Daniel de Francheville en 1656 ; de Claude de Francheville en 1682 ; et de Thomas de
Francheville
en 1686 ; les Lantivy, les Quifistre de Bavalan, les Henry de Bohal,
les Dondel, etc... eurent des tombes réservées en divers endroits de
l'église. Quand
un arrêt du parlement de Bretagne vint, en 1719, défendre d'inhumer désormais
personne dans les églises et chapelles, sauf ceux qui
auraient un droit d'enfeu bien établi, les
Carmes se soumirent, et dès l'année suivante ils firent bénir un
petit cimetière situé entre leur cloître et la rue, dans un endroit où le
public pouvait pénétrer sans passer par la communauté. Cependant
l'église bâtie en 1629 menaçait ruine dans sa partie
antérieure ; quand on voulut la restaurer en 1734, on reconnut que tout
était à refaire jusqu'au choeur. Il fallut se résigner
à tout reconstruire. La nouvelle église,
telle qu'on la voit aujourd'hui, est un édifice
en forme de parallélogramme et de style renaissance. La façade, toute
en pierre de taille, offre une porte majestueuse, surmontée d'une grande
fenêtre, et au-dessus la date de 1737,
qui est celle de son achèvement. A l'intérieur, des
piliers carrés supportent des arcades en plein cintre et partagent
l'église en trois nefs. Il n'y eut plus qu'un autel dans
chaque bas côté. Dans le sanctuaire, il y avait à droite une
chapelle de Sainte-Thérèse, à gauche un oratoire sous le clocher, et
au fond le maître-autel de l'église. Bientôt
la Révolution arriva menaçante. Le 25 novembre 1790, la communauté comprenait 10
religieux profès et 2
frères. Sur ce nombre, 4 pères et un frère déclarèrent vouloir cesser la vie commune ; les 7 autres restèrent
fermes,
mais ils furent expulsés le 1er avril suivant. Tous les biens meubles et
immeubles de la communauté furent vendus aux enchères. Il n'y eut d'exception
que pour l'église, le couvent et l'enclos. On eut lieu de s'en féliciter
quelques années plus tard. Mgr de Pancemont, en arrivant à Vannes le 11 août
1802, n'avait pas de logement réservé, car l'ancien palais épiscopal de la
Motte était occupé par le préfet. L'évêque demanda qu'on mît à sa
disposition l'ancien couvent des Carmes déchaussés, afin d'y établir son
logement et son secrétariat. Le gouvernement prit aussitôt l'arrêté suivant
:
« Saint-Cloud, le 26 brumaire l'an IX de la République une et
indivisible (17 novembre 1802) ». Les Consuls de la République arrêtent
: « Article 1er. — Les maisons et jardins des ci-devant
Carmes à Vannes seront donnés pour logement à l'Evêque de Vannes. Article 2.
— Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le premier Consul : BONAPARTE ». Depuis ce temps, l'ancien couvent des
Carmes servit de palais épiscopal. C'est une habitation à peu près
suffisante, mais qui a le grave inconvénient d'être trop éloignée de la cathédrale
; en revanche on y trouve un magnifique enclos, renfermant jardin, prairie et pièce
d'eau. La chapelle adjacente, après avoir été longtemps abandonnée, a subi
d'importantes réparations à partir de 1865. Cette propriété a été vendue
par l'Etat à la ville de Vannes après la confiscation des biens ecclésiastiques
(nota : La ville a transporté son musée de peinture dans ce couvent, et
organisé un terrain de sports dans le jardin).
XXI. Ursulines - Jésuites
C'est le 29 août 1627 que la mère Louise Guays, dite de Jésus, supérieure des Ursulines de Tréguier, congrégation de Bordeaux, conduisit une colonie de cinq religieuses à Vannes, après avoir au préalable obtenu la permission de l'évêque et celle de la ville. Elle s'établit prés du port, sur la terre de Kaer, ce qui offusqua d'abord quelques négociants, qui craignaient pour leur commerce ; mais tout se calma avec le temps. Elle organise le logement provisoire des soeurs, ouvrit des classes pour les jeunes filles et dut retourner au bout de cinq mois à son couvent de Tréguier. La mère Jeanne Rolland, dite des Séraphins, désignée comme supérieure en 1628, acheta divers immeubles donnant sur la rue du Port, aujourd'hui rue Thiers, et sur la rue de Comohic, actuellement rue de l'Unité. Elle fit faire une chapelle provisoire et commença le grand corps de logis qui forme aujourd'hui le côté oriental du cloître ; on y voyait en bas le choeur des religieuses, et, au-dessus, des chambres et des cellules pour la communauté. La mère Suzanne Guays, dite Marie des Anges, élue supérieure en 1641, continua les acquisitions commencées par ses devancières. Elle obtint que les Jésuites seraient les directeurs de la maison ; elle fit aussi quelques règlements pour la communauté, les soumit à l'approbation de Mgr Sébastien de Rosmadec et en surveilla l'exécution. Son zèle la porta à réunir tous les dimanches les filles et les femmes pauvres pour les instruire de la religion. La mère Hélène Le Corvaisier, dite de Sainte-Croix, élue supérieure en 1660, reçut pendant ses six ans une trentaine de jeunes filles au noviciat. Dépourvue de ressources, mais confiante en la sainte Famille, à laquelle elle s'était consacrée avec sa communauté, elle entreprit en 1664 le grand corps de logis situé au nord du cloître. Les travaux durèrent dix-huit mois, et coûtèrent 43.604 livres. Mgr Charles de Rosmadec bénit la maison le 17 juin 1666, et les religieuses prirent possession des cellules neuves. En même temps on bâtit les murailles de l'enclos, qui coûtèrent 5.404 livres. La mère Jeanne Le Corvaisier, dite de la Nativité, remplaça sa soeur, le 26 mars 1666, dans ses fonctions de supérieure. Pour coopérer à l'oeuvre des retraites de femmes entreprise par Mlle de Francheville, elle consentit en 1671 à la construction d'une maison sur le terrain de la communauté, et tout près de la clôture. C'est la maison qui a servi plus tard aux classes des Frères, rue de l'Unité, N° 3. En sortant de charge, elle reçut la direction de cette oeuvre et la conserva jusqu'à sa suppression. L'église définitive eut enfin son tour. Les travaux commencèrent le 17 mars 1688 et ne furent terminés qu'en 1690. La dépense monta à 44.054 livres. C'est un édifice en forme de parallélogramme, ayant son maître-autel au fond, la grille des religieuses du côté de l'épître, et une petite chapelle du côté de l'évangile. La façade, du côté du port, est du style de la Renaissance, propagé alors par les Jésuites, et porte l'inscription en lettres majuscules : Sacrae Familiae... 1690. Le monastère des Ursulines conserva jusqu'à la fin sa ferveur et sa prospérité. En 1790, la maison renfermait 38 dames de choeur, 10 soeurs converses, 4 novices, 41 pensionnaires et 19 domestiques ; environ 200 jeunes filles externes y recevaient une excellente instruction. Les religieuses déclarèrent toutes vouloir persévérer dans leur état ; elles ne furent pas moins expulsées par groupes successifs jusqu'au 1er octobre 1792. Leurs biens, mis en vente en plusieurs lots, échurent à divers acquéreurs. Le couvent et l'enclos, avec les cours et maisons accessoires, furent adjugés, le 29 novembre 1797, pour la somme de 52.100 francs. La chapelle, exceptée de la vente, servit de Bourse en 1802, pendant quatre mois, et fut rendue au culte vers la fin de cette année, sous le titre d'oratoire. Les bâtiments et l'enclos furent rachetés en 1838, pour y loger les missionnaires jésuites. C'est là que mourut en 1849 le R. P. Louis Leleu, en odeur de sainteté. La loi du 15 mars 1850 ayant proclamé la liberté de l'enseignement secondaire, un comité catholique se réunit à Vannes pour fonder un collège dans l'ancien couvent des Ursulines, et y appela les Jésuites pour le diriger. Dès le 15 octobre 1850, plus de 200 élèves externes entrèrent au collège, qui prit aussitôt le nom de Saint-François-Xavier. Le pensionnat, ouvert l'année suivante, devint bientôt plus nombreux que l'externat. De vastes et magnifiques constructions s'élevèrent comme par enchantement. Le côté occidental du cloître, commencé par les Ursulines, fut terminé par les Jésuites en 1852 ; le quatrième côté, au sud, fut construit en 1853. Une charmante chapelle de congrégation, de style ogival flamboyant du XVème siècle, dessinée par M. Charier, architecte, et ornée de statues par M. Carado, a été inaugurée en 1857 : elle est cachée à l'angle sud-ouest du cloître. Les RR. PP. se proposaient d'acquérir l'ancienne chapelle des Ursulines, dont la jouissance appartenait à l'évêque et la propriété à l'Etat, afin de construire une façade monumentale au collège du côté de la ville. L'affaire traînant en longueur, ils prolongèrent leurs bâtiments vers le sud, et le P. Tournesac y construisit en 1871 la chapelle qu'on y voit aujourd'hui. Cet édifice, de style ogival du XIIIème siècle, présente à l'intérieur une large nef pour les élèves, et deux séries de colonnes, dont les chapiteaux se distinguent par une grande variété de feuillages et de fleurs. Un déambulatoire tourne autour du sanctuaire, et se prolonge des deux côtés jusqu'au bas de l'église. Les fenêtres sont toutes garnies de vitraux peints, et offrent partout les écussons des donateurs. Depuis l'expulsion des Jésuites, ce collège est dirigé par les prêtres du diocèse.
XXII. Saint-Salomon
Saint-Salomon,
l'un des faubourgs et l'une des quatre paroisses de Vannes, était limité au
nord par la rue Saint-Yves ou d'Auray, à l'est par les douves de la ville, au
sud par la poste actuelle et par une partie
des rues Richemont, Pasteur et Descartes, et à l'ouest par la rue de
Bernus et par une venelle allant de la rue de la Loi à la rue d'Auray. (V. le
plan.) Ce territoire fut donné
au chapitre de l'église cathédrale de Vannes par le duc Alain Fergent, qui
prit part à la première croisade en 1096. Le duc Conan III, son fils, confirma
ce don et l'affranchit de toute redevance envers lui et
ses successeurs. Le chapitre, par reconnaissance, a célébré l'anniversaire
de ces deux princes jusqu'à la Révolution. Comme seigneur féodal de
ce quartier, le chapitre avait haute,
moyenne et basse justice ; il nommait un sénéchal, un alloué,
un procureur fiscal et un greffier, pour l'exercer en
son nom ; il avait une prison auprès de l'église Saint Salomon, et des
fourches patibulaires à la bifurcation des routes de Bernus et d'Arradon. Comme
seigneur temporel encore, il percevait une rente féodale sur les maisons de
son fief, recueillait les biens en déshérence, recevait les droits de
mutation, appelés alors droits de lods et ventes, et
obligeait tous ses vassaux à
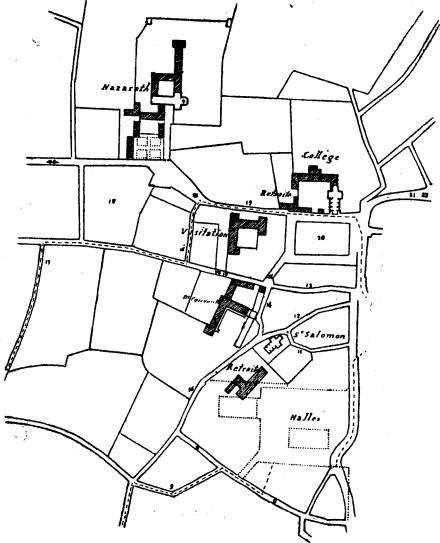
VANNES - SAINT-SALOMON
A peine donné au chapitre, le territoire de Saint-Salomon fut érigé en paroisse : c'était au commencement du XIIème siècle. Son patron, saint Salomon, fils de Rivallon de Poher, avait été reconnu roi de Bretagne en 857, après le meurtre d'Erispoë ; il avait vaillamment guerroyé contre les Normands, avait fondé le monastère de Plélan, et avait fini par tomber sous le fer des assassins le 25 juin 874. L'Eglise, tenant compte de sa longue pénitence et de sa mort cruelle, l'avait mis de bonne heure au rang des saints. Son église à Vannes était située à l'extrémité de la rue actuelle des Tribunaux, au delà d'une grille et d'un portail qu'on y voit aujourd'hui. Le cimetière s'étendait au midi et à l'ouest de l'église. La forme de l'édifice primitif ne nous est pas connue ; son style était nécessairement roman. La seconde église de Saint-Salomon, bâtie sur le même emplacement, avait la forme d'une croix latine, comme on peut le voir sur le plan ci-joint. Si l'on tient compte de son choeur à pans coupés, on est tenté de l'attribuer au XVème siècle, comme la chapelle de Notre-Dame des Lices. Les deux chapelles des transepts étaient dédiées, l'une à la très sainte Trinité, l'autre à Notre-Dame de la Chandeleur ; celles du bas de l'église à saint Sauveur et à saint Sébastien ; il y avait aussi des autels du Saint-Esprit, de Saint-Blaise, de Saint-Germain, etc.. Le chapitre étant le fondateur ou le patron de la paroisse, présentait le vicaire perpétuel chargé de la desservir. Le presbytère, qui existe encore à l'angle de la rue Le Sage ou du Petit-Couvent, porte la date de 1615. C'est sur le territoire de Saint-Salomon que s'établirent les religieuses de la Visitation en 1638, les dames de la Retraite en 1679, et les religieuses de Notre-Dame de la Charité en 1683, comme on le verra plus loin. Tout porte à croire que le couvent des Cordeliers, construit en dehors de la première enceinte de Vannes, était primitivement dans le fief et dans la paroisse de Saint-Salomon, et qu'il ne passa dans le fief du duc et dans la paroisse de Saint-Pierre qu'après l'achèvement de la seconde enceinte en 1385. Il est très possible que cette affaire n'ait pas été étrangère au règlement d'indemnité ordonné par le duc Jean IV dans son testament de 1385, et qu'elle ait eu sa part dans les réclamations adressées au Saint-Siège en 1397 par l'évêque de Vannes contre le duc. Les registres de baptêmes, de mariages et de sépultures de la paroisse de Saint-Salomon remontent à l'année 1585, et renferment d'intéressants détails sur un grand nombre de familles de Vannes et des environs. Sur la proposition du district de Vannes, une loi du 12 mars 1791, sanctionnée le 20 du même mois, supprima la paroisse de Saint-Salomon, pour l'unir à celle de Saint-Pierre, et ne conserva l'église qu'à titre d'oratoire. En conséquence, le 30 avril suivant, trois commissaires de la commune vinrent prendre les registres, qui depuis sont conservés à la mairie ; ils apposèrent les scellés sur les portes de la chapelle renfermant les fonts baptismaux et déclarèrent au vicaire que cette « paroisse était supprimée et qu'il n'avait plus de fonctions pastorales à y remplir » ; enfin ils dressèrent l'inventaire des ornements et des vases sacrés et n'y laissèrent que ce qui était nécessaire à un prêtre constitutionnel pour y dire la messe le dimanche, en faveur des fidèles du quartier. Le buste en bois de saint Salomon, contenant quelques débris de ses ossements, fut plus tard transféré à la cathédrale et remplacé dans la suite par une petite châsse en forme de chapelle gothique. Le vicaire, M. Christophe de la Villeloays, ayant refusé le serment et voyant sa paroisse supprimée, se retira à Pontivy, où il fut accusé de troubler la paix par ses prédications. Dès le mois de juin il fut obligé de s'éloigner, pour se rendre à Lorient et être détenu à la citadelle de Port-Louis. En 1792 il s'embarqua pour l'Espagne, mourut à Bilbao le 2 février 1794, et fut inhumé dans l'église paroissiale de Saint-Nicolas. Le presbytère, avec son jardin, fut vendu, le 16 juillet 1794, pour 4.150 livres, au sieur Le Mercier. Peu après, l'église de Saint-Salomon fut démolie, comme inutile et gênant l'accès des tribunaux. Il n'en reste aujourd'hui aucun vestige ; l'allée qui conduit au tribunal de commerce longe l'ancien choeur au sud, et passe sur le transept et sur le côté de la nef. Le cimetière, qui s'étendait principalement au midi de l'église, est passé en grande partie dans la propriété voisine. Une maison a été récemment bâtie au nord de l'ancienne nef.
XXIII. Retraite des femmes
La
maison de retraite pour les femmes avoisinait le cimetière de Saint-Salomon au
sud-ouest. Elle doit sa fondation à Mlle Catherine
de Francheville, dont la charité était inépuisable.
Témoin du bien que procurait aux âmes la maison de retraite fondée
pour les hommes en 1664, elle eut la pensée, comme Mlle de Monteville, de
faire une fondation pareille pour les
femmes. Elle reçut d'abord chez elle, rue de
la Vielle-Psallette, puis dans une maison hors des murs, les personnes
qui se présentèrent (1669). Ces réunions ayant été
blâmées par un vicaire général, on construisit, en 1671, une maison spéciale
pour les retraites dans l'enclos des Ursulines, avec l'agrément de Mgr de
Rosmadec. Mais Mgr de Vautorte, le nouvel évêque de Vannes, ne
parut pas approuver l'emplacement de l'oeuvre,
et la disgrâce de M. de Kerlivio sur la fin de 1672 fit cesser les
retraites. Vingt mois plus tard,
Mlle de Francheville prit à bail le séminaire destiné aux clercs, et avec
la permission de l'évêque, elle y fit commencer la première retraite le 4
décembre 1674. A cet effet, elle pria le P. Fulgence, carme du
Bondon, de prêcher et de confesser, et appela de Rennes Mme du Houx, pour diriger les
femmes. Bientôt, elle quitta sa maison particulière et vint habiter avec Mme
du Houx, pour se former à la direction de l'oeuvre. Cependant
le séminaire n'était qu'une demeure provisoire, et
il fallait songer à construire une maison définitive. Mlle de
Francheville acheta, le 15 septembre 1674, le jardin de Marie Berrolles, pour 400
livres, et le 19 février 1675, le grand jardin de Radenac,
pour 2.100 livres, les deux immeubles contigus et situés à l'ouest de Saint-Salomon, dans le fief du chapitre.
Les travaux de
construction commencèrent aussitôt. Le plan comportait une vaste maison à
plusieurs étages, capable de recevoir au moins 400 personnes. Malgré la chute
de la charpente, causée par un violent orage, l'entreprise fut couronnée de
succès, et la première retraite y fut inaugurée
le 5 mai 1679. L'année suivante, à la retraite de la Pentecôte, il y eut
412 personnes ; souvent même on en compta davantage aux fêtes de Pâques.
XXIV. Le Petit-Couvent
Au nord de l'ancienne Retraite se
trouve le Petit-Couvent. Ce
nom lui vient d'une modeste maison, située à l'angle de la
rue de la Loi et de la rue Le Sage, qui servit de berceau à
l'établissement, et il s'est maintenu depuis dans le peuple, malgré
l'augmentation des édifices et le changement du personnel. Le
V. P. Jean Eudes avait fondé, en 1641, l'ordre de Notre-Dame de Charité, pour recueillir les femmes tombées,
et cette institution avait pris de rapides développements dans diverses
villes de France. A Vannes, où le séjour du Parlement
amenait beaucoup d'étrangers, on sentit le besoin d'avoir une semblable
maison. Sur les instances de M. de Kerlivio et du P. Huby, et sur les
autorisations écrites de l'évêque, du présidial, et de la ville, données dès
1680, on obtint trois religieuses de cet ordre en 1683. M.
Daniel de Francheville, avocat général, les logea dans la
maison mentionnée ci-dessus, qui lui appartenait, et qui reçut
dès lors le nom de Petit-Couvent. Le président du parlement,
M. de Pontchartrain, s'exprime ainsi, dans son rapport au roi, du 1er décembre 1684 :
«... Cet établissement est
très utile au public : le bien que font dans la province les
maisons semblables qui y sont establies en est la preuve. Les
douze pénitentes qui y sont desja, et qui sont éloignées du crime, non
seulement par leur retraite, mais encore par leur
véritable conversion ; l'éloignement d'un grand nombre de filles de
mauvaise vie, qui ont pris la fuite dès qu'elles ont vu cette maison commencer,
dans la crainte d'y estre enfermées, ce qui
a beaucoup purgé cette ville de ces sortes de personnes ; tous ces biens
donnent lieu d'en espérer d'autres... ». Les
lettres patentes du roi furent signées à Versailles au mois de mai 1688, et vérifiées
ensuite au parlement et à la chambre des Comptes. Le
Chapitre, qui avait d'abord fait quelques difficultés pour
l'établissement de cette maison dans son fief, finit par l'agréer,
par acte du 4 février 1685 : il accepta le capital de 1500 livres comme
indemnité des droits de mutation, permit de supprimer une venelle transversale,
et autorisa l'acquisition de nouveaux immeubles jusqu'à concurrence de deux
journaux de terre. Grâce à cette concession, la communauté acheta divers
terrains et maisons pour recevoir les soeurs renvoyées d'Hennebont, et donner asile à de nouvelles repenties. Une
petite
chapelle provisoire fut établie dans le bas d'une maison voisine, de
celle donnée par M. de Francheville. Le
23 mars 1703, fut posée la première pierre du monastère, qui devait former
un, carré d'édifices avec un cloître ; on fit seulement le côté
nord, où se trouve la chapelle actuelle, et le côté ouest, où est maintenant
l'hôpital militaire. Les religieuses en
prirent possession à la fin de 1706. La communauté de Notre-Dame de Charité de Vannes,
déjà nombreuse, prit un nouvel essor à partir de ce moment,
et en 1715 elle fournit les sujets nécessaires pour fonder une nouvelle
maison dans la ville de La Rochelle. En
1724, les religieuses demandèrent l'alignement de la rue
de la Vieille-Boucherie, à partir de la vieille chapelle, afin
d'y construire un corps de logis pour les pénitentes, et, dès l'année
suivante, on y plaça la charpente et la couverture. Cet édifice existe encore
le long de la rue de la Loi. Puis, pour clore la cour située entre cette maison
et la chapelle, elles firent commencer, pour
les mêmes pénitentes, en 1739, la
maison qui sert de trait d'union entre leur communauté et le refuge : le
tout fut terminé en 1740. L'enclos primitif avait également
reçu des augmentations : le
couvent avait acquis, en 1695, au prix de 4.000 livres, de M. Le Gouvello, les terrains qui
forment aujourd'hui le grand
jardin de l'hôpital ; en 1759, de la famille Jan de Bellefontaine, pour 5.000 livres, les jardins situés au midi
du
précédent. L'établissement était complet, mais la tempête
approchait. En 1790, la communauté comprenait
: 37 religieuses de choeur, 12 converses et 2 tourières.
Elles déclarèrent toutes vouloir persévérer dans
leur vocation, ce qui ne les empêcha pas d'être
expulsées le 1er octobre 1792. Que devinrent alors les
malheureuses filles recueillies par elles ? Le Petit-Couvent, transformé en maison d'arrêt, reçut des
parents
d'émigrés, des administrateurs suspects, des prêtres constitutionnels et des
prêtres fidèles, depuis le mois d'octobre
1793 jusqu'à la fin de 1794 : c'était alors la Terreur. Au mois de
janvier 1795, il devint hôpital militaire, destination qu'il a toujours
conservée depuis ; néanmoins il servit encore de prison à une trentaine de prêtres
catholiques, depuis le mois de mars 1796
jusqu'à la fin de l'année. En
1801, l'immeuble fut remis à la commission administrative
des hospices, par les soins du général Bernadotte, et les malades civils y
furent reçus comme les militaires. Le 3 août 1803, les Augustines de la Miséricorde de Jésus,
qui avaient desservi l'hôtel-Dieu
de Saint-Nicolas avant la Révolution,
furent appelées au Petit-Couvent, et installées par
l'évêque, en présence de toutes les autorités de la ville.
XXV. Visitation - Caserne
Du Petit-Couvent à la Visitation, il n'y a que la largeur d'une rue. L'ordre de la Visitation a été fondé à Annecy, en 1610, par saint François de Sales, évêque de Genève, et par sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal. Dans l'origine, les religieuses visitaient les malades à domicile, et c'est de là que leur vint le nom de Soeurs de la Visitation ou de Visitandines. Depuis l'établissement de la clôture, il a fallu renoncer à la visite des malades, pour se consacrer à l'instruction de jeunes pensionnaires. Les religieuses de la Visitation établies au Croisic en 1631, trouvèrent bientôt la ville trop petite et l'air de la mer trop vif. Elles demandèrent donc en 1635 à l'évêque de Vannes, à la communauté de ville, et au roi, les autorisations nécessaires pour transférer leur établissement à Vannes. Les ayant reçues, huit soeurs arrivèrent ici au mois de septembre 1638. Le 16 juin suivant elles acquirent par adjudication, au prix de 5.600 livres, la maison de la Croix-Orain et trois autres petites maisons donnant sur la rue d'Auray ou de Saint-Yves, et ayant des jardins derrière vers la rue de la Vieille-Boucherie. Tel fut le noyau de leur établissement, qu'elles agrandirent par des acquisitions successives ; elles payèrent au chapitre une indemnité de fief, c'est-à-dire un capital dont la rente devait représenter à l'avenir le droit de mutation ; les droits de moulin, de four et de juridiction féodale restèrent, comme toujours, réservés. C'est en 1652 qu'elles commencèrent la construction de leur couvent, par le corps de logis qui est parallèle à la rue Saint-Yves, avec une portion de cloître. Le grand bâtiment du côté de l'ouest, avec sa portion de cloître, ne fut commencé qu'en 1671 et terminé en 1673. M. l'abbé de Coetdeletz , archidiacre et chanoine , en fit la bénédiction ; il inaugura également l'oratoire de l'Enfant Jésus, construit dans l'enclos et destiné à recevoir les sépultures des soeurs. Le bâtiment situé à l'est, et destiné à rejoindre un jour celui du sud, n'a pas été plus achevé que celui-ci. Le cloître, avec ses piliers carrés et ses arcades en plein cintre, offre un aspect grandiose ; malheureusement le côté de l'est n'a pas été fait. Le préau du cloître fut affecté à la sépulture des pensionnaires de la maison. La chapelle de communauté était alors une simple salle du bâtiment du nord : on avait le projet de bâtir une véritable église sur un des côtés du cloître, mais ce projet ne fut jamais réalisé. Quant à l'enclos, son développement était arrêté, vers l'ouest, par une venelle qui allait de la rue de la Vieille-Boucherie à la rue d'Auray ou de Saint-Yves, et qui séparait le fief du chapitre de celui de l'évêque, et la paroisse de Saint-Salomon de celle de Saint-Patern. Cette venelle était devenue un dépôt d'immondices, et faisait fuir le public. Les Visitandines en demandèrent la concession, et grâce à de hautes influences, elles obtinrent du roi des lettres patentes du mois de juillet 1689 les autorisant à fermer cette ruelle, à condition de faire plus loin une autre voie de communication. Grâce à cette concession, les religieuses purent s'étendre vers l'ouest, sans solution de continuité. Toutefois le cimetière de Saint-Michel, situé sur le Champ-de-Foire actuel, les arrêta à son tour : il avait une pointe triangulaire vers l'est, sous la nouvelle caserne de la gendarmerie, et il les empêchait de donner à leur enclos une forme à peu près carrée. Elles demandèrent donc à la paroisse de Saint-Pierre et à la confrérie des Trépassés cette portion triangulaire du cimetière, et offrirent en retour un terrain leur appartenant, situé au sud dudit cimetière, le long de la rue de la Vieille-Boucherie, et contenant 117 pieds de plus que le terrain demandé. Leur demande fut agréée, et l'acte d'échange fut passé le 26 mars 1712. Plus tard, les représentants de la paroisse voulant vendre le cimetière de Saint-Michel, pour l'établir ailleurs, l'offrirent aux religieuses de la Visitation, comme étant à leur convenance. Celles-ci, ayant déjà leur clôture complète, et n'ayant pas alors l'argent nécessaire, proposèrent l'échange de ce terrain pour une prairie qui leur appartenait sur la route du Bondon. L'affaire fut acceptée par acte du 25 janvier 1742, mais ne fut consommée qu'en 1748. L'oeuvre était achevée, la Révolution allait la détruire. Le 18 novembre 1790, la communauté comprenait 27 religieuses de choeur, 6 soeurs converses et 2 tourières. Interrogées séparément, elles répondirent toutes qu'elles voulaient continuer leur genre de vie. Elles furent néanmoins renvoyées de leur asile le 1er octobre 1792. Pendant la Terreur, trente d'entre elles furent détenues à l'hôpital de Saint-Nicolas ou internées en ville. Tous leurs biens avaient été confisqués. L'ancien cimetière de Saint-Michel, transformé en verger, fut adjugé en 1796 au sieur Villeneuve pour 5.720 livres, et le grand jardin de l'enclos à M. Josse pour 6.380 livres. Quant au monastère lui-même, l'Etat le garda pour en faire une caserne d'infanterie ; et c'est encore la destination qu'il conserve aujourd'hui. Après la Révolution, les religieuses de la Visitation de Vannes ne purent se reconstituer en communauté. En 1807, il y en avait dix ou douze réfugiées dans l'ancien couvent des Capucins, chez les Ursulines. Plus tard elles se retirèrent au n° 6 de la rue Noé, où elles continuèrent à instruire les jeunes filles qu'on leur envoyait et elles s'y s'éteignirent successivement. D'un autre côté, l'ancien cimetière de Saint-Michel fut racheté pour faire un champ de foire. L'ancien jardin du couvent fut également racheté : une partie fut annexée à la caserne d'infanterie pour agrandir la cour, et le reste servit en 1857 à recevoir la nouvelle caserne de gendarmerie et les bâtiments accessoires.
XXVI. Carmélites de Nazareth
Les
Carmélites, établies au Bondon en 1463 par la B.
Françoise d'Amboise, et transférées aux Coets, près de Nantes, en 1480, avaient toujours nourri l'espoir de renvoyer
une
colonie à Vannes. Voyant leur communauté riche en sujets, elles résolurent en 1513 de commencer les démarches
préliminaires.
Elles obtinrent d'abord l'autorisation de la reine Anne de Bretagne et du roi
Louis XII, puis celle de François Ier et
de la reine Claude (1513-1515). Elles acquirent ensuite, par acte d'afféagement
du 24 octobre 1516, une
propriété située entre la rue Saint-Yves et le ruisseau de Rohan,
et appartenant au prieuré de Saint-Martin de Josselin dont elle
portait le nom : c'était un petit fief, enclavé dans les Régaires, ayant
quelques droits dans le port de Vannes, et juridiction sur la rue de
Saint-Martin ou du Moulin et sur diverses terres vers la Madeleine. Elles s'engagèrent
à payer au prieur, chaque année, à perpétuité, une
rente foncière de 40 livres monnaie, et une rente féodale de
5 sols, et à dédier dans leur future église un autel à saint
Martin, pour remplacer sa chapelle tombée en ruines. Le
projet de fondation ayant été approuvé par l'évêque de
Vannes et par le Pape Léon X, les travaux commencèrent enfin en 1518, sous la direction d'un carme du Bondon,
le
F. Geoffroy Le Borgne, évêque titulaire de Tibériade. Le couvent se
composa d'un carré d'édifices autour du cloître,
l'église formant le côté sud. Les travaux marchèrent lentement, et
ne furent terminés qu'en 1529. Les 17 religieuses désignées pour Vannes y
arrivèrent le mercredi-saint 13 avril 1529
(N. S. 1530), et furent mises aussitôt en possession
de leur monastère, qu'elles appelèrent Nazareth. Leur
enclos formait un carré autour du couvent. Leur
occupation était de chanter l'office divin, de vaquer aux exercices de la vie
contemplative, et d'exécuter divers travaux manuels, en
observant une clôture rigoureuse. Elles reçurent, avec le temps, de
nombreuses postulantes, et leurs dots permirent à la communauté d'acquérir
d'importants immeubles et de faire d'abondantes aumônes. Elles étaient gouvernées
à l'intérieur du couvent par une prieure élue tous les trois ans ; elles
avaient pour supérieur ou Vicaire un Carme choisi par elles à vie, et confirmé
par le Général de l'ordre ; et pour confesseurs deux ou trois Carmes élus par
elles et confirmés par le Vicaire. Ces religieux formaient entre eux une petite
communauté qui était logée dans des appartements en dehors du monastère des
soeurs, et situés sur la place actuelle de Nazareth (Voir le plan). Le 1er
octobre 1589, une « poule d'Inde », morte, parait-il, du charbon, donna
naissance à une sorte de maladie contagieuse. Sept religieuses en moururent.
Les survivantes furent obligées d'évacuer la maison, et trouvèrent un refuge
à Limoges. Quand elles revinrent, le 11 janvier 1590, elles ne trouvèrent plus
de provisions au couvent : tout avait été enlevé par les « désaireurs »,
qui l'avaient occupé pendant six semaines. La communauté répara rapidement
ses pertes matérielles et personnelles. Les vocations affluèrent, et des
essaims de religieuses allèrent fonder en 1620 un couvent de Carmélites à
Rennes, et en 1627 un autre à Ploërmel. L'âme de la communauté était alors
le P. Philippe Thibaud, le réformateur des Carmes. C'est lui qui fit bâtir, en
1629 et 1630, le grand bâtiment situé au nord du cloître, afin de suppléer
à l'insuffisance de la maison. Il mourut à Nazareth, en odeur de sainteté, le
24 janvier 1638, et fut enterré dans l'église du couvent devant le maître-autel.
Peu après, en 1645, surgit une contestation sérieuse entre les Carmélites et
l'évêque de Vannes, au sujet du fief de Saint-Martin et de droits à payer aux
Régaires. Une sentence des Requêtes du Palais, du 7 juillet 1646, donna gain
de cause à l'évêque, et refusa de reconnaître le fief de Saint-Martin en
dehors de l'enclos des religieuses. Par une transaction du 29 mars 1647, Mgr
Charles de Rosmadec, pour le bien de la paix, consentit à reconnaître la
mouvance de Saint-Martin sur deux près voisins de l'enclos, du côté de
l'ouest, mais il maintint sa juridiction féodale sur le reste, conformément à
la sentence des Requêtes. Son successeur, Mgr de Vautorte, fut plus
accommodant, et par traité du 10 juillet 1676, il consentit à reconnaître le
fief de Saint-Martin sur les terres situées à l'ouest de l'enclos, à la
condition de conserver dans son propre fief les terres placées à l'est, et
notamment la rue du Moulin ou de Saint-Martin. Les religieuses eurent aussi de
nombreuses difficultés avec certains Vicaires, qui voulurent imposer leurs
volontés personnelles ou gêner le libre choix des confesseurs, et l'autorité
supérieure dut souvent intervenir. Au milieu de ces débats, l'enclos de la
communauté s'était graduellement élargi. Il ne comprenait à l'origine (1530)
que l'espace carré entourant le monastère ; en 1645, le R. P. Jean Tuaut,
vicaire, y avait ajouté le jardin et un bout de prairie au nord ; enfin en
1679, le R. P. Augustin fit enclore tout le terrain situé à l'ouest jusqu'à
la route et au ruisseau de Rohan et le mit à la disposition des religieuses. En
novembre 1790, il y avait ici 26 religieuses de choeur et 9 soeurs converses :
toutes déclarèrent vouloir persévérer dans leur état ; il en fut de même
des quatre Pères Carmes. Le 1er octobre 1792, elles furent brutalement renvoyées
de leur monastère, et pendant la Terreur cinq d'entre elles furent détenues à
l'hôpital Saint-Nicolas. Leurs biens, qui étaient considérables, furent
vendus les uns après les autres, à Vannes et ailleurs. L'Etat ne conserva guère
pour lui que le couvent et l'ancien enclos, et il y établit une manutention
militaire : on y voit encore une partie du cloître et des bâtiments religieux
; la moitié de cet enclos, vers l'est, fut cédée, vers 1824, au département
: on fit table rase des anciens édifices, pour y bâtir une prison. Le reste de
l'enclos, formant les trois quarts de l'ancienne propriété, passa par différentes
mains : M. Daudé, lazariste, y construisit, vers 1825, un grand pensionnat pour
les écoliers ; les Trappistines de Laval l'acquirent en 1849, et le revendirent
aux religieuses du Dorat en 1853, pour y établir une maison de correction et un
refuge ; les Petites Soeurs des pauvres ont racheté le tout en 1874, et ont
construit leur établissement en 1883 et 1891, après avoir démoli l'ancienne
maison Daudé en 1884. La chapelle n'a été terminée qu'en 1895. Quant à la
maison et au jardin des Pères Carmes, tout a été rasé : c'est aujourd'hui la
place de Nazareth. Un nouveau couvent de Carmélites, de la réforme de sainte
Thérèse, s'est établi à Vannes, à quelques pas de Nazareth, dans la rue de
la Loi. Les premières religieuses arrivées à Vannes en janvier 1866 se logèrent
provisoirement dans une maison de la rue du Nord, pendant qu'on bâtissait leur
couvent, et au mois de juin 1867 elles entrèrent dans leur monastère. Le cloître
fut construit en 1877, et l'élégante chapelle qui le domine fut consacrée le
5 novembre 1879.
XXVII. Collège Saint-Yves
Le
concile de Trente, en 1563, avait ordonné d'établir un Collège dans chaque diocèse, dans le but surtout de préparer
des élèves pour le sanctuaire. L'Etat ayant accepté ce décret,
on songea partout à le mettre
à exécution. En 1574, la communauté
de la ville de Vannes donna l'exemple en
Bretagne : elle reçut de Jean Brisson, sieur du Péh, et de René d'Arradon,
seigneur de Kerdréan, deux pièces de terre et une maison, situées au nord
de la place du marché, dans le fief de l'évêque et dans la paroisse de
Saint-Patern. Elle y commença de suite les bâtiments nécessaires, et une
chapelle en l'honneur de saint Yves, le
long de la rue. En 1579, l'évêque Louis de la Haye érigea canoniquement
ce collège, pour cinq classes, et lui donna, à cause de son caractère
ecclésiastique, les dîmes de Saint-Avé et de Quistinic. De son côté, le
Chapitre lui attribua une rente de 200
livres, qu'il donnait jusqu'alors à un précepteur ou maître des écoles
de Vannes. La ville fournit le surplus des traitements et des dépenses. Les
classes furent ouvertes en 1580, et l'administration du collège
fut donnée à un chanoine et à un laïc, élus chacun pour
deux ans par la communauté. L'enseignement eut pour directeur Jean de
Vendosme, mentionné dès 1577, Félix
Miggueus, cité en 1605 et mort en 1616, Jean Le Grand, nommé en 1616,
vivant encore en 1626, et Jean Durand, retraité en 1630. A
cette date, la communauté de la ville, avec le consentement
de l'évêque et du roi, confia le collège aux PP. Jésuites. Ceux-ci achetèrent plusieurs
immeubles et firent quelques
XXVIII. Retraite des hommes
A
l'ouest du collège, à l'entrée de la rue Saint-Yves ou d'Auray, était une
grande maison appelée la Retraite des hommes. Elle n'avait pas été bâtie
d'abord pour cette oeuvre, mais pour servir de séminaire. Le P. Jean Rigoleuc
songeait depuis longtemps à réunir les jeunes clercs, pour les préparer à la
réception des ordres et à la pratique des vertus de leur état, pendant qu'ils
suivaient les cours de philosophie et de théologie au collège. Il en parla en
1656 à M. Eudo de Kerlivio, qui lui fit offre aussitôt de ses biens, et même
de sa personne, s'il était nécessaire, pour un projet si utile. Ce généreux
prêtre vint d'Hennebont à Vannes en conférer avec le P. Recteur, acheta au
nom des Jésuites un jardin qui joignait le collège, et donna une forte somme
d'argent au P. Rigoleuc pour commencer la bâtisse. De son côté, le R. P.
Cellot, provincial, affecta, le 17 août 1656, à l'établissement projeté, la
terre de la Ville-Déné, située en la Chapelle et acquise depuis quatre ans
par la Compagnie. Sur ces entrefaites, M. de Kerlivio fut nommé vicaire général
et trouva dans Mgr Charles de Rosmadec un puissant protecteur de l'oeuvre. D'un
autre côté, il fallait l'autorisation du roi pour exister légalement et pour
amortir une dotation. Louis XIV, par lettres patentes du mois d'octobre 1660,
approuva la construction de cette maison, « où les pauvres clercs
pourraient recevoir les impressions de la piété et les instructions nécessaires
pour parvenir aux ordres », et amortit à cet effet « la terre noble de
la Ville-Déné, de cinq à six cents livres de rente, et d'autres fonds à acquérir
jusqu'à 3.000 livres de rente... ». En 1663, quand tout fut prêt, Mgr de
Rosmadec en fit part à son synode, et sollicita le concours pécuniaire de ses
recteurs ; mais il éprouva une résistance inattendue. M. de Kerlivio, ému de
cet échec, recommanda l'affaire à Dieu, et se sentit inspiré de faire de ce séminaire,
déjà distribué en cellules, une maison de Retraites pour les hommes. Le P.
Huby, son confesseur, eut la même pensée. M. de Kerlivio en fit la proposition
à l'évêque, qui la reçut avec joie, et qui publia le 11 janvier 1664 une
lettre pastorale pour la recommander à tout le diocèse. Cette oeuvre, la
première de son espèce en France, produisit un bien incalculable. M. de
Kerlivio y fonda l'entretien de quatre religieux, pour en diriger les exercices
; et jusqu'à sa mort il employa toutes les industries de son zèle pour y
attirer le plus d'hommes possible, ecclésiastiques, nobles, bourgeois et
paysans. En 1669, M. Guillaume Le Gallois, chanoine et grand vicaire, donna une
rente de vingt livres pour la pension de trois prêtres de Vannes qui voudraient
y faire leur retraite. Cette maison était pourvue d'une chapelle particulière.
M. de Kerlivio avait fixé sa demeure à la Retraite, et quand il mourut le 21
mars 1685, il laissa 1.500 livres pour achever un corps de logis commencé entre
la maison de la retraite et le pignon de la chapelle. Il fut inhumé, suivant sa
demande, dans le caveau de la chapelle du collège, à côté du P. Rigoleuc.
Son coopérateur dans l'oeuvre des retraites d'hommes, le P. Vincent Huby, natif
comme lui d'Hennebont, lui survécut huit ans. Il mourut les armes à la main,
car il commençait une retraite quand il se vit attaqué par une fluxion de
poitrine ; cinq jours après, savoir le 22 mars 1693, il expira doucement, à
l'âge de 85 ans ; il fut inhumé dans le caveau de la chapelle du collège, et
son coeur fut donné aux demoiselles de la Retraite. Sa mémoire est restée en
vénération dans le diocèse de Vannes, comme celle de M. de Kerlivio. Les PP.
Jésuites continuèrent vaillamment l'oeuvre des retraites d'hommes ; ils
fournirent aussi, comme on l'a vu, deux prêtres pour les retraites de femmes.
En dehors de Vannes, ils furent appelés, par des fondations, à donner des
missions périodiques à Pontivy, à Rohan, à Hennebont, à Belle-Ile et
ailleurs. La suppression de la Compagnie en 1762 laissa sans directeurs les deux
maisons de retraites de Vannes. L'évêque, Mgr de Bertin, dut y pourvoir, et le
4 octobre 1765, il adressa une lettre pastorale à tout le diocèse, pour
annoncer le rétablissement des retraites. «... Il y aura comme par le
passé, dit-il, quinze retraites par an, dans chacune des maisons destinées à
ces pieux exercices, pour les hommes et pour les femmes. — Les retraites
continueront à être toutes données pour les femmes bretonnes et françaises
en même temps. — Les retraites pour les hommes seront données séparément
pour les français et pour les bretons. Les cinq retraites bretonnes seront
celles qu'on appelle du mois de janvier, de la première semaine de Carême, de
la Quasimodo, de l'Ascension et de la Sainte-Catherine. Les dix autres seront
pour les français... Nous verrons toujours avec joie les ecclésiastiques venir
dans cette maison vaquer aux exercices de la retraite, et on leur donnera, comme
ci-devant, des exercices particuliers sur les devoirs de leur saint état... ».
En 1791, le directoire du département prescrivit à la municipalité de faire
dresser un inventaire des meubles et des biens de la Retraite des hommes, et de
nommer un économe provisoire. Le 16 juillet 1794, la maison fut vendue 5.025
livres au sieur Abel. Après avoir passé par différentes mains et avoir même
servi d'hôtel, le bâtiment a été démoli pour faire place à une école
primaire.
XXIX. Séminaire - Retraite
Dans
les premiers siècles de l'Eglise, le séminaire était la
maison épiscopale : les prêtres, les diacres et les clercs inférieurs
vivaient en commun avec l'évêque, et partageaient leur
temps entre les offices de l'église cathédrale et l'étude de la
science sacrée. L'évêque
était le supérieur naturel de cette école ecclésiastique ; et en cas
d'empêchement, il était remplacé par l'archidiacre
; un prêtre était spécialement chargé de l'enseignement
et portait le titre de scholastique ou maître d'école. Plus
tard, quand la vie commune eut cessé, l'organisation de l'enseignement resta la même ;
mais les élèves, devenus externes, se partagèrent
entre les universités, les écoles cathédrales et les écoles privées. Pour
obvier à cette dispersion, et pour favoriser la pratique des vertus, le concile de
Trente prescrivit, en 1563, l'établissement,
dans chaque diocèse, d'un séminaire de clercs, avec
vie commune. On
a, vu ci-dessus comment l'entreprise fut tentée à Vannes en 1656, et comment
elle échoua en 1663 devant l'opposition du clergé diocésain. M. de Kerlivio,
sans se
XXX. Eglise de Notre-Dame du Mené
Le
Mené est un ancien faubourg et une ancienne paroisse de
Vannes. Son territoire comprenait les rues de la Boucherie, du Moulin, du Puits, de Coessial, de la Coutume, du
Mené
et de Notre-Dame, avec ses impasses, et le manoir épiscopal. Ce nom du Mené vient du
breton Menez, montagne, colline, et convient parfaitement à la rue du Mené,
qui va en montant, et à l'église du Mené, qui se trouve sur une hauteur. L'église
étant dédiée à la sainte Vierge, sous le titre de l'Assomption, la
paroisse s'appela tantôt Le Mené, tantôt Notre-Dame du Mené,
en latin Parochia
Beatœ Mariœ de Monte. La
première mention de cette paroisse se trouve dans un acte de l'évêque Rouaud, vers
1144. Il est probable qu'elle était alors d'érection
récente, et qu'elle était un vicariat perpétuel, à la présentation du
chapitre, comme les trois autres paroisses de la ville épiscopale. Une bulle
du pape Pie II, du 28 novembre 1458, autorisa l'official de Vannes à unir
la paroisse du Mené à l'office du sous-chantre de la cathédrale, ce qui fut immédiatement exécuté. Le chapitre,
qui
nommait le sous-chantre, présentait par cela même le titulaire de
cette paroisse. L'ancienne
église de Notre-Dame du Mené était située à l'endroit où se trouve
aujourd'hui le portail de la Retraite, et
avait son cimetière tout à côté. Elle était orientée comme Saint-Pierre
et Saint-Patern, et avait la forme d'une croix latine.
Au fond du choeur se voyait en 1665 un retable avec deux
niches et les armes des Gibon, et quatre colonnes de marbre. La
chapelle du nord, sous le vocable de Saint-Crépin,
avait été bâtie en 1496 par Jean Gibon, seigneur du Grisso et de
Coessial ; elle fut toujours prohibitive à la famille de son fondateur, et en
porta les armes dans ses
XXXI. Rues des Faubourgs
Pour lire ce dernier paragraphe, il faut avoir le plan sous les yeux, et suivre les numéros.
I.
Dans le quartier de Saint-Patern.
1.
Rue de la Garenne, conduisant de Saint-Nicolas à la
2. Rue de Saint-Nicolas, ainsi nommée parce qu'elle longeait la chapelle et l'hôpital de ce nom.
3. Rue de Pontivy, conduisant vers la ville de ce nom, dite aussi rue de la Fontaine, parce que les eaux de Meucon venaient jadis par là, et parce qu'elle menait à la fontaine de Bézard.
4. Route de Saint-Symphorien ou de Pontivy et embranchement de l'ancienne route de Vannes à Saint-Avé.
5. Ruelle du Recteur, ainsi nommée parce qu'elle longe le presbytère : elle s'appelait jadis Couachon.
6. Rue de Sainte-Catherine, voisine de la place de ce nom et conduisant au cimetière de la ville.
7. Place de Sainte-Catherine, située entre l'ancienne chapelle de ce nom et l'ancien cimetière de Saint-Patern.
8. Rue de l'Hôpital, conduisant à l'hôpital général, dite auparavant, dans sa partie inférieure, la Grand'Rue, à cause de sa largeur relative.
9. Rue de Bois-Moreau, voisine du manoir de ce nom et du cimetière appelé le Pré de Bois-Moreau.
10. Rue de l'Hôpital (seconde partie) depuis la construction de l'hôpital général, dite auparavant de Bois-Moreau.
11. Place Cabello, ou de la Croix-Cabello, souvenir du passage des Espagnols, dite en breton Croez-Benal, ou croix du genêt.
12. Rue de l'Etang, dite anciennement rue Gislard, du nom d'un évêque intrus de Nantes, né peut-être en ce lieu.
13. Rue de la Tannerie, ainsi nommée de l'industrie qui s'y exerce depuis l'an 1451 environ.
14. Place de Groutel, jadis célèbre pour ses fabriques de draps ; cette industrie est aujourd'hui totalement abandonnée.
15. Rue de Rennes, ainsi nommée parce qu'elle conduit vers cette ville, en passant devant les casernes d'artillerie.
16. Rue de Nantes, nom topographique comme le précédent, dite autrefois rue de Groutel, comme la place.
17. Rue de la Confiance, chemin conduisant au haut de la Garenne, et privé de son embranchement vers le sud.
18. Rue de la Petite-Garenne, depuis le pont Pallec jusqu'à la rue du Four, réduite aujourd'hui à l'état d'impasse.
19.
Rue du Four du
Duc, et pendant quelque temps rue de la Concorde ; elle
tirait son nom du four ducal.
20.
Rue du Roulage, ouverte en 1760, pour remplacer celle de la
Petite-Garenne,
et tracée dans l'enclos des Jacobins.
21.
Place de la Préfecture, ainsi dénommée depuis 1864 et complétée par une
rue neuve dite d'Alain le Grand.
22.
Rampe de la
Garenne, autrefois suite de la rue de l'Abbé, et en 1896, rue
de Jean de Bavalan.
23.
Rue des Douves de la
Garenne, jadis rue de l'Abbé (de Saint-Gildas de
Rhuys), seigneur temporel du quartier.
24.
Rue du Jointo, parallèle à la Rampe de la Garenne, et aboutissant jadis à
une croix sur la hauteur.
25.
Rue de Séné, conduisant au bourg de ce nom, appelée aussi
Calmont-Haut,
du latin calidus mons(?).
26.
Rue du Commerce, parallèle à la précédente, dite de
Calmont-Bas à
raison de sa situation au pied de la colline.
II.
Quartiers de Kaer, de Saint-Salomon, etc.
1.
Promenade de la
Rabine, le long du port, commencée en 1720, et prolongée
graduellement jusqu'au Pont-Vert.
2.
Place de l'Evêché, autrefois place des Carmes ou de
Saint-Julien, ancien
lais de mer.
3.
Rue du Port, construite principalement par les négociants qui y avaient
leurs magasins.
4.
Rue du Drézen, tiré d'un mot-breton signifiant passage,
ou du nom de la
famille du Drézen, qui l'a habitée.
5.
Rue Thiers, tracée récemment sur les douves, depuis la rue du Drézen
jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville.
6.
Rue des Douves du
Port, reste de la voie qui bordait les douves de ce côté
de la ville, dite aussi rue Carnot.
7. Rue de l'Unité, dite autrefois de Comohic, du nom de l'un de ses habitants, puis de Bara-Segal (pain de seigle).
8. Rue de Poulhoho, puis Poulho, puis des Bons-Enfants, et enfin rue Richemont, partagée entre Kaer et Saint-Salomon.
9. Rue d'Arradon, jadis de la Fontaine de la Pie et en 1896 de Louis Pasteur, dans sa partie inférieure, limite partielle de Saint-Salomon au sud.
10. Rue de la Salle d'Asile, dite aussi de Trussac et anciennement rue Blanche, et même de Poulho par extension.
11. Rue du Puits, supprimée depuis longtemps, descendant de Saint-Salomon sur les douves près du puits des Kerviler.
12. Rue des Tribunaux, depuis la Révolution, et rue du Four du Chapitre auparavant.
13.
Rue du Pot-d'Etain, tiré d'un hôtel de ce nom ; appelée pendant la Révolution
rue de, la Bonne-Foi.
14.
Rue du Petit-Couvent, puis rue de la Justice, comme conduisant aux
tribunaux, et enfin rue Le Sage.
15. Rue de la Loi, anciennement rue des Bouchers, puis rue de la Vieille-Boucherie.
16. Venelle sans nom connu, limite de Saint-Salomon et des Régaires, bouchée en 1689.
17. Place du Champ de Foire, ancien cimetière entourant la chapelle de Saint-Michel.
18. Rue de Bernus, conduisant au village de ce nom, et limitant de ce côté le fief de Saint-Salomon, dite aujourd'hui Vincent Rouillé.
19.
Rue d'Auray, et anciennement de
Saint-Yves, à cause d'une chapelle et d'une
croix dédiées à ce saint.
20. Place du Marché, en breton Marhalleh, place Napoléon et aujourd'hui place de l'Hôtel-de-Ville.
21.
Rue du Mené, ou
de la Montagne, ainsi nommée à cause de sa disposition en
pente.
22.
Rue Coessiale, ou
de la Vérité, remplacée aujourd'hui par l'avenue Victor
Hugo, conduisant à la gare.
23. Rue de la Boucherie, habitée naguères par plusieurs bouchers, dite anciennement rue du Puits.
24.
Rue du Moulin (de l'Evêque), appelée jadis rue Saint-Martin, parce qu'elle
relevait de ce fief.
25. Rue de l'Abattoir, ainsi nommée depuis 1840, et appelée précédemment du nom commun de Boucherie.
26. Rue de la Coutume, siège des receveurs des droits, dite jadis rue de Bourg-Maria, paroisse du Mené.
27.
Rue Neuve, mentionnée dès 1537 dans le fief de Saint-Guen, n'a jamais
changé de nom depuis.
J.
M. Le Mené
![]()
© Copyright - Tous droits réservés.