|
Bienvenue ! |
LE PLUS ANCIEN MANOIR DE VANNES.CHATEAU-GAILLARD. |
Retour page d'accueil Retour page "Ville de Vannes"
Le château Gaillard de Vannes fut construit au début du XVème siècle sur la terre relevant des possessions des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, laquelle terre passa ensuite entre les mains de Gaillard Tournemine qui lui donna son nom, puis entre celles de Thomas Faverill, celles de Jean de Crésolles, celles de la famille Pantin, et enfin à Jean de Malestroit, évêque de Nantes et chancelier du duc de Bretagne. L'édifice fut construit en 1410 par le dit chancelier. En 1456, le château Gaillard fut vendu au duc de Bretagne Pierre II, qui y installa le Parlement de Bretagne qui resta en fonction jusqu'en 1532. En 1554, il fut vendu par le roi. Au XVIIème siècle, l'endroit fut possédé par messire Daniel de Francheville, conseiller du roi et premier avocat au Parlement de Bretagne, puis, en 1762, par Luc-Julien Le Sénéchal de Kerguizec, lieutenant des maréchaux de France. Château-Gaillard passa ensuite en 1764 aux mains de Louis-Jean-Charles Fournier, chevalier, seigneur de Trélo, Saint-Maur et autres lieux et à madame Marie-Catherine Besson de la Vieuville, son épouse. En 1779 le château-Gaillard passait aux mains de madame Françoise Le Roux, veuve du sieur Sébastien-Marie Le Hénauff de Kerpars pour entrer ensuite le 7 frimaire an IX en la possession de la famille Geanno (ou Jéhanno), puis de la famille Montlaur ou Monlaur et Le Bobinec (qui vend, en 1912, le Château-Gaillard à la Société Polymathique du Morbihan).
![]()

Le nom de Château-Gaillard est célèbre en bien des lieux de la terre de France. On pensera, peut-être, que le Château-Gaillard de Vannes mérite de le devenir, s'il ne l'est déjà, non pas seulement comme musée, par les collections uniques qu'il renferme, mais encore par les souvenirs historiques qu'il évoque.
I. LES ORIGINES.
Sur les origines de Château-Gaillard un rentier de la ville de Vannes, datant de 1455-1458 (Archives de la Loire-Inférieure, B. 2.339), fournit de précieux renseignements.
Les officiers chargés d'établir ce rôle financier relevaient maison par maison les rentes que le duc était en droit de prélever. D'après eux, les tenanciers de tous les immeubles compris à l'intérieur de l'enceinte fortifiée lui en devaient une, sauf preuve contraire. Quand donc un tenancier affirmait n'avoir jamais rien payé au receveur des domaines, ses dires n'étaient acceptés que sous bénéfice d'inventaire, et le receveur, prévenu, requérait le procureur d'avoir à assigner le récalcitrant devant la cour pour fournir ses preuves.
Tel fut le cas de Jean de Malestroit, seigneur de Mesangé, propriétaire de Château-Gaillard en 1455, comme héritier de son oncle, le Chancelier de Bretagne. Déjà les enquêteurs du rentier de 1413 « ne trouvaient qu'il fût dû aucune rente sur ladite maison ». Néanmoins ceux du rentier de 1455 notèrent : « Soit sollicité le procureur par le receveur » pour que « les détenteurs soient poursuiz » (L. c., fol. VII. r°).
Dans l'espèce les détenteurs n'invoquaient pas seulement un usage ancien ; ils reconnaissaient être tenanciers, mais d'un autre seigneur que le duc. Ils « dient », lit-on au rentier, « qu'ilz tiennent la maison des Hospitaliers » (Id., ibid.).
Il n'en faut pas douter, si le grand ordre militaire de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem possédait, au XVème siècle, des droits sur l'emplacement de Château-Gaillard, c'était comme successeur de celui du Temple, après sa suppression par Clément V.
Pour bien s'en convaincre, qu'on se rappelle le caractère des Templiers. Voués de par leurs origines à la défense du Saint-Sépulcre, ils donnèrent jusqu'à la fin des preuves de vaillance. Mais leur richesse, les facilités que leur procuraient les relations constantes établies entre les établissements qu'ils possédaient dans toute la chrétienté, les amena peu à peu à s'occuper d'opérations de banque. Le Temple devint une grande maison de crédit, recevant les objets précieux en dépôt, détentrice de la monnaie métallique, faisant circuler les lettres de change, assez puissante pour que le roi de France ne trouvât pas de plus sûr gardien de son trésor.
Vannes, port important, résidence fréquente des ducs, ne pouvait manquer d'avoir sa commanderie ou, tout au moins, une maison [Note : Vannes ne se trouve pas sur les listes des possessions du Temple et de l'Hôpital des chartes datées de 1182 et 1160. Mais ces chartes sont apocryphes et la commanderie de Vannes put avoir été établie postérieurement à la date de leur fabrication. En outre, les Templiers pouvaient ouvrir à Vannes un établissement non érigé en commanderie. Guillotin de Corson, Les Templiers et les Hospitaliers en Bretagne. Nantes, 1902, in-8°, p. XV-XVIII et XVIII-XXX]. Nul emplacement ne lui convenait mieux que celui de Château-Gaillard, dominant le port, contigu à la porte qui, sans doute, ouvrait l'accès de la ville aux navigateurs, voisinant la cohue, en plein centre commercial. Et pourquoi tant d'orfèvres dans le haut de la rue Noé et la rue qui a pris leur nom, sinon parce que, exerçant la profession qui exige, entre toutes, une protection spéciale de la marchandise, et de grosses avances d'argent, ils se groupèrent naturellement auprès du Temple, qui pouvait leur fournir l'une et les autres ?
La certitude historique donnée par le texte du rentier prend toute sa valeur quand on la confirme par la tradition.
Dubuisson-Aubenay, esprit curieux non moins qu'archéologue averti, visitant Vannes en 1636, s'enquit des traditions des Cordeliers. « Auparavant qu'ils fussent là », où se trouve aujourd'hui l'habitation de M. Morel (Nos 1956-1957 du plan cadastral), devant l'ancien rampart qui clôt le jardin du Château-Gaillard, « c'était », écrit-il, « à ce qu'ils disent, une petite chapelle, assise sur la douve et bord extérieur du fossé de la ville ». Et il ajoute : « Aucuns veulent dire que c'estoit un Temple et chapelle des Templiers, mais il n'y en a point de preuve » (Dubuisson-Aubenay, Itinéraire de Bretagne en 1636. Nantes, 1898, in-4°, t. I, p. 142).
Ne voilà-t-il pas une raison de respecter, en quelque sorte, la tradition ? Isolée, elle n'a point, sans doute, de signification certaine. Mais, du jour où un document apparaît qui l'explique, qui fournit là preuve demandée par Dubuisson-Aubenay, si, le plus souvent, elle n'apparaît pas entièrement conforme à la vérité, du moins elle l'étaye et la confirme.
Deux autres traditions sur Château-Gaillard ont encore cours. Il renfermerait des trésors : Gilles de Rais, le valeurenx compagnon de Jeanne d'Arc, y aurait commis certains des actes infâmes qui déshonorent sa mémoire.
Château-Gaillard, en effet, a dû conserver des trésors : les joyaux et l'argent mis sous la garde des Templiers. Ces trésors-là ont bien disparu, mais ils viennent d'être remplacés par d'autres, ceux qui constituent le Musée de la Société Polymathique.
Quant au souvenir de Gilles de Rais, il y a là, semble-t-il, substitution de mauvaise renommée. Les Templiers, on a fourni les plus fortes raisons de le croire, furent injustement condamnés. Mais que cette réputation fût créée de toute pièce ou non, la tradition bretonne ne considéra pas moins les « hommes rouges » comme perdus de moeurs, friands de rapts d'enfants. A Château-Gaillard devait donc se rattacher naturellement le souvenir de scènes odieuses. Seulement Gilles de Rais ayant été condamné à son tour, après plus d'un siècle, pour des faits semblables à ceux reprochés aux Templiers, sans doute l'imagination populaire lui attribua-t-elle bientôt les méfaits qu'elle supposait avoir été commis à Château-Gaillard.
Faut-il essayer de remonter au delà des Templiers, de recherche à qui ils succédèrent ?
Château-Gaillard actuel se trouve à quelques mètres des anciens remparts, au milieu d'une très longue courtine droite qui ne présente aucun élément de défense depuis la place Saint-Salomon. A l'endroit où il s'élève, environ, coupant la courtine, se dressait un système de fortification qui battait la courtine en même temps qu'il défendait, sans doute, une porte, la porte de la mer, devenue dans la suite la porte Mariolle.
Principale protection de la ville de ce côté, il devait avoir une certaine importance : c'était une sorte de château-fort que les Templiers occupèrent en tout ou en partie.
L'étude des lieux et le rentier permettent, semble-t-il, de donner plus de consistance à cette hypothèse. Tout autour de l'emplacement de Château-Gaillard, en effet, se trouvaient, au XVème siècle, des maisons ne payant aucune rente au duc [Note : A l'exception de trois qui paraissent bien construites, à une date plus ou moins récente, sur l'ancienne voie publique. Peut-être aussi les propriétaires n'avaient-ils pas pu se défendre de l'âpreté du fisc. Archives de la Loire-Inférieure, B. 2.239, fol. VII], et l'on est naturellement amené à penser que le terrain sur lequel elles s'élevaient, leur « place », ne faisait qu'un jadis avec celle de Château-Gaillard, représentait l'ancienne tenue des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et avant eux des Templiers.
Tout ce qui précède peut se résumer en quelques lignes. Au milieu de la longue courtine en ligne droite de l'ancienne enceinte devait s'ouvrir, dès l'époque la plus ancienne, une porte connue plus tard sous le nom de porte Mariolle. Pour la défendre s'élevait un système fortifié. Vint un jour où les Templiers l'occupèrent avec un espace délimité, semble-t-il, par les remparts, les voies ascendante et transversale, aujourd'hui rues Noé et des Halles [Note : La première, beaucoup plus large qu'elle n'est actuellement, en alignement, peut-être, avec les numéros pairs de la rue des Orfèvres], le jardin qui dépend de Château-Gaillard. Après la disparition des Templiers, l'emplacement fut divisé, mais la juridiction des Hospitaliers, leurs successeurs, était encore reconnue au XVème siècle par les détenteurs de la parcelle sur laquelle s'élevait le Château-Gaillard.
Là finissent les hypothèses vraisemblables que suggère une série de faits sur les origines de Château-Gaillard. Un premier témoignage direct, celui du rentier, fournit la liste des occupants de sa tenue. Ce sont, à partir d'une époque indéterminée, mais à coup sûr fort ancienne, et dans cet ordre : Gaillard Tournemine, Thomas « Faverill », Jean de Crésolles, gendre du précédent, Pantin, Jean de Malestroit, chancelier de Bretagne [Note : Si nous interprétons bien les termes du rentier : « La maison qui, fut Pantin, et que tindrent autreffois Gaillart Tournemine, Thomas Faverill, et Jehan de Cersolles et sa femme, fille dudit Thomas, et dempuis à l'évesque de Nantes, chancelier de Bretagne » ; - et, un peu plus haut : « Une maison qui fut Pantin et dempuis à l'évesque de Nantes ». L. c., fol. VII. r°].
Les Tournemine figurent parmi les très anciennes familles chevaleresques de Bretagne. — Nous ne saurions dire que était Thomas « Faverill ». — On trouve un Jean de Crésolles receveur d'Hennebont en 1408, contrôleur de l'hôtel du duc en 1409. Le même, sans doute, n'acquit la noblesse qu'au début du XVème siècle. Les Crésolles possédaient des terres nobles, au milieu du même siècle, en Elven, en Arradon, en Ploeren. — Pantin pourrait bien appartenir à une famille de non moins ancienne chevalerie que les Tournemine, mais d'origine angevine (Potier de Courcy, Nobiliaire de Bretagne. - De Laigue, La Noblesse Bretonne aux XVème et XVIIIème siècles. — Kerviler, Bio-bibliographie bretonne).
Voilà donc reconnu l'usage du sol sur lequel s'élève Château-Gaillard, et établie une liste de ses occupants avant Jean de Malestroit. Le moment est venu de présenter le constructeur du manoir, et de décrire sommairement son oeuvre.

II. LA « MESON NEUFFVE » DE JEAN DE MALESTROIT, CHANCELIER DE BRETAGNE.
Après Pantin, le rentier de Vannes désigne, comme propriétaire de la tenue de Château-Gaillard, Jean de Malestroit, évêque de Nantes [Note : st-il besoin de remarquer qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre les termes du rentier : « La maison... que tinrent autreffoiz Gaillart Tournemine... et denpuis à l'évesque de Nantes », pour en conclure que le Château-Gaillard n'a pu être construit par le chancelier, mais lui est antérieur ? « Maison » signifie, dans l'esprit des enquêteurs, tenue sur laquelle s'élevait une maison, L'acte invoqué un peu plus loin suffit à en fournir la preuve formelle indépendamment de beaucoup d'autres faits]. Nous avons déjà essayé d'exposer, par ailleurs [Note : J. de la Martinière, Un grand chancelier de Bretagne, Jean de Malestroit, dans le Bulletin de la Société histoire et d'archéologie de Bretagne, 1920. D'une façon générale, on pourra se référer à ce travail pour ce que renferme la présente notice sur Jean de Malestroit. Nous avons utilisé en outre quelques renseignements nouveaux dus à l'obligeance de M. l'abbé Bourdeaut, si documenté sur l'histoire du XVème siècle breton, et mentionnerons chaque fois leur source en note], comment le rôle de ce personnage fut considérable et prédominant sous le règne de Jean V. Le duc n'avait que 19 ans quand il choisit Malestroit comme chancelier en 1408 ; il le maintint ensuite continuellement dans cette charge et mourut avant son serviteur. Le chancelier, muni de l'entière confiance du souverain qui le traitait de cousin et compère, sut la garder toujours entière, au milieu des situations les plus difficiles, malgré de violentes attaques. Il exerça les prérogatives d'un premier ministre qui dispose de toutes les forces vives de l'État, et fut, semble-t-il, beaucoup moins soumis à l'influence du duc que le duc à la sienne.
Esprit souple, délié, plein de ressources, financier adroit et sans scrupule, diplomate subtil entre tous ceux de l'époque, qui en compta un si grand nombre, Jean de Malestroit nous apparaît comme le véritable directeur de la politique extérieure de la Bretagne, l'organisateur de l'administration du duché durant le règne de Jean V. Ses sympathies anglaises furent certaines : elles lui valurent d'être emprisonné, à trois reprises, par les fidèles de Charles VII, avec l'assentiment, au moins tacite, sinon avec les encouragements de celui-ci. Le connétable de Richemont l'accusait d'être soudoyé par l'Angleterre. Il signa le traité de Troyes, et les seigneurs bretons approuvèrent le traité ; mais en protestant qu'ils étaient contraints, et avaient grand honte de le faire. Il constitua, par testament, des services pour le repos de l'âme des rois d'Angleterre et de France, faisant au premier la part la plus large.
Mais, quand les circonstances rendaient pratiquement favorable un rapprochement avec la France, Malestroit n'hésitait pas à le rechercher, et s'il dirigea nombre d'ambassades à la cour d'Angleterre, sa souplesse lui permit de pas se trouver gêné quand il en conduisit d'autres à la cour de France. Autrement dit, les traités signés par la Bretagne durant le règne de Jean V n'avaient qu'une valeur, momentanée, et à Malestroit, le grand responsable de sa politique extérieure, peut s'appliquer cette maxime amère de l'historien d'Argentré : « Telles sont les alliances des princes ; ils s'en servent pour tromper pendant qu'ils attendent autres opportunitez ».
On a fait ressortir les avantages au moins apparents de ce système politique. La Bretagne souffrait, quand Malestroit prit le pouvoir, de tous les maux qu'entraîne la guerre prolongée. Récemment un historien du droit a établi le rapprochement entre sa situation économique lamentable d'alors et celle de la France d'aujourd'hui. La paix apparaissait comme la condition primordiale de l'oeuvre de restauration. Celle-ci fut poursuivie activement, avec énergie et méthode, puisque, dès le milieu du règne, les Bretons excitaient l'envie des autres peuples encore en guerre, et que l'admirable renaissance que suivit la guerre de cent ans eut son plein épanouissement dans le duché, longtemps avant qu'elle ne se développât dans le reste de la France. Nombreux subsistent les monuments qui en fournissent le témoignage. Il convient dès lors de louer le chancelier, « magni spiritus et animi vir, atque ad magna et ardua natus », comme le dit son épitaphe, d'avoir, grâce à la paix et aux résultats d'une administration habile, pansé les plaies profondes de son pays, de l'avoir conduit ensuite à la richesse.
Il convient, aussi, peut-être, de ne pas applaudir sans restriction au jeu « de bascule » qui consistait à tromper successivement l'un après l'autre, et de ne pas retenir seulement ses résultats immédiatement utilitaires. Le jeu, a-t-on remarqué, n'était pas si compliqué à conduire qu'il peut paraître tout d'abord entre la France épuisée et l'Angleterre, elle aussi bien diminuée. Il est donc permis à de bons esprits de croire qu'un grand politique, respectueux de la parole donnée et de l'antique lien féodal, eût profité de l'étroite parenté entre Jean V et Charles VII pour resserrer l'union entre la Bretagne et la France et, assurant la défense de celle-ci, garantir du même coup les libertés de celle-là. Les menées ambitieuses de François II et le désastre de Saint-Aubin-du-Cormier ne peuvent-ils être considérés comme la suite de la recherche de paix à tout prix de Malestroit et de Jean V, la conséquence de l'avance économique obtenue, grâce à elle, par la Bretagne sur la France ? [Note : Bourdeaut, Etude sur le caractère moral de Jean V. Nantes, 1916, in 8° p. 38-41 74-75].
Quoi qu'il en soit, le rôle du constructeur de Château Gaillard fut de tout premier plan dans la partie compliquée qui se joua, durant la première moitié du XVème siècle, entre la France, l'Angleterre, la Bourgogne et la Bretagne. Il n'a pas encore été suffisamment mis en valeur.
Malestroit était d'église. Recteur de Sérent, chanoine de Vannes, archidiacre de la même église de 1398 à 1402 [Note : Luco, Pouillé du diocèse de Vannes, p. 886 et 38. M. Luco donne comme date extrême de ses fonctions de recteur à Sérent, 1406, mais sans apporter aucune justification], chanoire de Nantes, archidiacre de la Mée [Note : Malestroit était chanoine de Nantes et archidiacre de la Mée au moment de sa nomination à l'évêché de Saint-Brieuc. Renseignement fourni par M. l'abbé Bourdeaut], il prit possession du siège épiscopal de Saint-Brieuc en 1405 et fut transféré à celui de Nantes en 1419. On le trouve soucieux d'accroître la richesse des églises dont il a la charge, d'assumer, avec une louable indépendance, la protection de son clergé et de ses ouailles. Il posa la première pierre du portail de la cathédrale de Nantes, et son testament prescrivit de nombreux legs en faveur d'établissements religieux du diocèse.
Sa fortune passait pour énorme aux yeux des contemporains. A ce cadet et fils de cadet de l'illustre famille des Malestroit [Note : M. l'abbé Bourdeaut nous paraît avoir démontré, dans les notes qu'il a bien voulu nous communiquer, que le chancelier était fils d'Hervé, seigneur de Mésanger, lui-même fils d'Hervé de Châteaugiron Malestroit et de Jeanne de Dol, dame de Combourg] elle n'était venue par héritage que pour une faible part ; il l'avait surtout personnellement fondée. Aux revenus de ses bénéfices ecclésiastiques se joignirent ceux des charges financières par quoi il débuta dans la carrière administrative, charges qu'il n'abandonna pas, tout d'abord, quand il fut parvenu, très vite, à jouir de tous les avantages que pouvait procurer, à cette époque, le poste le plus élevé des offices de la cour et la confiance absolue du souverain. Sans aucun doute, Malestroit sut largement profiter des facilités que lui procurait le maniement des finances de l'État et leur contrôle pour accroître ses ressources régulières. On ne saurait omettre non plus, en parlant de sa fortune, de mentionner les nombreuses acquisitions qu'il fit des biens du prodigue Gilles de Rais avant de présider le tribunal qui condamna ce grand criminel.
Jean de Malestroit « avait fait faire et édiffier » là maison appelée « Meson neuffve » au milieu du XVème siècle, connue plus tard sous le nom de Château-Gaillard. Deux actes de vente des 12 février 1454 et 24 mars 1457 [Note : « Une maison qui aultreffois fut aud. Deffunt [l'évêque de Nantes], nommée la Meson neuffve » (12 février 1454). — « Une maison qui auttreffoiz fut audit deffunct... nommée la Maison neufve » (8 mars 1455). — « Jehan de Malestroit, seigneur de Mésangé, héritier de deffunct Jehan de Malestroit, en son temps évesque de Nantes, qui avoit fait faire et édiffier celle maison » (24 mars 1457). Archives de la Loire-Inférieure, G. 319] ne laissent à ce sujet aucun doute. D'autres manoirs furent son oeuvre : à coup sûr Lestrenic, près de Vannes, dont il ne subsiste plus rien ; presque certainement le manoir épiscopal de la Touche ; à Nantes, aujourd'hui musée Dobrée, qui présente avec Château-Gaillard de très nombreux points de similitude ; vraisemblablement un autre encore à Redon (Renseignement fourni par M. de Laigue).
Les documents ne font pas connaître la date exacte où s'éleva la « Maison neuffve », et cette date ne peut être déduite des caractères archéologiques du monument, qu'on retrouve aussi bien dans les dernières années du XIVème siècle qu'au début du XVème, Peut-être convient-il, à ce point de vue, de tenir compte de l'inscription que porte une pierre de la tourelle du jardin, et qu'on pourrait lire 1400 [Note : Ces caractères ne nous paraissent pas pouvoir se traduire par un nom propre, ni s'expliquer comme marque de maçon], en admettant qu'elle présente un mélange de chiffres romains et arabes, ce qui n'est pas rare à cette époque. En ce cas, Malestroit aurait construit le Château-Gaillard alors qu'il était chanoine et archidiacre de Vannes. Il n'y a là rien que de vraisomblable. Le fait qu'il acheta ou se fit donner l'hôtel Barbette [Note : Renseignement fourni par M. l'abbé Bourdeaut], à Paris, ses nombreuses demeures, semblent témoigner qu'il leur attribuait un rôle important dans l'art de parvenir ou de paraître.
La Maison neuve fut édifiée en deux fois, mais à des dates très rapprochées l'une de l'autre. Ses deux corps de logis, en effet, qui se joignent sur un étroit espace, ne sont pas liés l'un à l'autre, se trouvent seulement appliqués l'un contre l'autre. Le plus récent, qui est le plus petit, celui du côté du jardin, suivit sans tarder le premier, puisque le caractère de leurs bâtisses, et en particulier les profils de leurs ouvertures sont identiques.
Comme terrain, le maître d'oeuvre de Malestroit disposait seulement tout d'abord d'un long couloir entre la rue qui montait des Cordeliers à la cathédrale, rue Noë actuelle, et les jardins des maisons voisines de la Pâtisserie établie rue des Halles. Il donna à sa construction la forme irrégulière du couloir. La façade sur la rue Noë, si elle se trouve parallèle à celle du jardin, n'a pas la même largeur : par suite les deux murs des grands côtés manquent de parallélisme.
Il n'existait pas de disposition intérieure. Au rez-de-chaussée, aux deux étages, une seule salle occupait tout l'espace compris entre les quatre murs. La vaste dimension des pièces frappe au premier abord, et atténue ce qui pourrait choquer l'oeil dans le manque d'équilibre de leurs lignes. Chacune d'elles possède deux cheminées monumentales dont les pieds-droits soutiennent, à l'aide de consoles et de larges linteaux, des hottes aussi hautes que l'étage, et se superposent de telle sorte qu'elles forment corps, pour ainsi dire, d'un étage à l'autre. Leurs moulures rappellent singulièrement celles du logis de Sucinio. Avec les énormes poutres apparentes des planchers, elles constituaient une ornementation architecturale sobre et sévère. Au rez-de-chaussée les portes [Note : La grande porte n'est pas ancienne, mais fut percée au moment de l'aménagement en musée. Nous ne connaissons pas de tracé semblable au sien dans la région, datant du XVème siècle], aux étages trois fenêtres à meneaux cruciformes fort simples, plutôt étroites, s'ouvrant dans trois directions différentes, leur dispensaient assez parcimonieusement la lumière. L'escalier actuel, à tourelle polygonale, du XVIème le siècle, a remplacé sans doute l'escalier primitif [Note : On ne peut trouver, en effet, la place du premier escalier ailleurs qu'en cet endroit même. Au moment des réparations on abattit les arêtes vives des ouvertures de la tourelle et on les transforma en gorges, pour rappeler sans doute celles des ouvertures du logis lui-même].
Très vite Jean de Malestroit trouva sa demeure de dimension insuffisante. Pour l'agrandir il acquit les jardins qui bordaient sa propriété au nord [Note : Rentier de Vannes : « Les maisons qui furent.... et par derrière respondent à ung courtill que tint led. Jehan le Prévost qui dempuis le bailla â l'évesque de Nantes, chancelier de Bretagne, et à présent appartient à messire Jehan de Malestroit, chevalier, seigneur de Mésangé », Archives de la Loire-Inférieure, B. 2.339, fol. VII v°] et, de ce côté, éleva un second corps de logis sous forme d'une tour presque carrée. La nouvelle construction utilisait une petite partie du mur nord de l'ancienne, juste assez large pour établir la porte de communication joignant l'une à l'autre. Il fallait, en effet, laisser aussi dégagées que possible les fenêtres déjà percées au milieu du même mur. Au coin de la tour carrée, du côté du jardin, s'appliqua la légère tourelle d'un second escalier à vis [Note : M. Roger Grand (Congrès archéologique de France ; session de Brest et Vannes, 1944 ; Paris, 1919, p. 430) pense que cette tourelle fut ajoutée ou refaite après coup. Cependant les moulures du socle, à la base du noyau de l'escalier, paraissent fort anciennes ; le pignon de ce côté du bâtiment fut, dès l'origine, semble-t-il, coupé à angle droit pour laisser place à la toiture de la tourelle ; dans sa partie inférieure, celle-ci est en granit et fait corps avec les murs qu'elle accole ; enfin, c'eût été un travail fort délicat que d'abattre un angle de la bâtisse pour y substituer une tourelle d'escalier. Si vraiment, ce qui ne nous paraît pas certain, la partie supérieure de la tourelle, en pierre blanche, est un collage, il faut, croyons-nous, en chercher l'explication dans la réfection postérieure d'une partie seulement de la tourelle. Le souci de la propreté a fait boucher les trous de balle de la tourelle, dont certaines provenaient, dit-on, d'arquebusades pointées du haut des tours de la cathédrale].
Ne nous y trompons pas: Château-Gaillard ne donne pas l'impression de richesse par l'ampleur de son plan et le luxe de son décor [Note : Ce qui confirme, à certains égards, la date de 1400. Le chancelier eût fait mieux]. Seulement les maçons, sur de hauts murs en solide blocage, dressèrent de hardis pignons dont les rempants dévalent avec rapidité ; les tailleurs de pierre ont soigneusement fini les joints et les moulures des cadres de ses ouvertures, des pieds-droits et des consoles de ses monumentales cheminées ; les charpentiers prirent plaisir à établir de solides planchers sur des poutres énormes [Note : Des planchettes de bois blanc, peintes en vieux bois, couvrent aujourd'hui les magnifiques poutres du rez-de-chaussée] et, pour soutenir l'ardoise de sa toiture, à monter une carène renversée aux fines et multiples nervures [Note : Elle est aujourd'hui cachée sous le plâtre mis au moment des réparations]. C'est le manoir urbain construit tout au début du XVème siècle, suivant les bonnes règles, par les maîtres ouvriers du pays. Très élancé, il donne cependant une impression de force.
Pour l'orner, le chancelier sut utiliser les riches tentures, les lourds bahuts, les orfèvreries étincelantes. Nous pouvons nous le figurer dans les salles qui sont maintenant celles de la Polymathique. Revêtu d'une somptueuse robe de « fort satin cramoisi », il « gouverne » avec tact le compère que lui en a fait don, le faible duc Jean V, il s'incline devant Jeanne de France qui sut, à l'occasion, même vis-à-vis de lui, revendiquer hautement ses origines, il discute avec le connétable de Richemont. Là défilent les plus grands noms de Bretagne, sans prétendre en imposer, car aucun « n'est plus proche » du souverain, au témoignage du souverain lui-même, que « son cousin » de Malestroit, et avec eux les représentants des cours souveraines qui sollicitent son appui plutôt qu'ils n'osent le menacer. Là encore le chancelier préside le conseil, discute finances, prépare les constitutions. Mais c'est à son manoir épiscopal de la Touche, près de Nantes, que Jean V, assisté par lui, rendit le dernier soupir. Le chancelier suivit peu après le duc dans la tombe (1443).
Hervé de Malestroit, seigneur du Chastel et d'Usel, recueillit sa succession et fut nommé exécuteur testamentaire. Mais bientôt, « à cause de sa débilité », il céda profits et charges à son fils aîné, Jean, seigneur de Mésanger, neveu du défunt [Note : Renseignements fournis par M. l'abbé Bourdeaut], qui les accepta sous bénéfice d'inventaire (Archives de la Loire-Inférieure, G. 320). Les chanoines de Notre-Dame de Nantes réclamèrent alors 1.000 écus d'or, à eux légués par le défunt, pour célébrer « certaines fondations et services », et, comme Mésanger ne s'exécutait pas, menacèrent de le poursuivre s'il ne les dédommageait pas en leur cédant une terre noble. Il protesta que, « des biens nobles » du chancelier, « il n'en avoit aucuns, ains les avoit mis et emploiez au paiement des dettes d'iceli, et en plus grant numbre que n'en avoit eu par l'inventaire ».
Les chanoines revendiquèrent alors la Maison neuve « affin de la descharge de l'amme dud deffunt ». Mésanger acepta de la leur céder et fit passer l'acte de vente à Châteaubriant le 12 février 1454. La maison pouvait valoir plus ou moins que la somme due. Un expert fut donc nommé, Jean Ducelier, sénéchal de Nantes, qui s'aida de « conseillers se congnoissans en telle matere » pour estimer la maison 1.500 royaux d'or, par acte du 8 mars 1455 [Note : Acte de vente du 12 février 1454 ; nomination de procureurs par le Chapitre pour faire l'estimation, 11 novembre 1454 ; acte d'estimation, 8 mars 1455 ; nomination de procureurs par Mésanger pour faire entrer le Chapitre en possession, 25 mai 1455. Le Chapitre devait au seigneur de Mésanger 50 royaux d'or représentant la différence entre la valeur de la maison et ce qui leur était dû. C'est seulement le 5 octobre 1458 qu'il les versa entre les mains de Gilles Loret, créancier de Mésanger, tant en son nom que comme garde naturel des enfants qu'il avait eus de son mariage avec Honorée de Crésolles. Archives de la Loire-Inférieure, G. 320].
Les chanoines n'entrèrent en possession que postérieurement au 25 mai, et cherchèrent immédiatement à réaliser la valeur de leur gage. Il est même permis de supposer, comme on va le voir, que ces ecclésiastiques jouèrent, en quelque sorte, le rôle de personnes interposées au profit de l'État.

III. LA « PRÉSIDENTERIE » ET « MAISON DU PARLEMENT ».
Dès 1425 l'ordonnance créant la cour de justice appelée à juger en dernier ressort « comme de Parlement » désigne la ville de Vannes pour servir de lieu habituel à ses séances. Quand Pierre II, en 1456, réorganisa l'exercice de la justice et constitua un Parlement indépendant des États, il entendit maintenir le choix de Vannes comme ville de parlement, pour le plus grand profit des plaideurs. La preuve en est dans l'acquisition qu'il fit alors de la Maison neuve.
Le 25 mai 1455 les chanoines de Notre-Dame de Nantes, nous l'avons vu, n'étaient pas encore en possession de l'immeuble ; dès le 22 octobre 1456 ils donnaient pouvoir à l'un d'eux, Gilles Guérin, pour le vendre. Des négociations s'engagèrent sans plus tarder avec les représentants du duc. Un accord de principe était conclu le 14 janvier, auquel prenaient part le chevecier et trois chanoines. Il fallait le consentement de l'évêque et du Chapitre cathédral qu'ils accordèrent le 4 mars. Enfin le 5 mai 1457, à Vannes, devant les notaires G. de Coëtlogon et G. de Bogier, comparaissaient en personnes le procureur du Chapitre Notre-Dame et « très hault et puissant prince. Pierre, par la grâce de Dieu duc de Bretagne ». Le duc « print et accepta au tiltre de vente une maison avec la court et départ du devant d'icelle et le jardrin de derrière, joignant d'un bout au pavé de la rue par laquelle l'on va du moustier de Saint-Franczois à l'église de Saint-Pere, naguère appartenant à messire Jehan de Malestroit, seigneur de Mésanger, héritier de deffunct Jehan de Malestroit, en son temps évesque de Nantes, qui avait fait fairre et édiffier celle Maison » (Nous avons abrégé les formules). La vente était consentie moyennant 1.050 réaux d'or « de pois de franc quites de cout » ; le paiement devait se faire par trois versements annuels de 350 réaulx, à commencer au bout de trois ans.
Seulement, dès cette époque, le trésor de l'Etat se trouvait souvent à sec. Les chanoines le savaient bien et prirent leurs précautions nonobstant l'engagement personnel du duc. Il fut stipulé que, « tandis que nostre souverain seigneur sera en deffault de leur faire paiement de lad. somme, il leur poiera ou les assignera valablement d'estre poiez par main du numbre de 40 livres par chacun an ».
Pierre II ne prévoyait pas que la cour ducale pût quitter Vannes, trouvait sans doute avantage à préciser le principe posé dès 1425, et à donner corps à la tradition et aux usages fixant, autant que possible, le séjour de la cour de justice suprême dans cette ville. Ainsi s'explique qu'il acquit la maison construite par le chancelier Malestroit pour servir non pas seulement d'auditoire au Parlement, mais aussi de demeure au président du Parlement. La Maison neuve perdit son nom pour prendre celui de « Maison du Parlement » ou « Présidenterie ».
Depuis lors le Parlement ne cessa de siéger en principe à Vannes. La cour essaya bien, à diverses reprises, de ne pas pousser jusque là et de s'arrêter à Nantes où siégeait déjà le Conseil. Mais la ville de Vannes, appuyée par les États de Bretagne, revendiqua ce qu'elle considérait son privilège intangible d'être la ville du Parlement, parce que « serait dure chose aux pauvres gens tant de Léon, Brest, Kimper et autres lieux loingtains de venir chercher la justice huit à dix journées de leurs domicilles, ce qu'ilz feroient si led. Parlement tenoist en nostre ville de Nantes », tandis que Vannes « est quasi le millieu du duché auquel lieu a une maison donnée pour tenir et exercer la juridiction appelée la Maison du Parlement ». Successivement Charles VIII, Louis XII (1500), François Ier (1515), reconnurent officiellement ce privilège par lettres patentes.
Le Parlement de Bretagne avait dans sa maison sa tapisserie qu'il lui arriva de transporter à Nantes en même tempe que ses archives, au grand scandale des Vannetais à qui il devait bientôt promettre de les leur faire revoir. Les murs de Château-Gaillard ont vu siéger les graves conseillers aux chaperons fourrés d'hermine, ont retenti à la voix des maîtres de l'éloquence bretonne s'essayant, parfois, à suivre l'exemple de leur patron saint Yves ; ses appartements ont servi d'asile à d'éminents juristes et administrateurs, les juges universels de Bretagne, puis les présidents des Grands. Jours, ces derniers choisis, l'un dans la haute magistrature française, du parlement des requêtes, ou du Grand Conseil, l'autre parmi les magistrats bretons.
La « Présidenterie » fut logis de droit et souvent de fait pour toute une lignée de personnages dont beaucoup ont laissé un grand nom. Leur liste s'établit comme suit.
Tout d'abord les Juges universels ou Présidents de Bretagne : Jean Loaisel, pour qui la Maison neuve avait été acquise et qui fut un des hommes politiques les plus en vue de son temps (1451-1468) [Note : Les dates extrêmes que nous donnons sont celles qui auraient marqué les fonctions de juge universel] ; Bertrand Milon, comme son prédécesseur aussi bien ambassadeur que magistrat ; Olivier du Breil, « grand homme d'État et grand homme de bien », au dire des plus compétents ; peut-être Alain de Coatgoureden, plutôt d'épée que de robe ; Jean Scliczon, dont Charles VIII confirma la nomination faite par la duchesse Anne et qui laissa peu de souvenirs.
Les Grands Jours comprirent jusqu'à deux et trois présidents. Sans une absolue certitude pour quelques-uns, on peut relever, comme ayant exercé cette charge : Jean de Ganay (1495-1500) ; plus tard premier président du parlement de Paris et chancelier de France (1507) ; Roland du Breil (1495), frère d'Olivier déjà cité, remarquable en ce qu'il contracta successivement cinq mariages ; Charles Guillard, devenu dans la suite président au parlement de Paris ; Amaury de Quenech'quivily, un des bons serviteurs d'Anne de Bretagne, témoin de son second mariage ; Anthoine le Viste, qui mourut en 1534 « chargé d'honneur, de biens et de mérites » ; Gille le Rouge, conseiller au Grand Conseil ; Louis des Dézerts (1532), célèbre pour avoir fourni au chancelier du Prat une solution élégante du problème de l'union de la Bretagne à la France ; Guillaume, Poyet, dont les capacités, en même temps que les malversations, dans la charge de chancelier de France (1538-1542), sont bien connues ; Jean Bertrand, lequel devint lui aussi chancelier (1550), et en outre archevêque de Sens et cardinal ; Antoine de Bourgneuf, d'une famille où le Parlement de Rennes recruta une lignée de présidents ; François Crespin, président à mortier du parlement de Rennes à sa création (1554).
Par suite de la création d'une seconde chambre, la « présidenterie » devint insuffisante pour servir d'auditoire. La cour du Parlement se tint à partir de 1535 dans l'ancienne Chambre des Comptes. Aussi le receveur des taux et amendes s'avisa-t-il de refuser au Chapitre Notre-Dame la rente de 40 livres qu'il lui payait jusque là. Sur rappel par les chanoines des termes du contrat de vente du 24 mars 1456, une enquête fut ordonnée. Après examen des « comptes de la recette et paiement des gages des gens de la cour du Parlement », la Chambre des Comptes de Bretagne reconnut le bien fondé des réclamations du Chapitre et, par sentence du 20 mai 1539, ordonna aux agents comptables du Parlement de régler les arrérages de la rente et de continuer désormais à la payer.
La « Maison neuve » avait vieilli, la « Maison du Parlement » ne lui donnait plus asile, la « Présidenterie » ne logeait plus les présidents ; c'est alors qu'apparut le nom de Château-Gaillard. « Une maison nommée et vulgairement appelée le Chasteau-Gaillard », lit-on dans un acte official de 1554. Ce nom a la signification précise de demeure fortifiée, et s'employait, dans l'usage courant, comme un nom commun. Faut-il lui chercher une origine lointaine remontant au système fortifié du rempart près duquel Malestroit avait bâti son manoir ? Nous ne le croyons pas, car les documents n'auraient pas répété, avec tant d'insistance, les seuls noms de Maison Neuve, Maison du Parlement et Présidenterie, comme ceux sous lesquels se trouvait désigné le manoir en question. Il devint Château-Gaillard, dans le parler populaire, entre 1535 et 1550 seulement, selon toute vraisemblance. Quant aux motifs qui ont fait adopter ce nom, il est difficile de les découvrir.
La maison du Parlement n'appartenait pas à l' « ancien et propre domaine » du souverain ; les officiers de celui-ci mirent du temps à s'apercevoir qu'il n'y avait « aucune personne y demeurant », qu'elle était « de charges sur les finances royales ». Mais il arriva un jour où Henri II, pressé d'argent, résolut d'aliéner une part de son domaine en Bretagne. Nicolas de Troyes, trésorier général, et Bertrand d'Argentré, sénéchal de Rennes, le juriste et l'historien célèbre, « firent bannyes et proclamations » sans grand succès tout d'abord. Ils crurent devoir accepter bientôt les offres, cependant bien médiocres, de l'alloué de Vannes, Jean Botherel, sr. de Kermourault [Note : Kerviler, dans sa Bio-Bibliographie bretonne, ne peut rattacher la branche de Kermourault aux deux principales branches des Botherel]. Château-Gaillard devint la propriété de ce magistrat moyennant qu'il versât tout de suite 700 livres tournois et s'engageât à payer 12 deniers de rente en deux termes annuels (30 sept. 1554) [Note : L'acte de vente, passé à Rennes devant les notaires Michel et Plaudren, le 30 septembre 1554, dans la maison de Jean Amiette, receveur ordinaire, fut enregistré au parlement le 30 mai 1555. Archives de la Loire-Inférieure, B. 703. — C'est Botherel ou un de ses successeurs de la seconde moitié du XVIème siècle qui fit bâtir le tourelle polygonale de la façade sur la cour].
Bâti par le Chancelier, habité par les Juges universels, puis par les présidents du Parlement, Château-Gaillard allait encore servir de demeure à l'un des principaux représentants de la justice royale à Vannes.

IV. L'HÔTEL DES PRÉSIDENTS DE VANNES ET DE L'AVOCAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT.
Les documents sur la Ligue à Vannes sont trop peu nombreux et explicites pour qu'il soit possible de suivre le sort de Château-Gaillard durant cette période. Demeura-t-il dans la famille de l'alloué Botherel de Kermourault dont les descendants figurent parmi les membres du présidial au début du XVIIème siècle [Note : Pierre Botherel, juge et magistrat criminel au présidial, époux de Jeanne du Vergier, seigneur et dame du Vertin, Kermourault, Saint-Denat, etc. État-civil de Vannes, 5 octobre 1632] ; passa-t-il en d'autres mains ? Nous ne saurions rien présumer à ce sujet et retrouvons Château Gaillard seulement au second quart du XVIIIème siècle. Il est alors hôtel du Président de Vannes.
Madame le Prince de Beaumont fait écrire en 1768 à une héroïne de roman, perdue en pleine campagne, à propos des beaux atours qu'on vient de lui découvrir : « On dit dans le village qu'il faut que je sois une princesse ou fille de quelque président ». Et elle explique en note : « Dans les lieux voisins des parlements, le paysan croit, qu'après les princes, il n'y a rien de si grand qu'un président » [Note : Le Prince de Beaumont, La nouvelle Clarisse, histoire véritable. Amsterdam, 1768, in-12, t. II, p. 127 et n.].
De fait le président du présidial, aussi bien que le président du parlement, au début du XVIIème siècle bien plus encore qu'à la fin du XVIIIème, apparaît comme un très important personnage, le premier représentant du pouvoir souverain dans son coin de province, par l'autorité que lui donne sa charge et les honneurs qui l'accompagnent, sa fortune et le faste dont il s'entoure.
Aussi n'est-ce pas le titre de président au présidial, mais celui de Président de Vannes, Praeses Venetensis, que nous voyons prendre à Jean Morin. Fils de premier président à la Chambre des Comptes de Bretagne, généreusement il laissa ses deux fils revêtir la bure grise des Carmes, et ne trouva pas de meilleur emploi à sa grosse fortune que d'établir un couvent de l'ordre dans la ville [Note : Jean Morin est qualifié de sénéchal en 1607, de président et sénéchal le 13 juillet 1611 (État-civil de Vannes). Sa mère, veuve du premier président, est marraine d'une de ses filles le 20 janvier 1602 (Id.). Sur son rôle dans la fondation des Carmes, cf. Le Mené, Les Carmes déchaussés de Vannes] où il avait paru si longtemps au premier rang.
La lourde succession d'une charge tenue avec tant d'honneur et d'éclat fut relevée par le jeune représentant, chef de nom et d'armes, d'une maison d'ancienne chevalerie. Avec Pierre de Sérent se renoue la chaîne un moment interrompue des propriétaires de Château-Gaillard.
D'étroites relations de sympathie existaient, à coup sûr, entre les deux familles et expliquent que Jean Morin ait consenti la vente de sa charge à ce jeune homme de préférence à tout autre [Note : La succession directe de Jean Morin à Pierre de Sérent n'est pas absolument certaine. Nous trouvons Morin avec son titre de président pour la dernière fois en 1629 (fondation des Carmes). Mais il ne décéda que le 30 mars 1645 (état-civil de Vannes). D'autre part, Pierre de Sérent apparait pour la première fois avec le titre de président le 15 janvier 1643 (état-civil de Vannes). Rosenzweig, dans une étude sur le présidial et la sénéchaussée de Vannes parue dans l'Annuaire du Morbihan de 1860, indique bien comme président en 1630 un Guillaume Prado. Mais il a commis plusieurs erreurs, confondant sénéchal et président, et nous ne trouvons nulle part confirmation de la présidence de ce Prado]. En effet, le seigneur de la Rivière et d'Aguénéac, père du nouveau récipiendaire, avait vu, lui aussi, un de ses fils, Mahéas, entrer chez les Carmes : ce fut le premier historiographe du pèlerinage de Sainte-Anne. Devenu veuf de Catherine Bernard des Greffains, lui-même reçut des mains de Mgr de Rosmadec la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat le 7 mars 1637, le diaconat le 10 avril, la prêtrise le 19 septembre de la même année (Archives du Morbihan, G. 301).
Le président Pierre de Sérent sut maintenir le lustre donné par ses prédécesseurs aux fonctions qu'il occupait, et ne démentit pas ses origines. Conseiller d'État, maître des requêtes de la reine-mère Anne d'Autriche, il commanda le ban et l'arrière-ban de son évêché, présida l'ordre des villes à plusieurs sessions des États. Une des preuves de la faveur où le tenait la Cour semble être l'érection. en châtellenie par lettres patentes, en 1650, des terres réunies de la Rivière, Aguénéac, Trédion et Guervazic, avec droit de haute, moyenne et basse justice [Note : Sur les Sérent, consulter la généalogie publiée par Moréri ; de Laigue, Les chevaliers de Malte Morbihannais. Preuves de noblesse de Pierre de Sérent, 12 avril 1663, dans Bul. de la Soc. Polymathique, 1897, p. 188 et s. ; La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, t. XVIII].
Vers le même temps où il devenait Président de Vannes, Pierre de Sérent avait épousé Gillonne de Mancel, âgée seulement de 13 ans, fille de Nicolas, seigneur de la Villecaro (contrat du 23 juin 1633). La vie de la plupart des enfants issus de cette union prouve assez, par elle-même, la haute valeur morale de leurs parents et en particulier de leur mère, quelle foi profonde animait tous leurs actes. C'est à Château-Gaillard que plusieurs naquirent ; c'est là que tous reçurent leur première formation [Note : Pierre de Sérent n'est pas mentionné comme propriétaire de Château-Gaillard, à notre connaissance, avant le 29 mars 1659. (Minute de Leclerc, notaire à Vannes, aux Archives du Morbihan). Mais nous ne doutons guère qu'il l'ait habité dès sa nomination comme président, antérieure au 15 janvier 1643. — Sur les dates de naissance des enfants du président, cf. état-civil de Vannes].
Pierre, le second fils, baptisé le 26 juillet 1644, fournit ses preuves de noblesse pour entrer à Malte le 12 avril 1663. — Vincent-René, baptisé le 8 avril 1650, fut admis chez les Jésuites le 16 septembre 1668, enseigna la grammaire, les humanités et la rhétorique, puis la philosophie pendant 11 ans, les mathématiques pendant 4 ans, demeura 6 ans recteur, garda enfin la direction des retraites pendant 13 ans et mourut à Rennes le 17 juillet 1729. On connaît de lui une oraison funèbre de Madeleine de Cogneux, abbesse de la Joie, à Hennebont, imprimée chez le Sieur, à Vannes (1689), et La journée chrétienne ou règlement spirituel pour une personne qui sort de la retraite (Rennes, 1735) (Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Paris, t. VII, 1896., col. 1.146). — René-Gilles, recteur de Saint-Careuc [Note : Il porte ce titre dans deux actes de Leclerc, notaire à Vannes, des 24 avril et 2 mai 1682. Archives du Morbihan], évêché de Saint-Brieuc, puis de Sérent (Luco, Pouillé), y mourut en 1706. — Trois filles entrèrent aux Ursulines, une aux Hospitalières, deux autres, Marie-Anne et Anne-Bertranne, demeurèrent sans alliance.
Le plus connu de tous, et qui mérite qu'on s'y arrête, Joseph-Melchior, devint tout jeune abbé de Prières dans des circonstances singulières. M. du Tertre, abbé de ce monastère, venait de mourir au collège de Saint-Bernard, à Paris (8 décembre 1680). Le prieur et le cellérier qui l'accompagnaient cachèrent soigneusement cette mort de peur qu'on ne leur imposât un abbé commendataire, et allèrent demander les conseils de l'abbesse de Maubuisson, tante de la duchesse d'Orléans. L'abbesse écrivit au duc, son neveu, qui se rendit sans plus tarder chez le roi et le pria de lui réserver la nomination, ce à quoi le roi consentit, à condition qu'elle fût un peu retardée. Sur la recommandation d'un chambellan du duc, qui avait épousé une parente des Sérent, Joseph-Melchior fut présenté par le duc, et choisi sans difficulté par le roi de préférence à cinq autres candidats. N'ayant que 26 ans, il professait alors la philosophie au collège de St-Bernard et ne put obtenir de la curie romaine ses bulles de nomination avant 1684 [Note : Petit abrégé historique et chronologique de la fondation et dotation de l'abbaye de Prières. D'après la copie faite par les soins de M. l'abbé Chauffier et conservée par lui]. « L'abbé de Prières, dit Moréri, fut regardé comme l'oracle de son ordre, en fut fait vicaire général de bonne heure, et visiteur de cinq grandes provinces ». Il « se fit un nom » aux chapitres généraux de Cîteaux, et vint en aide, de tout son pouvoir, aux réformes de son ami, l'abbé de Rancé. Prières comptait 40 religieux quand il en prit la direction ; bientôt il en eut une centaine, parmi lesquels beaucoup d'hommes de valeur. Pour les loger, les bâtiments de l'abbaye furent refaits en grande partie. L'abbé de Sérent y recevait et faisait instruire un certain nombre d'enfants appartenant à la noblesse pauvre de la province. Ce furent les prodromes de l'Hôtel des gentilshommes [Note : Sur cette institution, cf. Ogée, au mot Rennes. édit. 1853, t. II, p. 498 et s.] fondé plus tard à Rennes et où son portrait figurait en place d'honneur. Mais la grande oeuvre à laquelle il voua les efforts de la fin de sa vie fut la construction de l'église de son abbaye, qu'il voulait magnifique et qui provoqua en effet l'admiration des contemporains, Quand Mgr de Fagon l'eut consacrée, le 20 juillet 1726, Jean-Melchior de Sérent résigna ses fonctions abbatiales. Il mourait au bout de quelques mois (28 juillet 1727), à 72 ans, après 46 ans d'abbatiat.
Le président Pierre de Sérent, comme propriétaire de Château-Gaillard, eut quelques difficultés avec son voisin, Daniel Bonfils, sr de la Rivière avait fait construire un logement près la cour de l'hôtel et ouvrir une petite fenêtre sur cette cour, qui se voit encore, d'où procès. Le sr de la Rivière faillit en outre gêner le droit d' « échelage » que prétendait le président pour surveiller « un grand ballet et esgout le long de la longer de Château-Gaillard » [Note : Transaction du 29 mars 1659 passée par Leclerc, notaire à Vannes (Archives du Morbihan), et sentence du Présidial d'Auray (Archives du Morbihan, B. 690)].
Nous attribuons à Pierre de Sérent un aménagement de l'appartement du second étage dont subsistent les boiseries de la cheminée et celles du cabinet dit des Pères du Désert.
Le président mourut le 15 juin 1663. Une Marque sensible du respect inspiré par son caractère se trouve dans la mention des registres paroissiaux le concernant. Le Chapitre cathédral assista au lief du corps et même l'accompagna jusqu'an delà du faubourg, à la Burbanière, où il fut mis dans un carrosse préparé à cet effet, qui le transporta au caveau de famille de l'église tréviale de Saint-Nicolas, paroisse d'Elven, près de sa maison d'Aguénéac (Archives de la ville de Vannes, état-civil). Une telle attention de la part de Messieurs du Chapitre parut tout-à-fait digne de mémoire à l'ecclésiastique qui enregistra le décès.
Pierre de Sérent y est encore mentionné avec le titre de Président. En fait, il avait déjà transmis la charge à son fils aîné, René, dont nous n'avons pas encore parlé. René, chevalier, seigneur de Sérent, de Guervazic, de la Rivière et d'Aguénéac, conseiller du Roi en ses conseils, Président de Vannes, demeurant en son Château-Gaillard, reconnaît avoir reçu de François le Meillour, écuyer, seigneur de Parun, 3.400 livres remboursables dans un an, le 22 avril 1661 (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). Dans la carrière du nouveau président, ce sont ses pressants besoins d'argent que nous connaissons surtout. Il devait payer à Guillaume Lacour, banquier à Vannes, le 12 avril 1667, la grosse somme de 16.837 livres, et ne le peut, mais promet de le faire au bout d'un an (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). Le 24 décembre 1667, le Meillour n'est pas encore réglé de ses 3.400 livres, et a même prêté 400 livres de plus (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). C'est 20.000 livres dont Sérent se reconnaît débiteur envers Lacour le 30 décembre 1669 (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). Le Meillour n'a rien touché en remboursement de ses avances de 1661 le 23 février 1675, et ne reçoit même pas les intérêts avec régularité (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). Cette même année, ses débiteurs exécutent René. Il lui devenait d'ailleurs impossible de faire face à l'accroissement de dépenses de toutes sortes que devait causer à un président du présidial l'arrivée du Parlement de Bretagne à Vannes. Sa charge et Château-Gaillard furent vendus judiciairement [Note : Id., 17 juin 1675 ; Archives du Morbihan, B 609 ; Archives de la Loire-Inférieure, déclaration de Claude de Francheville enregistrée le 2 janvier 1683, B 2 352].
Nous n'avons pu découvrir les causes vraies et profondes de cette ruine. Le président Pierre avait-il laissé une situation obérée qui se traduisit par de graves mécomptes lors du partage de ses biens, le 13 août 1663 [Note : Mentionné dans un acte de Leclerc du 27 janvier 1671. Archives du Morbihan] ? Nous avons peine à le croire, et il semble bien que les frères et soeurs de René surent se sacrifier pour leur aîné appelé à soutenir l'honneur du nom. Ses dettes commencent avant son mariage avec Guillemette du Bolan, dame de la Villéan [Note : Postérieur à 1661 (Minute de Leclerc, notaire, l. c., du 22 avril 1662), antérieur à 1665, date de la naissance de Charlotte-Gillonne, leur fille, baptisée le 12 avril de cette année par Mgr Charles de Rosmadec (Arch. de la ville de Vannes, état-civil).], qui lui apportait, assurément, une jolie fortune. Peut-être était-il joueur ?
En tout cas il trouva de nombreux appuis près de sa famille et de ses amis. Quand Joseph Bidé, sieur de la Granville, conseiller au Grand Conseil, se substitua aux droits du banquier Lacour (Leclerc, notaire, acte du 30 décembre 1669. Archives du Morbihan), on peut se demander si ce ne fut pas pour faciliter le règlement de la dette du président, que dut faire en outre appel à toutes sortes de cautions. Ses meilleurs soutiens semblent bien avoir été sa mère et sa femme.
Nous avons un témoignage amusant du grand esprit d'économie de Gillonne Mancel. Ayant chargé un tailleur de vendre pour son compte une robe de velours, elle le poursuivit en justice pour lui faire verser ce qu'il devait. Le tailleur, stupéfait, ne put s'empêcher de remarquer que, si Madame la Présidente voulait l'argent de la robe, elle aurait bien pu le lui faire gagner (Leclerc, notaire, acte du 23 novembre 1657. Archives du Morbihan). Après la mort de son mari, Gillonne, donatrice des biens de leur communauté et tutrice de leurs enfants mineurs, organisa sa fortune par une série d'actes passés chez le notaire Leclerc, qui paraît avoir été moins un conseil, pour ses clients, que l'enregistreur de leurs volontés. Les formes qu'elle prend pour donner à son fils René, le 22 février 1671, l'autorisation de vendre sa terre de Guervazic (Leclerc, notaire, actes. Archives du Morbihan), nous paraissent un modèle de prudence et de fermeté. C'est avec Guillemette du Bolan, le 25 mars 1680, qu'elle règle définitivement, hors de la présence de l'intéressé, la situation vis-à-vis d'elle, de leur fils et mari (Leclerc, notaire, actes. Archives du Morbihan). C'est elle qui établit le règlement final avec le créancier de celui-ci, François le Meillour du Parun, le 19 juillet 1681 (Leclerc, notaire, actes. Archives du Morbihan). Depuis son veuvage, elle vécut avec ses deux filles, Marie-Anne et Anne-Bertranne, à Vannes, sur la place des Lisses, près du jeu de paume, ou rue Saint-Vincent, et à Aguénéac (Minutes de Leclerc, notaire). Quant à René de Sérent, d'abord retiré à la Villéan, propriété lui venant de sa femme, il acquit dans la suite la charge de sénéchal de Ploërmel [Note : D'après M. de Bellevue, Ploërmel, ville et sénéchaussée. Paris, 1915, in-8°, p. 245-246, René ne serait pas devenu sénéchal de Ploërmel comme le disent les généalogistes, et en particulier Moréri. ll y a là une omission involontaire de M. de Bellevue, comme le prouvent les registres de la sénéchaussée de Ploërmel].
Parmi les créanciers du président de Vannes se trouvait Catherine de Francheville (Archives du Morbihan, E, fonds Francheville. Acte du 4 juillet 1676) et peut-être d'autres membres de cette famille dont le chef, Claude, remplissait à Vannes les fonctions de sénéchal depuis 1643 environ (Archives du Morbihan, B 897). De moins ancienne noblesse que les Sérent, le sénéchal, bien qu'il pût prendre le titre de « premier magistrat » du présidial, n'avait cessé de suivre, et d'assez loin, dans la hiérarchie et les honneurs, le président. Ce titre devenant vacant, comment Claude de Francheville, qui jouissait d'une belle fortune, aurait-il laissé échapper l'occasion de le faire prendre à son aîné, Daniel, dont les talents faisaient prévoir une brillante carrière ? Il acquit donc judiciairement la charge de président du présidial, le 17 avril 1675, moyennant 36.200 livres, en même temps que Château-Gaillard, moyennant 5.500 livres [Note : Cf. ci-dessus, page 115, n. 7. Sentence d'ordre du 20 juil. 1675, aux Archives du Parlement, à Rennes. Parmi les créanciers, outre Bidé de la Grandville, intendant de Limoges, le principal, nous relevons les noms de Cillard, Descartes, du Bahuno, de Talhouët, Quifistre de Basvalan, etc.]. Claude ne quitta pas, semble-t-il, l'hôtel qu'il avait fait construire place des Lisses [Note : Déclaration devant Rio, notaire, le 23 avril 1678, enregistrée dans un acte du 5 janv. 1684. Archives de la Loire-Inférieure, B 2.352, fol. 135], mais eut la satisfaction de faire prendre à son fils la succession complète des Sérent en l'établissant à Château-Gaillard, dont il garda cependant personnellement la propriété [Note : Archives de la Loire-Inférieure, B. 457 et B 2.352 : déclarations de Claude de Francheville].
Pourvu le 9 décembre 1675, peu après l'arrivée du Parlement à Vannes, installé le 16 janvier 1676, à 27 ans [Note : Sur ces dates et, d'une façon générale, sur la biographie de Daniel de Francheville, cf. Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne. Rennes, 1909, in-4°, t. I, p. 394-396. Cf. aussi Kerviler, Bio-bibliographie bretonne et Dujarric-Descombes, Daniel de Francheville, surnommé le père des pauvres, évêque de Périgueux, dans la Semaine religieuse de Périgueux de 1874, nos 4-10], Daniel de Francheville ne devait garder que peu de temps les fonctions de Président de Vannes. Il lui appartenait à ce titre, plus qu'à tout autre, d'ordonner, au sens ancien du mot, l'accueil de cette ville aux magistrats exilés de Rennes. Qu'il fit montre alors d'une parfaite courtoisie, d'un jugement droit et d'une grande autorité, nous n'en pouvons douter, puisqu'il lui était loisible de céder, après moins de trois ans d'exercice, sa charge de président à son cousin germain, Claude-Vincent Francheville [Note : Elle date de janvier 1678. Cf. minute de Leclerc du 23 janvier 1687], pour devenir, à peine âgé de 30 ans, l'un des magistrats les plus en vue de la province, avocat général au Parlement [Note : M. Frédéric Saulnier, l. c., nos 510 et 916, n'a pas indiqué le prix que François de Montigny vendit la charge à Daniel de Francheville. Celui-ci s'acquitta par quatre versements : de 58.000 livres le 3 juillet 1679 ; de 12.000 le 6 janvier 1680 ; de 9.000 le février 1681 de 11.000 le 5 déc. 1681 ; soit, au total, 90.000 livres. — Archives du Morbihan, B.609] : ses provisions datent du 10 juillet 1678.
Ce n'est pas ici le lieu de tracer la biographie de Daniel de Francheville. Mais on nous permettra, après, avoir rappelé la part qu'il prit à la fondation du Petit- Couvent et ses dons à l'Hôtel-Dieu, de préciser quelques points de sa vie à Vannes laissés obscurs par les historiens qui se sont occupés de lui.
Son père Clàude, le sénéchal, fut inhumé dans la chapelle des Carmes déchaussés où il avait une fondation et un enfeu, par Mgr de la Baume de la Vallière, ancien évêque de Nantes, le 20 février 1682 (Archives de la ville de Vannes, état-civil). Un mois n'est pas encore passé et l'avocat général a reçu, dans la chapelle de l'évêque de Vannes, les quatre ordres mineurs et le sous-diaconat (14 mars), puis, en vertu d'un indult, dès le lendemain, le diaconat, et, après un intervalle de quatre jours seulement, le 19 mars, la prêtrise (Archives du Morbihan, 40 G 4 (303)). On est tout naturellement amené à penser que Daniel n'est pas entré plus tôt dans les ordres seulement par respect pour la volonté de son père, et qu'après la mort de celui-ci il hâta de tout son pouvoir les formalités nécessaires pour obtenir sans retard la prêtrise à laquelle il aspirait depuis longtemps et s'était déjà préparé. D'ailleurs l'évêque de Vannes, Mgr Casset de Vautorte, tint à honneur de choisir, comme Vicaire général, M. l'Avocat général, aussitôt après l'avoir ordonné.
Il savait maintenir ses droits avec une fermeté très digne dans les questions délicates de règlements d'intérêts. Nous pouvons en donner une preuve à propos de la succession de Claude-Vincent de Francheville, son cousin et successeur à la présidence du présidial de Vannes. Claude avait épousé, le 16 août 1683, Anne de Goulaine, veuve de Sébastien de Rosmadec (par contrat reçu Gobé, notaire à Vannes), et mourut sans enfants, à Paris, le 23 mars 1686. Sa mère se présenta comme héritière pure et simple. Mais Claude était fils unique et Daniel, chef de famille, revendiqua l'héritage de son cousin germain. Une transaction dictée, semble-t-il, par lui, fut enregistrée devant notaire, le 23 janvier 1687, « pour sortir définitivement d'affaire et conserver l'union qui a toujours été entre les partis » (Minute de Leclerc, l. c.).
Une autre minute notariale (9 octobre 1686) (Minute de Leclerc, l. c.) nous révèle une forme assez curieuse de sa bienfaisance. « Poussé par des motifs de pure charité et pour lui donner le moyen de subsister dans son négoce et commerce, dans lequel jusqu'ici il n'avait pas eu de succès, mais qu'il espérait à l'avenir faire avec plus de précaution », Daniel de Francheville avança jusqu'à 10.000 livres à Gabriel Regnard, marchand à Muzillac, en prenant d'ailleurs toutes les précautions convenables.
Dans les deux actes que nous venons de citer, Daniel de Francheville se dit domicilié à Château-Gaillard. Il suivit le Parlement revenu à Rennes et occupait, dans cette ville, un appartement au bas des Lices (Archives du Morbihan, B. 609. Inventaire dressé après la mort de l'évêque de Périgueux). Son caractère sacerdotal ne l'empêcha pas, en effet, de continuer à remplir les fonctions d'avocat général [Note : M. Frédéric Saulnier, ne connaissant pas la date de son ordination, commet une erreur quand il écrit : « Lorsqu'étant entré dans les ordres il a cédé son office à son frère », L. c., p. 395]. Daniel agissait ainsi non par gloriole ou par ambition, mais seulement, semble-t-il, par esprit de famille. Il voulait attendre que son frère Pierre fût en âge de lui succéder et lui céda son office en survivance, alors que celui-ci avait à peine 23 ans, le 19 janvier 1691. « Il n'avait pas le temps de service voulu pour réclamer l'honorariat. Sur sa demande, le roi, par lettres du 29 novembre 1690, lui permit de continuer son service, nonobstant sa résignation, pendant huit années, à l'expiration desquelles il aurait tous les droits des conseillers honoraires ». On peut donc croire que Daniel continua de demeurer à Rennes jusqu'à sa nomination à l'évêché de Périgueux (1693), ou même jusqu'à son sacre le 17 janvier 1694. En 1695 l'avocat général « revint prendre place une dernière fois au Parlement de Bretagne où il fut reçu avec l'honneur dû à sa dignité épiscopale » [Note : M. Frédéric Saulnier, L. c., p. 395]. Il mourut à Périgueux, le 26 mai 1702, après avoir mérité le glorieux sur nom de père des pauvres.
Figurons-nous Château-Gaillard, durant cette période, comme l'hôtel servant de rendez-vous habituel à la noblesse, au haut clergé, à tous les honnêtes gens du Vannetais, et même de la province, quand le Parlement se fixe à Vannes. Dans la ruelle et le boudoir de Madame la Présidente, mère de famille modèle, peut-être y a-t-il place à quelques potins mondains, mais on y parle surtout d'éducation, d'oeuvres de piété et de charité. Quant au Président de Vannes ou à l'Avocat général de Bretagne, dans son cabinet ou son appartement de réception, avec son évêque, les chanoines, ses parents, alliés et amis, les magistrats du présidial ou du parlement, il poursuit un sujet habituel d'entretien : la réforme des moeurs et le bien-être social à l'aide de la religion, des retraites, des établissements hospitaliers, de la bienfaisance raisonnée. Cela est vrai surtout pour Pierre de Sérent et Daniel de Francheville plutôt que pour René de Sérent, qui connut la hantise des dettes accumulées, on n'ose dire, par peur de jugement téméraire, la passion du jeu.
NOTE SUR LES PRÉSIDENTS AU PRÉSIDIAL DE VANNES.
Il ne paraîtra pas sans
intérêt de compléter ici la liste des présidents au présidial de Vannes depuis
1582, date où Henri III les rétablit de nouveau après suppression de la charge
[Note : La liste donnée par Rosenzweig dans l'Annuaire du Morbihan de 1860, p. 105 et 106, est tout-à-fait incomplète et fautive
; et il ne pouvait en être autrement alors]. Les dates extrêmes qui suivent chaque nom sont celles où nous les trouvons
avec le titre de président.
Gastechair (François), sr de Kersalio, 1582-1601.
[Note : Ses lettres de provision, du 1er juin
1582, sont publiées par dom Morice, Pr. III, 1.466. Cf. à son sujet
l'information du sénéchal de Rennes contre les ligueurs, 1589, publiée par
Jouon des Longrais dans le Bulletin de la Soc. Arch. et Hist. d'Ille-et-Vilaine, t.
XLI]. — Gastechair (Jean), sr de Toulouard, 26 juillet 1607 (3). — Gastechair
(Jean), sr de Kersalio et de la Porte, 26 septembre 1610 (État-civil de Vannes). — Marin (Jean),
sgr du Bois de Trelan, 13 juillet 1611 (État-civil de Vannes) - 1629 [Note : Le
Mené, Les Carmes
déchaussés de Vannes, 1895]. — Sérent (Pierre de). —
Sérent (René de). — Francheville (Daniel de). — Francheville (Claude-Vincent
de) [Note : Sur ces personnages, cf. le chapitre qui précède]. — Dondel (Pierre), sr de Kerangen. Il acquit la charge du précédent le 1er
janvier 1684 [Note : Acte au rapport de Gobé mentionné dans l'inventaire de
Vincent de Francheville, du 5 juin 1703. Archives du Morbihan, B. 609. — Sur les
deux présidents Dondel, Kerviler commet plusieurs erreurs dans sa
Bio-Bibliographie]. Il acquit moyennant 11.360 livres la charge de second
président créée par édit de février 1705 et l'unit à celle qu'il possédait déjà,
tout en gardant le droit de porter le titre de premier président (Archives du
Morbihan, B 295). — Dondel
(François-Hyacinthe), sgr de Kergonano. On le trouve avec le titre de président
dès le 22 janvier 1708 (État-Civil de Vannes). Le précédent, son père, continuait néanmoins à en
porter lui aussi le titre et peut-être à en remplir les fonctions jusqu'à sa
mort, le 21 décembre 1714 (État-Civil de Vannes). — Sériant (Jacques-Jean-Augustin de), Sgr des
Gravelles. Il reçut ses provisions à la suite de la démission du précédent, par
lettres royales avec dispense d'âge du 12 mai 1734
[Note : Archives du Morbihan, B 349. Cf. de Lantivy, Histoire
généalogique de la famille de Lantivy, l. c., p. 145, n]. — Barie (Simon-Jacques-Joseph de). Il acquit la charge du précédent,
moyennant 86.000 livres, le 18 juin 1756 (Au rapport de Fabre, notaire. Archives
du Morbihan, reg. du contrôle des notaires). — Legros (Charles-François),
sénéchal d'Hennebont, acquit la charge du précédent moyennant 86.000 livres le
11 août 1777 (Fabre, notaire
à Vannes. Archives du Morbihan, contrôle des notaires).
Le sénécbal demeura longtemps distinct du président au présidial. Jean Marin était sénéchal quand il devint président. Pierre Dondel était lui aussi sénéchal quand il acquit la charge de président, mais il n'abandonna pas la première. Depuis lors, les deux charges demeurèrent réunies sur la même tête. Après son acquisition de 1777, Legros, le dernier président, portait les titres de sénéchal au siège présidial et sénéchaussée de Vannes, premier président et second président audit siège, lieutenant-général de police, président ancien et président alternatif et triennal, juge des droits de sortie et d'entrée et autres droits y joints.
V. LE « CABINET DES PÈRES DU DÉSERT ».
Joignant la salle des délibérations de la Société polymathique, au second étage, une petite pièce attire l'attention des visiteurs. Des armoires l'entourent divisées en 57 panneaux de bois peints qui mesurent environ 45 centimètres sur 37. Au-dessus des premières, d'autres armoires sont fermées de panneaux de toiles peintes. Le plafond est boisé. C'est là ce que, par tradition, on appelle le « Cabinet des Pères du désert » ; la tradition encore ajoute qu'il fut installé par le président au Parlement Louis des Dézerts, auquel son nom, donna l'amusante idée d'y faire reproduire la vie des Pères du désert.
De fait, les documents donnent bien à la pièce en question le nom de cabinet usité à l'époque ancienne pour désigner soit un meuble, soit une petite pièce spécialement employée pour classer et conserver les documents. De fait encore, quelques-unes des peintures représentent des ermites orientaux, des « pères du désert ». Quant à Louis des Dézerts, s'il habita Château-Gaillard comme président, ce fût très peu de temps, dans le second quart du XVIème siècle, et certainement l’agencement du cabinet lui est postérieur.
Quelques détails de costume, dans les scènes évangéliques des peintures sur toile, doivent arrêter un instant l'attention et semblent rappeler l'époque Louis XIII. Par ailleurs, ces peintures paraissent sans caractère.
Les panneaux de bois peints méritent un plus long commentaire. C'étaient, à l'origine, des camaïeux. Mais trois ou quatre seulement sont demeurés à l'abri de toute retouche. Il est donc difficile d'apprécier l'artiste qui en est l'auteur, et qui, au point de vue dessin, n'a fuit que copier, comme nous allons voir. Artiste local, peut-être, car il y eut des peintres à Vannes avant que le Parlement de Bretagne, exilé de Rennes, vint s'y installer en 1675. Mais ce pourrait être aussi bien un peintre étranger. Chaque panneau, en effet, indépendant du cadre qui l'entoure, a été fixé dans ce cadre, une fois peint, à l'aide de pointes.
Les panneaux représentent des scènes de la vie de 57 ermites, hommes ou femmes, aussi bien d'Europe que d'Orient et de toutes les époques. Littéralement c'est donc à tort qu'on les appelle « pères du désert ». A vrai dire, la plupart des ermites postérieurs aux pères du désert se sont glorifiés de suivre leurs exemples, et leur popularité se lie étroitement à celle de leurs grands ancêtres.
Popularité extraordinaire, dont nous imaginons difficilement aujourd'hui l'importance, et comme elle se répandit à travers tout l'univers, durant de longs siècles. « Il fut un temps où les noms de ces saints étaient aussi familiers à nos pères que ceux de nos héros nationaux ou contemporains » [Note : Génier cité par A. Lucot, dans son introduction à Palladiu, Histoire Lausiaque dans la collection de Textes et documents pour l'étude historique du christiannisme. Paris, 1912, in-12 p. X]. Son principal organe de diffusion fut l'Histoire Lausiaque de Palladius et Rufin, et la lecture des éditions même expurgées et savantes d'aujourd'hui permet facilement de comprendre comment un curieux mélange de situations bizarres et de pénitences héroïques, exposé naïvement mais avec l'exagération habituelle des Orientaux, réjouissait à la fois l'imagination et la piété de nos pères.
On ne s'étonnera pas, après cela, que l'Histoire Lausiaque ait inspiré, dès une époque fort ancienne, les artistes. Particulièrement célèbres sont les fresques dont Pietro Lorenzetti couvrit une vaste surface du Campo Santo de Pise au XIVème siècle. Il est évidemment impossible de découvrir, dans cette curieuse mosaïque de scènes variées, une relation étroite et directe, à un point de vue quelconque, avec les compositions de Château-Gaillard. Lorenzetti n'a connu que l'Histoire Lausiaque, et pas un, peut-être, des sujets traités par lui ne se retrouve à Château-Gaillard.
En réalité, le peintre de Château-Gaillard reproduit une partie de l'oeuvre de Martin de Vos. Martin de Vos (1531-1603), né à Anvers, se caractérise précisément par une extrême facilité d'invention qui le fit se spécialiser dans l'exécution de petites scènes destinées à être interprétées par les graveurs pour l'illustration des ouvrages de piété. Il apparait probable, d'ailleurs, que Martin de Vos, qui séjourna en Italie, eut connaissance des fresques du Campo Santo, et fort posible qu'il s'en inspira. Mais ses compositions s'appliquent à une foule d'ermites que n'a pas connus Lorenzetti et, pour ceux qu'il a connus, Martin de Vos est loin d'avoir copié servilement son devancier.
A Château-Gaillard il y a eu simple transposition, non pas, à coup sûr, directement sur l'oeuvre de Martin de Vos, mais par l'intermédiaire de plusieurs suites de graveurs. Parmi les 57 personnages mis en scène, 7 seulement ne peuvent plus être identifiés en raison du mauvais état de la peinture. Des 50 autres, 49 se retrouvent çà et là dans cinq suites de gravures. Les Monumenta sanctioris philosophiæ quam severa anachoretarum disciplina vitæ et religio docuit, Martin de Vos fig., Joannes et Raphaël Sadeler sculp., Monachiæ, 1594, en ont fourni huit [Note : Benedictus, Ephrem, Meinardus, Arsenius, Epiphanius, Onofrius, Bruno, jacobe]. Il y en a neuf dans le Trophoeum vitæ solitariæ, Martin de Vos fig., Joannes et Raphaël Sadeler sculp., Venetiis, 1598 [Note : Paulus, Henricus, Antiochus, Svatacopius, Paternus, Theodorus, Simeon, Palamon et Pachrome, Josaphat]. L'Oraculumn anachoreticum, 1600, Martin de Vos fig., Johannes Sadeler sculp., Venetiis, en donne dix [Note : Valmarus, Venerius, Romualdus et Marinus, Symnachus, Beatus, Ephaestius, Dorothée, Robertus, Possidonius, Nathanaël]. Il s'en trouve neuf dans la Solitudo sive vitæ patrum eremicolarum, Martin de Vos fig., Johannes et Raphaël Sadeler sculp., s. l. n. d. [Note : Hilarion, Piamon, Didymus, Abraham, Helenus, Malchus, Paphnutius, Mutius, Spiridionis]. Enfin la Solitudo sive vitæ fæminarum anachoretarum ab Adriano Collardo [Note : Collaërt vivait à la fin du XVIème siècle] collectæ atque expressæ [d'après Martin de Vos], en comprend treize [Note : Saba, Sanctimoniales Hierosolymitanæ, Sara, Pelagia Antiochena, Thaïs meretrix, Amata, Otilia Bavera, Nephalia Gnossia, Sylvia Ruffina, Sophrona Tarentina, Cometa et Micosa, Erena, Maria Egyptia]. Un seul des 50 noms de Château-Gaillard ne se trouve pas dans les cinq suites que nous venons d'énumérer, celui d'Asilius.

Le fait que les mêmes personnages se retrouvent d'une part à Château-Gaillard, d'autre part dans cinq suites de gravures, ne suffit pas à prouver que Château-Gaillard reproduit les gravures qui les concernent. Il faudrait, si l'on voulait arriver à une preuve absolue, constater l'identité de chacun des panneaux de Château-Gaillard avec la gravure relative au même personnage dans les suites. Noue avons pu faire cette comparaison pour 14 des panneaux, grâce aux gravures provenant de la collection Touzée de Grand'Isle, acquise par M. Léon Lallement, et qu'il nous a aimablement communiquées, après avoir, le premier, établi la similitude de leur dessin avec celui des camaïeux de Château-Gaillard. Nous avons pu le faire en outre pour deux autres panneaux, à l'aide de gravures récemment acquises à Vannes par M. Yves Le Diberder. Et cela nous parait suffire pour conclure que les panneaux de Château-Gaillard reproduisent l’œuvre de Martin de Vos d'après des gravures, vraisemblablement celles des suites des frères Sadeler et d'Adrien Collaërt [Note : Soit des éditions citées plus haut et qui doivent être les premières, soit d'éditions postérieures, ce qui expliquerait l'addition d'Asilius].
La réputation des Sadler était d'ailleurs fort grande. Jean Sadler, flamand d'origine, mourut à Venise en 1600, après avoir séjourné à la cour de Bavière durant quelques années.
N'est-ce pas lui qui aurait signalé à de Vos Ottilia, Bavara, une des héroïnes de la Solitudo ferminarum, et certains des anachorètes des Manumenta imprimés, on s'en souvient, à Munich ? Raphaël Sadler, né à Bruxelles, fut l'élève de son frère aîné et s'associa à sa fortune. Amateur éclairé, Touzée de Grand'Isle, recteur de Sarzeau, où il fréquentait les Sérent et les Francheville, apprécie ainsi l’œuvre de l'un d'eux dans son catalogue [Note : Il s’agit plus spécialement de la Collection des vestiges des antiquités de Rome, Tivoli, etc., gravée à Prague par Gilles Sadeler en 1606. Communiqué par M. Léon Lallement qui possède une partie de la collection formée par Touzée de Grand'Isle]. « Les gravures sont d'un goût, dessin et burin délicat. Cette collection seule s'est vendue jusqu'à 6 louis d'or Il n'est point d'amateur qui ne l'ait dans son portefeuille ou ne se la procure à quelque prix que ce soit. Le nom du graveur seul fait son éloge... ».
Quand Touzé Grand'Isle parlait de la sorte, le cabinet de Château-Gaillard et ses peintures existaient depuis fort longtemps. Nous croyons qu'on doit en faire remonter l'organisation et la composition à Pierre de Sérent, Président de Vannes.
Le cabinet existait certainement du temps de Daniel de Francheville. Il se l'était pour ainsi dire réservé après sa nomination à l'évêché de Périgueux. Dans les armoires on inventoria après sa mort « 225 volumes tant grands que petits reliés en parchemin et en veau » et des papiers : titres des terres de la famille situées « en l'isle de Rhuys », actes « au soutien de la noblesse » de MM. de Francheville. Le mobilier appartenait aussi à l'évêque de Périgueux, très simple : « mirouer dont la glasse est cassée », table garnie d'un tapis vert à cinq tirettes, fauteuil couvert de cuir, petit coffre dans lequel se trouvent 6 assiettes « de ver », un « coutouer » (1702-1703) (Archives du Morbihan, B. 609). Un portrait de l'évêque, qu'il avait donné à son frère Gervais, achevait de rattacher à cette pièce, d'une façon toute particulière, le souvenir du chef de famille.
Mais s'il se servit du cabinet des Pères du désert, s'il se le réserva plus spécialement après, avoir quitté Château-Gaillard, Daniel, de Francheville, croyons-nous, ne l'aménagea ni ne commanda les peintures qui le décorent. S'il logea à Château-Gaillard de 1675 à 1690, rien n'indique qu'il en fut à aucun moment propriétaire [Note : Claude, son père, était encore propriétaire en 1680, et Gervais, son frère, l'était devenu bien avant la mort de Daniel] ; on peut même tenir pour certain qu'il ne le fut pas du vivant de son père. Aurait-il entrepris, après la mort de celui-ci, des travaux pour ainsi dire de luxe, au moment même où il recevait les ordres sacrés, ayant dès lors bien évidemment la certitude qu'il ne garderait pas pour lui l'usage du grand hôtel de famille ?
Il convient, d'ailleurs, de ne pas se borner à ces considérations étroites, et d'envisager la chose d'un point de vue plus large. La vie des Pères du désert continua, de demeurer populaire après le moyen âge. Dans le curieux roman de Mme de Beaumont déjà cité, la baronne, décrivant son apostolat parmi les paysans, explique : « Quand nous allons à la veillée, on leur raconte quelques histoires à leur portée. Il y a quelques paysans de bon sens, et d'un certain âge, qui savent, lire, et auxquels on a donné la vie des saints, celle des Pères des déserts, et autres semblables ». Le roman date de 1768 et son témoignage ne vaut pas, évidemment, pour les paysans, mais pour l'intellectuelle qui, en est l'auteur ; il marque surtout un espoir théorique.
Mais au moment de ce qu'on appelle la contre-réforme, à la fin du XVIème et au commencement du XVIIème siècle, le magnifique mouvement qui entraîna peu à peu tous les milieux de la société à pratiquer une vie, plus chrétienne, plus conforme à l'Evangile, en un mot à se convertir, devait donner un regain de popularité tout particulier à la vie des pères du désert, des ermites hommes et femmes qui aspiraient à la perfection. Les peintures de Martin de Vos, les gravures des Sadeler et de Collaërt, qui eurent plus d'une édition, en témoignent. De tous côtés, en France, vers cette époque surgissent des ermites et des ermitages [Note : Maurice Pouliot, Les origines de l'Hermitage des Arcs de Parigny, Poitiers (1920)]. En ce qui concerne plus spécialement le diocèse de Vannes, à quel moment y eut-il davantage de fondations de couvents, d'ordinations de religieux que sous l'épiscopat de Sébastien de Rosmadec (1622-1646) ? Au synode qu'il présida en octobre 1635, nous relevons cette mention particulièrement significative : « Défense aux recteurs de recommander les ermites au préjudice des Cordeliers de Vannes » [Note : Archives du Morbihan, G 301. Cette défense fut sans doute édictée à la requête des Cordeliers. De quels ermites s'agissait-il ? Peut-être des Camaldules qui devaient s'installer quelque temps après dans le diocèse ; mais peut-être aussi des ermites, au sens courant du mot].
La vogue des fidèles pour les ermites devait entraîner l'abus et l'entraîna de fait. Il advint, avec le temps, que des ermites fort peu recommandables abusèrent de la crédulité publique. Mgr Casset de Vautorte dut dégager sa responsabilité vis-à-vis des pouvoirs judiciaires par l'attestation suivante. « Nous, évesque de Vennes, certifions que les particuliers se disant hermites qui habitent la maison ordinairement appelée l'Hermitage, proche cette ville, si sont establis sans notre consentement, qu'ils n'ont faits aucun vœu ny profession légitime à nostre cognoissance, que nous avons mesme esté informé qu'ilz y mènent une vie oizeuse, libertine et toute contraire à l'habit qu'ils portent indeubment, que, bien loin d'approuver leur establissement, tout au contraire nous souhaitons qu'ils quitent et se retirent ailleurs, comme gens inutiles, sans profession aprouvé, et estans à la charge du public, laquelle atestation nous avons délivré à M. le Procureur du Roy pour s'en servir vers lesd. prétendus hermites comme il verra l'avoir à faire, en foy de quoy avons signé la presente de nostre main. A Vennes, ce 8 de décembre 1678 » (Archives du Morbihan, B. 678).
Les « prétendus hermites » s'étaient donc installés à l'Hermitage au moment où Daniel de Francheville entrait à Château-Gaillard, peut-être même auparavant. Daniel de Francheville, homme de sens droit, n'a certainement pas voulu faire concorder avec ce scandale la louange en quelque sorte publique, dans son cabinet, de certains ermites dont la vie fut, à tout le moins, bizarre. Peut-on admettre, en outre, puisqu'il y eut choix entre nombreux sujets analogues, que Daniel, non marié, ait fait porter le sien sur an si grand nombre de femmes ?
Les camaïeux du cabinet de Château-Gaillard sont donc antérieurs à Daniel de Francheville. Nous les attribuons à Pierre de Sérent. Grande fortune, haute situation, piété profonde de la famille, style de la pièce où ils se trouvent, tout s'accorde à le démontrer en même temps que l'ambiance : état d'esprit des contemporains et plus spécialement, sans doute, du diocèse et du milieu [Note : Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle les ermites disparaissent à Poitiers. « Le catholicisme s'est fait plus discipliné, plus hiérarchisé ; l'individualisme y a de moins en moins part ». Pouliot, l. c.].
Essayons maintenant de résumer quelle valeur représentent ces peintures. Le père du Président de Vannes, entré dans les ordres tout de suite après son veuvage, vient donner devant elles, avec ses conseils, l'exemple de sa vie. La bure de carme du père Mathias rend plus saisissantes les explications qu'il en donne à ses neveux et nièces, tout en les mélangeant de belles histoires sur les prodiges de sainte Anne au Bocenno. Gillonne Mancel les utilise pour inculquer à ses nombreux enfants cet amour de Dieu qui fera choisir à la plupart la voie du sacrifice. L'évêque Sébastien de Rosmadec se sent, pour ainsi dire, soutenu par elles, quand il vient entretenir le premier magistrat de la ville et collaborer en quelque sorte avec lui. Daniel de Francheville, comblé tout jeune des honneurs du monde, les trouve aussitôt sous ses yeux, à chaque instant de liberté, lui rappelant jusqu'où d'autres ont poussé le mépris des vanités ; et quand il fut devenu prêtre, les saints ermites, ses conseillers, devinrent aussi témoins discrets de ses nombreuses charités. En vérité ces toiles délavées, ces camaïeux où abondent les repeints, offrent peut-être à l'artiste un bien mince intérêt. Mais quelle richesse de souvenirs ils représentent pour ceux qui aiment à les évoquer !
VI. L'HÔTEL PARTICULIER AU XVIIIÈME SIÈCLE.
Daniel de Francbeville, avocat général, demeurait, nous l'avons dit, à Château-Gaillard, tant que le Parlement tint ses assises à Vannes, mais il ne fit pas entrer cet immeuble dans la part qui lui revint dans la succession de son père, ou il s'en dessaisit au profit de son frère Gervais, comte de Francheville, capitaine de chevau-légers, vert le temps où celui-ci épousa Marie-Anne-Thérèse du Breil de Pontbriand, fille unique de Louis et de Françoise Huchet de la Bédoyère (11 février 1687) (Archives de la ville de Vannes, état-civil), dans l'église des Cordeliers de Vannes. Si proche de Château-Gaillard et de l'ancien hotel de Francheville sur les Lisses, celle-ci devait être peuplée des souvenirs de la famille. Le mariage Francheville-La Bédoyère fut à coup sûr une cérémonie particulièrement brillante, et les salles de Château-Gaillard durent voir défiler, à cette occasion, toute une cohorte faite de noblesse, de dignité et d'élégance.
Quand mourut l'évêque de Périgueux, Gervais, conjointement avec Pierre-Marie, l'avocat général, fit dresser l'inventaire des papiers et du mobilier que leur frère avait laissés tant à Château-Gaillard qu'à Rennes (1702) (Archives du Morbihan, B. 609). Gervais de Francheville, seigneur dudit lieu, de Truscat, la Motte-Olivet, Bois-Ruffier, la Cour et autres lieux, à cette époque demeure ordinairement à Vannes, « en son Château-Gaillard » ; il acquit, dans la suite, la charge de lieutenant des maréchaux de France. Nous supposons qu'on doit lui attribuer l'aménagement, à l'époque de son mariage, de la chambre où se trouve actuellement le musée néolithique, au premier étage. Avant les réparations, une partie du très beau plancher à compartiments était surélevée d'un degré qui marquait, avec la guirlande d'amours et de fleurs encore aujourd'hui sculptée au plafond, l'emplacement du grand lit debout et de ses ruelles séparés du reste de la pièce par des balustres.
Gervais mourut le 6 janvier 1710. Tant que vécut sa veuve, qui avait alors 45 ans, Château-Gaillard demeura indivis entre les sept enfants qu'il laissait vivants ou entre leur descendance. C'est dans la chambre d'apparat du premier étage que naquirent au moins six des neuf enfants que nous lui connaissons.
Le premier, Jean-Baptiste-Joseph, eut pour parrain et marraine, le 16 janvier 1689, deux pauvres gens qui ne nuirent pas à son avenir, puisqu'il devint avocat général à la suite de son oncle Pierre, et président à mortier du parlement de Bretagne. Il était seigneur de Truscat et de la Motte-Olivet, se maria trois fois, mais n'eut d'enfants que de sa première femme, Françoise-Scholastique de Kéraly (Saulnier, l. c. n° 512). — Perrine-Anne-Marie-Renée (15 mai 1690), mourut jeune. — Charles-Jacques, sr. de Treslan, épousa Jeanne-Marguerite du Bois de la Salle (1727). — Pierre, filleul de l'avocat général et de Madame du Plessis de Grénédan (25 otobre 1694), ne survécut pas à son père. — Jean-Baptiste-François devint lieutenant du roi à Vannes avec le titre de la Motte-Francheville ; il épousa Vincente-Thérèse Marvin. — Louis-Jules-Hercule de Lescouët décéda sans enfants en 1740. — Aimé-Gervais (3 août 1697), connu sous le nom de Pleslin, lieuteant des maréchaux de France après son père, épousa Marie-Anne-Thérèse de Lantivy le 4 janvier 1746. — Toussaint de Pelinec laissa trois enfants de son mariage avec Yvonne Kermasson de Bourgerel. — Joachim-Gervais entra chez les Trinitaires qui avaient un couvent à Sarzeau [Note : Kerviler, Bio-bibliographie bretonne ; état-civil de Vannes et de Sarzeau ; Archives de la Loire-Inférieure, B. 2.337, et du Morbihan, B. 692].
Le seigneur de Truscat, l'aîné, fit aveu au roi pour Château-Gaillard le 26 septembre 1710, tout de suite après la mort de son père ; il y avait alors dans la cour écurie et remise de carrosse. En 1712, la comtesse de Francheville, veuve de Gervais, loue le rez-de-chaussée et le premier étage de son hotel à M. du Bodory et, le 18 septembre, on dresse le procès-verbal des réparations à faire. Le jardin « frost » est séparé des Cordeliers par un mur et par une balustrade qui le remplace là où il s'est écroulé (Archives du Morbihan, B. 697).
Si Jean-Baptiste de Francheville fit acte de présence à Château-Gaillard, ce fût bien temporairement, et dans les appartements de sa mère. Cependant il poursuivit un procès contre le tuteur des enfants de M. Botherel de Quintin, sr. de Saint-Denat, qui avait, disait-il, empiété sur ses droits, en bâtissant une écurie et un grenier contre les murs de Château-Gaillard. Le grenier s'élevait jusqu'aux fenêtres du premier étage de Château-Gaillard, dont les habitants ne se trouvaient plus en sûreté (1726-1731) (Archives du Morbihan, B. 1.141 et 1.731).
La comtesse douairière de Francheville vivait toujours. Nous supposons qu'elle occupait le rez-de-chaussée et le premier, laissant le second à son plus jeune fils. Aimé Gervais, seigneur de Pleslin, faisait en effet sa résidence, au moins sur la fin de sa vie, tantôt au château du Bois de la Salle, presqu'île de Rhuys, tantôt au second étage de Château-Gaillard. Un inventaire du mobilier de la communauté, dressé après sa mort, les 23 et 24 décembre 1746, nous fait connaître la garde-robe que la comtesse sa femme et lui-même possédaient à Château-Gaillard : « une robbe de satin blanc avec sa juppe pareille, et la doublure de taffetas rayé, prisée 40 livres ; une robbe de gros de tour citron à fleurs avec un juppon de taffetas blanc, doublure de taffetas, prisée 40 livres ; une robbe de satin brochée, avec sa doublure de taffetas, prisés 18 livres ; une robe de canadary avec son jupon, prisés 7 livres ; une robe de cithresaye, prisée 7 livres ; une robbe de toille peinte, avec son juppon, prisée 6 livres ; un habit, veste et culotte de drap d'Espagne, prisé 30 l. ; une veste de satin blanc galonnée d'or, prisée 45 l. ; une redingonde de pluche en forme de robbe de chambre, prisée 8 l., etc. ». « Un dossier, un plaffon, les bonnes grâces, les pentes du dehors et du dedans, partie de ras de Saint-Maur, fond vert et satin même couleur, le tout à bouquets détachés », ainsi que quatorze « couessins raiz de Saint-Maur à bouquets à fleurs », et six autres de « damas verd », ornaient l'appartement (Archives du Morbihan, B. 679).
Le 23 février 1755 la comtesse douairière de Francheville s'éteignait à 90 ans, dans son hôtel de Château-Gaillard, pensons-nous. Elle avait vu disparaître successivement cinq des fils qui avaient survécu à leur père : en 1731, M. de Treslan ; en 1735, M. de la Motte ; en 1740, M. de Lescouët ; en 1745, M. de Pélinec ; en 1746, M. de Pleslin ; rentrer aux Trinitaires le sixième. L'aîné, ancien président au parlement, demeurait seul pour lui fermer les yeux. Mais il ne lui survécut que peu de jours, et mourut à Paris, le 29 avril 1755, en partie de chagrin, peut-être. Son fils unique, Pierre-Joseph, à qui il avait transmis sa charge de président, le chef de nom et d'armes de la famille, qui devait particulièrement soutenir son passé d'honneur, ne tardait pas, en effet, à être frappé d'interdiction par le présidial de Rennes, qui lui donnait comme curatrice, par sentence du 13 septembre 1756, sa soeur Marie-Anne-Thérèse, et disparaissait à son tour, neuf jours plus tard (22 septembre), sans enfants (Saulnier, l. c., n° 513).
Marie-Anne n'avait qu'une soeur plus jeune qu'elle, la comtesse de Trécesson. Elle se trouvait donc « héritière principale et noble » représentant les droits de son frère et de son père, lui-même « fils aîné, héritier principal et noble » du comte Gervais et de sa femme, dont la succession n'était pas encore liquidée au bout de 46 ans. Marie-Anne, chef de famille, se préoccupa, sans tarder, de régler les droits de chacun. Nous la voyons, à propos de Château-Gaillard, transiger le 25 avril 1757 avec Daniel Botherel de Quintin, sr. de Saint-Denat. Ce voisin, dont la famille n'avait cessé d'avoir des difficultés avec les Francheville, construisait un nouveau bâtiment au nord de Château-Gaillard. Il prit l'engagement de ne pas l'élever de plus de 12 pieds pour ne pas fermer d'autre vue que celle des latrines. Marie-Anne descendit momentanément à Château-Gaillard à cette occasion (Jarno, notaire à Vannes. Archives du Morbihan, reg. du contrôle), mais l'hôtel demeurait inhabité depuis la mort de la comtesse douairière (Déclaration du 13 août 1757. Archives de la Loire-Inférieure, B. 2.337).
L'accord sur le partage des biens ne put se faire entre les nombreux héritiers Francheville, comme il était à prévoir. Il fut réglé par sentence du présidial de Vannes, du 30 juillet 1757, qui en ordonnait le « grand, mesurage et prisage ». On y trouve une description détaillée de l'aménagement de Château-Gaillard correspondant avec certains détails donnés antérieurement par les déclarations ou le renable de 1712.
Les trois priseurs nobles et l'arpenteur nommés d'office reconnaissent les deux grands corps de logis « s'entre-atenants et à l'attache l'un de l'autre », le second au nord du premier et « en fausse écaire » ; et, à l'ouest de celui-ci, un autre petit bâtiment « de pareille construction et couverture », mais de moindre élévation.
Au rez-de-chaussée, joignant le grand escalier, est un cabinet où se trouvent « les lieux d'embas » (Expression du renable de 1712), puis deux salles de même forme et dimension, avec grandes cheminées, parquetées « à la capucine », celle du midi munie d'une fenêtre « à vue morte garnie de verres en plomb ». Au bas du petit escalier la cuisine, avec cheminée, fourneaux et tables d'attache, contient un puits ; une décharge la prolonge à l'ouest. Toutes ces pièces se communiquent entre elles et avec un « vestibule de transport » qui part de la porte d'entrée sur la cour. Sous le rez-de-chaussée, deux caves, celle du côté du jardin voûtée.
Au premier étage s'ouvre sur le palier du grand escalier une grande chambre pavée de terre cuite avec cheminée surmontée d'une peinture à fresque : elle est éclairée par deux grandes croisées « garnies de verres en petits bois, couvertes de volets de bois en panneaux ». Autre « belle et grande chambre », au nord de la précédente, dont le plancher inférieur est parqueté et le supérieur lambrissé d'une boiserie à compartimenta « de mesme que la cheminée et rois côtés de lad chambre ». Troisième chambre communiquant avec la précédente, lambrissée « à la capucine » en entier « fors une petite partie qui est l'emplacement du lit » et suivie, à l'ouest, d'une « petite chambre ou cabinet » pavée de terre cuite.
Au second étage, trois chambres pavées de terre cuite. Le troisième comprend quatre petites chambres pavées de terre cuite et « lambrissées de terrasse », couvertes d'un grenier servant à mettre du bois de fagot et du charbon.
« Au-dessus du grand escalier est une petite chambre en dongeon faisant la superficie, de la tour, ladite chambre lambrissée à la capucine ayant un plat fond de menuiserie avec une corniche qui reigne autour ». Le soin apporté à lambrisser cette charmante petite pièce indique assez que les habitants du Château-Gaillard l'utilisaient comme boudoir pour aller y lire, rêver ou méditer dans le calme, et jouir d'une vue superbe sur la ville, qu'ils dominaient entièrement, et au loin, sur le golfe et la mer. Malheureusement les récentes réparations ont supprimé les fenêtres et transformé le boudoir en un sombre grenier.
Dans la partie ouest de la cour se trouvait « une écurie avec ses créneaux et râteliers doublée d'un plancher pour servir de fannerie » et « une remise close par devant en partie de douves de barriques attachées avec des cloux ». Le jardin, planté d'arbres fruitiers, était borné, du côté des Cordeliers, par un mur à hauteur d'appui, et comprenait, au midi, un petit bâtiment de bois et « terrasse » mesurant 27 pieds en longueur, destiné à « servir d'orangerie et de serre » (Archives du Morbihan, B. 692) .
Anne-Marie n'avait pas attendu ce « grand » pour faire la déclaration de Château-Gaillard encore indivis, et payer l'impôt de transmission de ce fief noble, le rachat, qui s'élevait à 144 l. 8 s. 11 d., alors que l'immeuble était estimé valoir 100 livres de rente (13 août 1753) (Archives de la Loire-Inférieure, B. 2.337).
Moins d'un an après (30 juin 1758), elle vendait l'hôtel à Eléonore-Julie de Guémadeuc, épouse de Charles-Louis-René de Marbeuf, moyennant 6.500 l. (Launay, notaire à Vannes. Reg. du contrôle). M. de Marbeuf n'avait pas à donner son autorisation à sa femme. Leur contrat de mariage, du 29 mai 1752, stipulait expressément qu'il n'y aurait point de communauté entre les futurs époux. L'époux, qui n'avait aucune fortune, devait suivre l'épouse « dans tous les lieux où il plairait à celle-ci de fixer son habitation », sans qu'elle fût obligée à lui « tenir maison » ailleurs que là où elle se trouverait. Bien mieux, tous deux « convenaient que, si leurs humeurs ne sympathisaient pas, et s'ils ne pouvaient vivre ensemble, ils se sépareraient d'habitation à la première réquisition l'un de l'autre » (Ce curieux contrat nous a été aimablement communiqué par M. de Lignières).
Les clauses de son contrat aidèrent-elles M. de Marbeuf à conquérir la Corse ? Peut-être bien. Mais nous avons le regret de constater qu'il ne demeura jamais à Château-Gaillard quelle que fût la qualité de l'humeur de sa femme en 1758. L'hôtel acquis par un Francheville en 1675 et habité sans cesse depuis lors par la famille de Francheville, de telle sorte qu'on le connaissait aussi bien sous le nom d'hôtel de Francheville que de Château-Gaillard, passa alors, nous ne savons par suite de quels arrangements, entre les mains de Yvonne Kermasson, veuve de Toussaint de Franchville, seigneur de Pélinec, et non pas entre celles de Madame de Marbeuf [Note : Celle-ci alla habiter place des Lices, où son mobilier fut vendu, aussitôt après son décès, sur l'ordre de son mari, en juin 1783. Archives du Morbihan B. 752. — Nous ne retrouvons aucune trace de Marbeuf à Vannes, sinon la présence dans cette ville, le 7 août 1759, d'un capitaine du régiment des dragons portant son nom. Mutaud, notaire à Vannes. Reg. du contrôle].
Elle le revendit peu de temps après à Luc-Julien Le Sénéchal de Kerguizec, lieutenant des maréchaux de France, demeurant en son château de Kerguizec, en Surzur, moyennant 6.000 livres (14 avril 1762) (Satre, notaire à Vannes. Reg. du contrôle). Le nouveau propriétaire décédait presque aussitôt, et son fils, Pierre-Marie, lieutenant des maréchaux de France à la suite de son père, se dessaisissait sans tarder de Château-Gaillard au profit de Louis-Jean-Charles Fournier, seigneur de Trélo, Saint-Maur et autres lieux, et de Marie-Catherine Besson de la Vieuville, sa femme, pour 7.500 livres (1er février 1764) (Mutaud, notaire à Vannes. Reg. du contrôle). Les Fournier demeurèrent sans doute quelque temps à Château-Gaillard, mais il arriva un moment où, résidant à leur château de Renac, ils louèrent l'hôtel à Françoise le Roux, veuve de Sébastien-Marie le Hénauff de Kerpars, pour ensuite le lui cédér au prix de 6.250 livres (13 janvier 1779) [Note : Le Ridant, notaire à Vannes. Reg. du contrôle — Nous devons remercier M. Fanneau de Lahorie, juge à Nantes, d'avoir bien voulu nous communiquer les notes recueillies par son grand-père, M. Fouquet, qui nous ont permis de trouver les actes établissant la suite des propriétaires de Château-Gaillard dans la seconde moitié du XVIIIème siècle].
VII. CHATEAU-GAILLARD AU XIXÈME SIÈCLE GEANNO, SA PENSION, SES AMIS. [Note : Sources et bibliographie. Archives du Morbihan, série E, fonds Geanno, en particulier correspondance de le Priol ; fonds Monnier. — A. F. Rio, La petite Chouannerie. Paris, 1881, in-12. — Rio, Epilogue à l'art chrétien. Paris, 1872, in-8°. — Jules Simon, Premières années. — Bainvel, Souvenirs d’un écolier en 1815. Paris, 1874, in-12. — Dr Mauricet, Le collège de Vannes, dans Revue de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, 1889. — J. Allanic, Histoire du collége de Vannes. Rennes, 1902, in-8°. — Mauricet, Le collège de Vannes en 1812. Souvenirs d’un vieux collégien, dans Bulletin de la Sociéte Polymathique, 1876, p. 42 et s.].
Durant la période révolutionnaire Château-Gaillard demeura la propriété de Madame le Hénauff de Kerpars qui le vendit, le 7 frimaire an IX (Jollivet, notaire), à Jean-Louis Geanno.
Né à Vannes le 24 mai 1765, Geanno suivi les cours du collège de Vannes. Avant même d'avoir terminé ses études, étant encore élève de troisième, il se fit répétiteur pour ne pas demeurer en charge à sa nombreuse famille, et ne cesse ensuite de lui venir en aide. Devenu professeur de cette même classe de troisième, le 15 juillet 1787, il refusa en 1791 de prêter le serment à la constitution civile du clergé qu'on demandait aux professeurs aussi bien, qu'aux prêtres, fut par suite renvoyé du collège et même emprisonné pendant six mois. Réfugié à la Roche-Bernard chez M. Lévesque, dont il instruisait les enfants, les soupçons sinon les persécutions des terroristes l'y poursuivirent, tandis que son frère, élevé grâce à ses soins, trouvait la mort à Quiberon dans les rangs des royalistes. C'est sans doute pour y échapper qu'il obtint d'être nommé instituteur sur un navire de la marine de guerre, la Bellone. Nous le retrouvons ensuite à Vannes, fondant et dirigeant le seul établissement où fussent enseignées les études secondaires. Nommé « professeur de langues anciennes » à l'École Centrale le 29 ventôse an VII, il acquérait Château-Gaillard deux ans aux plus tard environ. Par arrêté des consuls du 30 vendémiaire an XI, la maison d'éducation qu’il y dirigeait, tout en remplissant ses fonctions de professeur à l'École Centrale, fut déclarée officiellement École secondaire. L'École Centrale ayant été supprimée le premier messidor an XI, Geanno, « à la demande pressante des autorités locales, et pour obvier à l'interruption des études publiques », continua à professer gratuitement au Collège de la ville, où l’année scolaire se termina, comme à l'habitude, par des exercices publiés. Quand s'ouvrit l'École secondaire Communale de Vannes, dans les bâtiments de l'ancien Collège, le 19 vendémiaire an XII, Geanno y remplit les fonctions de professeur de rhétorique et d'humanités. Il en devint directeur le 3 octobre 1804, sans abandonner, tout d'abord, son école secondaire particulière, continua sa direction quand l'Université transforma l'École Communale en collège de plein exercice (1808), et fut nommé principal, en 1810. En 1820 Geanno s'aperçut qu'il était pénibre de donner 10 classes par semaine aux rhétoriciens tout en administrant le collège ; il se préoccupa d'être d'échargé de sa classe. Après 35 ans de services, en 1825 son ambition visait à obtenir une retraite représentant le 20ème de son traitement de 1.500 francs et de la jouissance d'un logement avec jardin, soit une pension de 1.402 francs. Conseiller municipal de la ville de Vannes sous la Restauration, il cessa d'être principal seulement après la révolution de juillet, le 16 octobre 1830, et mourut à Château-Gaillard le 15 juillet 1840, à 75 ans.
Deux de ses anciens élèves devenus célèbres ont fait un sort à Geanno dans leurs mémoires. A vrai dire, les Premières années de Jules Simon apparaissent, en plus d'un passage, l'amusement sentimental d'un charmant écrivain, mais aussi d'un brillant mystificateur. Quant à Rio, il a montré dans La petite chouannerie et l'Épilogue à l'art chrétien, vis-à-vis de son principal, un parti-pris passionné où se sent toute l'âpreté par quoi se distinguent, de loin en loin, certains enfants de de l’île d’Arz.
Pour Rio, Geanno représente le fonctionnaire, prêt aux volte-face à chaque changement de régime, s'empressant aux courbettes devant tout nouveau pouvoir, et cela dans un but intéressé, afin de garder sa place et d'arrondir sa fortune. Cependant Geanno, rendant le bien pour le mal, était venu en aide à Rio, moralement et matériellement, dans des circonstances particulièrement critiques de sa jeunesse. Il n'avait pas mesuré suffisamment l'amour-propre maladif du future éçrivain qui ne lui pardonna jamais ses bienfaits. En réalité Rio travestit les actions et le caractère de son ancien maître ; son témoignage ne présente aucune valeur [Note : Ce n'est pas ici le lieu de fournir la preuve de ce que nous avançon].
Jules Simon n'affiche pas beaucoup plus de respect que Rio pour Geanno, mais sur le ton du doux persiflage. « M. Geanno, moitié laïque et moitié prêtre, une sorte de prélat laïque, que je vois encore avec ses souliers à boucles d'argent, ses bas de laine noire à côtes, ses culottes et son gilet de satin noir, et sa redingote tabac d'Espagne qui lui battait les talons. Mettez là-dessus une toute petite tête, avec des cheveux tout blancs, et des yeux perçants comme des vrilles. Il ouvrait toms les offices en disant le Veni, sancte Spiritus, agenouillé au bas de l'autel, ayant le célébrant à sa droite.
Il avait un répertoire d'une vingtaine d'anecdotes qu'il nous contait perpétuellement en éclatant de rire, que nous savions par cœur, et qui nous rendaient parfaitement heureux, chaque fois qu'il nous faisait l'honneur de les répéter. Il n'était pas dans les ordres ; il n'était pas marié non plus, et n'aurait pas vécu autrement, quand même il aurait été moine. Il portait toujours la même perruque, demeurait dans la même maison, il sortait aux mêmes heures pour aller au collège, emportant le même portefeuille et probablement le même exemplaire de Virgile. Je regrette d'être oblige d'avouer qu'il nous lisait quelquefois de beaux passages du Génie du Christianisme ».
Inutile, après cela, de rappeler avec quelle fantaisie ont été écrites Premières années : ce livre fourmille d'erreurs matérielles voulues. Ce qu'il dit de Geanno, du collège et de ses élèves n'en présente pas moins une grande valeur documentaire quand on l'oppose aux souvenirs de l'Épilogue et de la Petite Chouannerie.
Simon et Rio, hommes arrivés, et peut-être se croyant déjà grands hommes, entendent bien ne devoir rien ou presque rien de ce qu'ils sont à leurs premiers éducateurs. « Comme instruction, le collège faisait de nous des latinistes ignorants de toutes choses, excepté du latin », dit Jules Simon qui fut reçu à Normale supérieure un an après sa sortie du collège, et il explique : « On m'aura tenu compte de ce que je venais de loin. J'avais fait mes études 150 ans avant mes camarades » de Normale.
Mais Simon plein de sarcasme, et Rio, de toute sa passion, tiennent les deux côtés de la barricade. Pour le premier, Geanno c'est l'égal ou presque d'un ecclésiastique ; pour l'autre, un plat fonctionnaire.
Avec quel dédain Simon ne parle-t-il pas de ses condisciples se préparant à la prêtrise : « Un écolier à 25 ans était moins rare qu'un écolier de 15 ans. Ces jeunes gens avaient été d'abord garçons de charrue. Leur curé les avait dégrossis, et quand ils avaient su lire et répondre une messe, l'ambition de porter la soutane leur était venue, et ils étaient entrés au collège de Vannes... Tout cela vivait dans la joie et dans la misère. On n'allait pas jusqu'à mendiera, mais on se livrait à toute sortes de métiers... Quand ils arrivaient en rhétorique, l’évêque donnait aux meilleurs d'entre eux un chapeau haute forme et une longue redingote bleue... M. Geanno les appelait Monsieur ». Simon proclame : « J'étais un grand libéral dès ce temps-là ».
Ecoutons maintenant Rio. « Les émotions ou plutôt les répulsions devinrent encore plus fortes quand nous entrâmes au collège ; et qu'au premier appel fait par le professeur nous entendimes des noms sinistres avec lesquels nous n'étions que trop familiarisés... Les fils des bourgeois révolutionnaires siègeaient sur les mêmes bancs que nous, en face ou à côté de ceux que leurs pères avaient contribué à rendre orphelins... Le pensionnat auquel j'appartenais avait la gloire de fournir les champions les plus valeureux... pour les collisions trop souvent sanglantes auxquelles donnait lieu l'insolence d'une certaine populace révolutionnaire ».
Geanno, malgré toutes les difficultés créées par les différences de fortune et les haines politiques de bourgeois des villes à paysans, l' « incompatibilité de prétentions et de principes entre les villes et les campagnes », comme dit Rio, sut attirer les élèves de toutes parts, faire prospérer son collège, y maintenir une atmosphère familiale. Cette constatation, à elle seule, fait l’éloge de son caractère et de ses capacités.
On sait la part prise par les élèves du collège dans le soulèvement du Morbihan durant les Cent-Jours, que l'on est convenu d'appeler la Petite Chouannerie. Quel fut alors le rôle du principal ? « Nous contractions l'habitude de ne respecter aucun des agents du pouvoir » impérial, reconnaît Rio. Quand vinrent les Cent-Jours, les écoliers donnèrent libre cours à leur « insolence déclamatoire ». Ils « marchèrent d'imprudence en imprudence » et, « par leur conduite inconsidérée, avouera plus tard leur capitaine, l'abbé Bainvel, donnèrent à l'autorité, non seulement des prétextes, mais le droit de les surveiller avec sévérité ». Cependant les bourgeois révolutionnaires parlaient « d'employer la force des baïonnettes » pour les réduire ; il y avait dans leur camp « des hommes qui ne pouvaient être satisfaits tant que le sang des écoliers n'aurait pas coulé », et qui accumulaient les « mesquines provocations ».
« On comprend aisément les terreurs du pauvre principal sur qui pesait une double responsabilité, l'une vis-à-vis des autorités locales, l'autre vis-à-vis des parents » (Rio). Que disait- il à ses collégiens ? Tout d'abord ceci, le 3 avril : « Je vois avec peine que les événements qui se sont passés dans le courant de mars ont fait naître parmi vous des divisions et des animosités dangereuses. Quelques-uns ont renouvelé ces dénominations odieuses propres à réveiller les anciennes haines, d'autres en sont venus à des voies de fait et à des actes de violence ; il est temps que ces discordes finissent et que chacun se range à son devoir... Croyez donc un maître qui fut toujours votre ami, et qui n'a rien tant à coeur que vos intérêts et votre bonheur ; renoncez à tout esprit de parti ; laissez là les affaires politiques dont vous ne devez pas vous mêler à l'âge et dans l'état où vous êtes, occupez-vous uniquement de vos études, songez à remplir les vues de vos parents, et fuyez soigneusement tout ce qui pourrait troubler la paix qui vous est nécessaire pour étudier avec fruit ». Après quelques jours, le principal devait revenir à la charge : « Les représentations paternelles que je vous fis au commencement de la semaine dernière n'ont pas calmé, comme je m'y attendais, cette effervescence, cet esprit d'insubordination qui peut avoir pour vous des suites funestes. J'ai appris avec peine que vous vous permettez et en public et en particulier des discours, des actions, des chants et des cris propres à vous attirer des punitions très graves. Je vous préviens que toutes les autorités ont les yeux fixés sur vous.... Vous êtes au collège pour étudier, pour vous instruire, et non pour vous mêler des affaires politiques... Quittez cet esprit de parti qui vous jette de jour en jour dans de nouveaux torts... ».
En parlant ainsi Geanno remplissait son devoir, et ils le remplirent de même ces confesseurs des jeunes écoliers, dont « le langage pathétique combattait la détermination » (Rio) déjà prise par eux de se joindre à la nouvelle chouannerie.
Dans toute sa carrière Geanno nous apparaît comme le parfait pédagogue, au sens ancien du mot, passionné pour sa profession qu'il considérait comme un sacerdoce, ne vivant que pour elle. Celui que ses amis avaient surnommé « le Père Bougeant » y dépensait toutes les forces actives santé de fer, à la fois principal et professeur d'humanités au collège. Conscient des réalités et administrateur de premier ordre quand il s'agissait des intérêts de son cher collège, il lui donna une très grande prospérité. Bientôt maître d'une fortune qui assurait son indépendance, il était « bien moins attaché à celui-ci par un intérêt pécuniaire que par cet autre intérêt qu'un père porté à son enfant ». On y prenait, dit Jules Simon « le goût du travail, des habitudes sérieuses, des sentiments religieux, un grand dévouement à la Patrie française et à Patrie bretonne. Nous aimions nos maîtres du fond du cœur et nos maîtres nous aimaient chaudement ; nous nous aimions entre nous... Notre collège était, dans la force du terme, une famille ». En l'absence de séminaire, le clergé considérait Geanno comme son collaborateur ; « la plupart des ecclésiastiques du diocèse et des hommes qui y jouissaient de quelque considèration » se trouvaient être, à son âge mûr, « ou ses disciples, ou ses condisciples ». Figure ronde, front dénudé, large et élevé, couronne de longs cheveux bouclés couvrant le haut col de sa redingote, regard vif et gai, quelque peu ingénu, de petits yeux, lèvres minces et volontaires, telle nous apparaît la physionomie de Geanno dans le portrait qui le représente au faîte de sa carrière, œuvre sans doute de son ami Jamet. Alors, ayant traversé les temps les plus difficiles, exposé aux attaques que se livraient avec toute la passion bretonne les partis les plus tranchés, il avait gagné, pour ainsi dire de haute lutte, la considération et l'estime de ses concitoyens.
A Château-Gaillard la vie de maîtresse de maison de Madame Geanno n'était pas moins active que celle de son mari. De nombreux élèves, qui suivaient les cours du collège, prenaient pension chez elle, dans l'ancien hôtel du Parlement. Comme beaucoup d'autres femmes méritantes de Vannes, elle usait, pour ces enfants, d'attentions maternelles. Sa pension se trouvait parmi les plus recherchées et les plus nombreuses, ne comptant pas moins de 24 élèves en l'an XII, de 35 en l'an XIII de 40 en 1807. En 1820 Château-Gaillard n'abritait plus que 20 pensionnaires, et en 1823, un- seul, Delplanque.
Le livre de comptes de Mme Geanno permet d'ajouter quelques précisions sur la vie des écoliers de Vannes au commencement du XIXème siècle déjà tant de fois décrite. Il débute avec l'an XII et chiffre d'abord par livres, sols et deniers, jusqu'au 22 décembre 1810 où apparaît pour la première fois le franc et les centimes.
La maîtresse de pension veillait à l'hygiène et à la propreté, telles qu'on les comprenait de son temps. Les bains coûtaient cher (1 l. 18 s.) ; elle en faisait prendre néanmoins. Pour ceux qui ne les apportaient pas dans leurs trousseaux, elle achetait « peigne à retaper et peine à peigner », ce dernier exceptionnellement en ivoire, brosse à habits et brosses à souliers. Elle soignait leurs indispositions avec de la tisane ou des infusions de rhubarbe, de fleurs pectorales, de feuilles, de mélisse, d'orge mondé, de camomille sucrées de miel, du petit lait. Les fines bouches se procuraient des tasses et chocolat à 10 s. l’une de la limonade, du sirop de vinaigre, une « potée de gelée de castilles » à 10 s.
La maîtresse de pension se charge, pour ceux qui le désirent, de les faire habiller. La façon d'une lévite, de deux pantalons et de deux gilets revient, en 1805, à 12 livres ; celle d’une carmagnole à 2 l. 10 s. ; pour retourner une lévite, on prend 5 livres. Sivry qui, nous le verrons, éblouissait ses camarades de son luxe, se fait faire un magnifique habit gris dont il paie les trois aunes de drap 33 francs, la doublure en toile et la garniture de boutons 3 fr., la façon 7 fr. Un chapeau, vaut de 12 à 16 fr., chapeau de soie s'entend, car on le fait repasser de temps en temps. Presque tous ont des sabots à brides (11 s. puis 1 fr.), de souliers à doubles semelles « avec fers » (7 fr. 25), des chaussons « claqués » ou des chaussons de lisière avec semelles ; les élégants seuls se fournissent d'escarpins en peau de cheval (5 fr. 50), de bottes « à retroussis », ainsi que de garnitures de duvet de cygne, de gants de poils de lapin, de bas de soie de guètres de nankin, de boutons de soie noire pour leurs gilets (8 s.), au lieu de simples boutons de métal à 6 s. la douzaine.
Heureux ceux qui peuvent se munir d'un portefeuille à soufflets en parchemin (1 fr. 50), de porte-crayons et de carton de dessin. Comme on le voit, les leçons d'agrément sont fournies à ceux qui le désirent : avec le dessin, les armes (9 fr. par mois) et la danse (6 fr. par mois). Il fallait payer le ruban, des croix gagnées par son travail, si on voulait les porter.
Ce sont là dépenses extrordinaires avancées par Madame Geanno. Les parents doivent régulièrement les « quartiers » de pension qui sont, suivant les cas, de 150 ou de 125 francs chacun. La plupart y ajoutent la « semainée », autrement dit l'argent de poche de leur fils, environ 15 fr. par an.
Parmi les pensionnaires de Mme Geanno figure sur son livre M. Basset. Le « Père Basset », que M. Le Priol embrasse tendrement dans ses lettres à son ami Jean-Louis Geanno, maintient la discipline à la pension, donne des répétitions, tout en professant la classe de sixième au collège. C'est un ami de la maison autant et plus qu'un auxiliaire. On lui rappelle son exclamation en vue des tours de Burgos, durant son exil en Espagne, pendant la Révolution : « J'aimerais mieux voir les tours de Trussac », et comment il faisait dire aux Espagnols, par son obstination à ne rien changer de ses habitudes, malgré les chaleurs les plus torrides : « Il n'y a que les chiens et le curé breton à se promener à la méridienne… ». Jules Simon s'amuse et s'attendrit au souvenir de l'abbé Basset « qui n'était que diacre, qui n'avait jamais voulu être prêtre par humilité, qui était, sous Louis XVI, professeur de cinquième, parce que le collège n'avait pas de sixième, et qui, en 1802, quand une classe de sixième fut créée, la réclama comme sa propriété, et l'emporta de haute lutte ».
Dans la liste des pensionnaires qui suit, à peu près complète, croyons-nous, on retrouvera plus d'un nom connu : la pension Geanno devait compter parmi les plus recherchées, sinon être la plus recherchée des familles fortunées.
Entre tous, l'un d'eux « riche, très riche, ne regardait pas à la dépense. Il le fit bien voir quand il fit porter une toupie d'ivoire dont la pointe était d'argent et le moine d'or, à une demoiselle fort jolie, qui excellait aux jeux de garçons. La mère reçut le cadeau, le replaça dans la boîte, et le renvoya au trop hardi écolier.
Cette toupie est restée légendaire dans les annales de Château-Gaillard. L'élève qui fit ce cadeau se nommait Sivry ; il fut depuis député, préfet et sénateur. Son début aux honneurs fut le grade de porte-drapeau du collège de Vannes » (Mauricet, Le collège de Vannes en 1812), quand celui-ci décida de faire faire un drapeau blanc pour fêter l'arrivée du duc d'Angoulême. Dans le but de subvenir à la dépense, on eut l'idée de mettre à l'enchère les fonctions de porte-drapeau, Bien entendu Sivry l'emporta.
Le livre de comptes de Madame Geanno conserve les traces de quelques dépenses extraordinaires faites pour lui à ce moment, sinon à cette occasion : « un bouquet et son noeud, 5. fr. ; 4 paires de gants, dont une pour lui, 5 fr. ; une livre et demie de dragées, 1 fr. 30 ; 1 cornet pour envoyer à sa maman, 0 fr. 50 ; pour l'église 6 fr. ; pour le sacristain et les pauvres 2 fr. 25 ; rubans et frange pour son écharpe pour l'arrivée du duc d'Angoulême, 1 fr. 50 ». N'y aurait-il, pas eu un baptême du drapeau à l'église ?
PENSIONNAIRES DE CHATEAU-GAILLARD AN XII-1807.
Aché, Allanic, Arnoux, Audrain, Avinette, Benoît, Bertrand, Billaud, Blanchard, Blouard, Boëlle, de Boisgontier, Bonamy, Bonté, Bouczo, Bourdon, Bourdonnaye, Bourgerel, Brunet, Bruté, Burgault, Castellan, Cauzique, Chauffier, Chotard, Claret, Cler, Corbel, Cougoulat, Dalmas, Danet, Danthon, Dardel, Delorme, Delplanque, Denis, Desgrés, Deslandes, Détailles, Deval, Dubois, Du Couëdic, Duleslay, Dupatural, Duperron, Du Plessis-Grénédan, Dupont, Duranquin, Du Rostu, Faucher, Frogier, Galles, Gandard, Gayet, Gohier, Goury, Griffé, Guyot, Henry, Hervé de la Prévostaye, Hervel, Hézette, Hingant, Houdiard, Jouan, Jourdan, Jullien, Kerangal, de Kercado, de Kerret, Kerillis, Kerviler, Laborde, Lallemand, Lallement, Lancien, Langevin, La Paix, Lauly, Laurent, Lauzer, Layrée, Le Bahellec, Lebesque, Le Bihan, Le Bot, Le Bouhellec, Le Corre, Le Floch, Le Gal, Lelièvre, Le Masne, Le Mauff, Le Navenne, Le Ray, Le Roux, Lestrohan, Lhermitte, Le Pontois, Le Priol, Le Regner, Le Roux, Lesquin, de l'Estourbeillon, Lévecque, Loréal, Magdeleine, Magrez, Mabeu, de Margadel, Marsienne, Menu, Mermier, Milon, Mirabeau, Monbrun, Monick, Montassier, Oller, 0llivier, Paradis, de Parcieux, Pastol, Peckre, de Penhouët, Peyronelle, Pic de la Mirandolle, Poitevin, Portanguien, Pradié, Prouhet, Quentrec, Radiguet, Rado, Reigner, de Robien, Rozy, de Sainte-Colombe, de Sécillon, de Sivry, Tardivel, Tardy, Thelouan, Touzé, Trérnember, Trochu, Valory.
Nous craignons de n'avoir pas rétabli pour tous les noms l'orthographe véritable ; la particule n'existe pour ainsi dire pas dans le livre de comptes.
Rapprocher Geanno de ses amis permet de mieux le comprendre. Le plus intime, à coup sûr, fut M. le Priol.
M. le Priol né à Baud, fut collègue de Grearino comme professeur au collège de Vannes avant la Révolution. Ne voulant pas prêter le serment, il s'exila. En l'an X il donne des leçons à Paris, professe les mathématiques à Strasbourg de 1804 à 1808, dirige le lycée de Napoléonville comme proviseur de 1808 à 1812, puis celui de Rouen, à partir de 1812, pour devenir recteur de l'Académie de Rennes en 1816. Mis à la retraite en 1822, il vécut à Paris, d'abord, puis vint à Hennebont en 1829 pour y finir ses jours.
Le Priol est le type du prêtre qui fit la fortune de l'Université à son début, fort apte d'ailleurs, de par son caractère, à saisir et appliquer les principes d'autorité de l'administration d'Empire. « Si la réforme de l'enseignement, écrit-il en 1806, ne tombe que sur les lois sans frapper les personnes, elle ne remédiera pas aux plus grands inconvénients. Dieu veuille qu'elle se fasse de la manière la plus glorieuse pour Lui, et la plus heureuse pour la France ». Ses trois grandes amours se trouvent encore réunies quand il s'écrie, après la révolution de juillet : « Dieu sait ce que deviendra l'Université et ce que deviendra la France ! ». Il ne concevait pas, tout d'abord, qu'on pût enseigner en dehors de l'Université [Note : Cf. sur ce point J. Buléon et E. le Garréc, Saint-Anne d'Auray. Le Petit-Sérninaire, Vannes, 1921, in-8°], qu'il voulait chrétienne ; bien entendu, mais gallicane. Son intransigeance, plus spécialement sur ce point, semble-t-il, le fit mettre à la retraite prématurément. Il le reconnaît, non sans fierté : « J'ai trop bien exécuté les décrets, ordonnances et règlements, et mon caractère connu (essentiellement homme de commandement) ne permettait pas d'espérer que je fisse jamais autrement ».
Rio dépeint « la sévérité habituelle de sa physionomie », sévérité « dont l’expression était trop favorisée par la rudesse de sa figure anguleuse ». Et il ajoute : « Sous cet extérieur dur et parfois déconcertant se cachait un fonds de bonté inépuisable ».
La bonté de cet homme si dur à lui-même, nous en trouvons un témoignage dans son amitié profonde pour « Jean-Louis », qui débuta au, collège de Vannes. Il reçoit de lui des avances de fonds, échoue dans un projet de mariage formé entre son neveu et la fille de Geanno, reçoit et lit les nombreux essais poétiques que le professeur d'humanités s'obstine à soumettre au professeur de mathématiques si dépourvu de la petite fleur bleue : leur affection résiste à tout ! Nous en trouvons en partie l'expression dans les nombreuses lettres de le Priol classées par Geanno qui note sur chacune d'elles la date de sa réponse. Le Priol a, chaque jour, un memento à la messe pour Jean-Louis (28 janvier 1826, 8 juin 1837), et trouve ces accents touchants pour faire cesser son long silence (31 août 1828) : « Pour offrir le saint sacrifice dignement, il ne suffit pas de n'avoir rien contre mon frère ; il est nécessaire que si, au pied de l'autel, je me rappelle que mon frère a quelque chose contre moi, je laisse là tout don et, qu'avant de l'offrir, je me réconcilie avec lui... Je t'avoue que je n'ai pas la conscience de rien qui ait pu mériter tes rigueurs, mais je sais que je ne suis pas justifié pour cela ; je trouve même tout naturel de supposer que j'ai dit ou fait des choses de nature à te déplaire. Dans ce cas accorde-moi un large pardon et du fond de ton cœur ; Dieu te le rendra avec la même usure ». Il y avait eu paresse de Geanno, mais non rancune, puisque le Priol constate, longtemps après : « Non, non, nous ne serons jamais dans le cas de nous réconcilier l'un avec l'autre. Dieu, dans ses miséricordes, nous en épargnera la nécessité ».
Autant que Geanno, le Priol a le culte du collège de Vannes. Il
réconforte Geanno prêt à l'abandonner en 1814 (14 mars), en 1817 (14 mai), et
quand, après les journées de juillet 1830, tous les professeurs prêtres et M.
Monnier parlent de suivre leur principal dans sa retraite, il fait un « devoir »
à celui-ci de « prendre tous les moyens honnêtes pour prévenir un événement
aussi fâcheux ». Il lui dicte les termes d'une lettre au recteur : « Tu dirais
d'abord que, bien que tu sois sur le point d'être délivré de toute
responsabilité, cependant tes longues habitudes et tes affections ne te
permettront jamais de rester indifférent au sort de cet établissement, et que ta
conscience te reprocherait éternellement de garder le silence ».
(31 juillet
1830).
A Hennebont le Priol vit en ermite et même en ermite sauvage. Il s'est retiré là pour disposer de plus de ressources afin de faire élever ses neveux. Le rude vieillard s'égaie des grâces enfantines de celui qui vit sous son toit. Mais ses lettres à Geanno analysent d'impitoyable façon sa décadence grandissante ; il ne cesse de penser à la mort et de s'y préparer.
Ses contemporains le classaient parmi les jansénistes du diocèse. Le Priol « ne repoussait pas moins le jansénisme dogmatique » que Bossuet, déclare Rio, qui pense que le jansénisme de ces prêtres vannetais, « tel que la plupart d'entre eux l'ont compris », avait surtout « pour effet de renforcer en eux, quelquefois outre mesure, le sentiment de leur indignité vis-à-vis de Dieu, et le sentiment de leur dignité vis-à-vis des hommes ». Les lettres de M. le Priol nous le montrent animé d'une haute et rigide piété, bien qu'il s'exprime rarement sur ce sujet : « Prie Dieu que je ne fasse rien pour me contenter moi-même, que je cherche Dieu en tout, que je ne pense et n'agisse que pour Lui. Telle devrait être ma vie ». Très malade, il refuse un bouillon de poulet le jour de la Passion et suit les prescriptions du jeûne malgré le plus complet épuisement.
Sa principale, bientôt sa seule occupation, est la lecture du Journal des Débats, de Fleury, de la Bible et de Bossuet, surtout de Bossuet. « Amusons-nous à la fin de notre carrière, dit-il à Geanno en 1825, toi à faire de jolis vers, et moi à lire quelques pages de Bossuet ». C'est là une idée qui va revenir sans cesse dans sa correspondance, avec les pensées pieuses : « Hélas ! mon cher, tu sens et je suis porté à croire que la folle du logis a perdu de sa première vigueur dans ton vieux corps. Consolons-nous en, mon bon ami : notre amitié ici et notre espérance de nous trouver là-haut ne vieillissent point ». (2 février 1831) « Tempus resolutionis meœ inflat ou du moins ne peut plus être éloigné. Alors, mais je le dis avec crainte, alors seulement je cesserai d'être difficilis querelus, de pécher ». Sa dernière lettre à Jean-Louis date du 22 juin 1839, pour lui souhaiter sa fête. « En réfléchissant un peu sur moi-même, je ne sais si je dois te désirer de longues années encore. [Si nos jours se poursuivent] amplius eorum labor et dolor. Que le sentiment de ces peines nous avertisse sans cesse moins encore d'en désirer le terme que de vivre avec patience et de nous préparer à mourir avec joie. C’est le sort que je sens devoir ambitionner ici-bas, pour moi et pour toi ».
Le Priol et Geanno ont en commun une affection profonde, celle de Mgr Amelot, évêque de Vannes avant la Révolution, dépossédé de son siège par le concordat. Le Priol avait vécu près de lui, semble-t-il, durant une partie de son exil ; il n'avait cessé de lui écrire ainsi qu'à M. Grinne, ancien jésuite et sous-principal du collège, qui demeura près de M. Amelot jusqu'à la Restauration. Au milieu de 1814 M. Grinne « laissait entrevoir son désir de rentrer en France », mais sans prévoir l'époque, en raison du « mauvais état de la santé » de l'évêque. « C'est à ses anciennes ouailles et à nous, ses enfants, écrit alors le Priol, de prier Dieu de le soulager et de le rendre plus tôt à notre pauvre patrie ». En septembre 1815. M. Amelot rentre en France. Durant un séjour dans la capitale, deux ans plus tard, M. le Priol le « trouve en parfaite santé de corps et d'esprit », le voit « longtemps et souvent », lui parle, de « ses anciennes connaissances » et en particulier de Geanno. « Il redevient radieux quand il se trouve transporté au centre de ses anciennes affections ».
Quand il s'installe à Paris après sa retraite, l'ancien recteur d'Académie n'écrit pas une lettre sans parler de M. Amelot qu'il appelle généralement « notre bon Maître », et donne les plus minutieux détails sur sa santé. Il vient alors d'avoir 82 ans, passe l'hiver, à Paris, la belle saison à Passy. Il, souffre cruellement de sa cécité à peu près complète depuis 1820. En 1824, « après, des douleurs inouïes, il perd morceau, par morceau le globe de son œil droite », dont la paupière demeure fermée sur l’orbite vide, et l'on peut craindre, deux ans plus, tard, que l’œil gauche ne subisse le même sort. Mais, sauf quelques petits accès de goutte généralement il se porte « à merveille », se promène au Luxembourg, au bois de Boulogne, se montre « très gai ».
Quand le Priol pense se fixer à Hennebont pour accomplir « la dernière bonne œuvre de sa vie » en faisant élever ses neveux, il retarde l'exécution de son projet en considération de Mgr Amelot (17 janvier 1828). « Il lui en coûterait infiniment » de s'éloigner du « bon Maître ». Tous les jours il le voit et lui lit jusqu'à quarante pages des Élévations et des Méditations de Bossuet. D'ailleurs « la tête aussi bonne que jamais » en 1822, Mgr Amelot garde, en 1825, « tellement le goût de causer » qu'il parle encore quand son visiteur descend l'escalier. C'est seulement en 1828 (12 décembre) que sont notées pour la première fois des marques de défaillance : « les noms de personne lui échappent, et quelquefois les noms communs ».
Le Priol, le 30 décembre qui suit son arrivée à Paris (1828), « embrasse deux fois de suite » l’ « excellent Maître », une fois pour « le bon supérieur » (M. le Gal, supérieur du Séminaire) et une fois pour Geanno ; en janvier 1827 il l'embrasse pour Geanno et pour la mère de celui-ci, et l'évêque « reçoit leurs voeux communs avec reconnaissance, et la double accolade en leur nom avec beaucoup de plaisir ». C'est qu'il aime toujours ses anciennes ouailles et continue à s'intéresser à elles comme un père : Geanno, en particulier, se trouve « haut placé dans son estime et son affection ». Si le Priol reçoit avec plaisir les nouvelles du diocèse, le bon Maître « en est encore plus avide ». Il « ne manque aucune occasion de se recommander aux bonnes prières des amis » qu'il y garde, et « il y a bien quelque droit, s'acquittant des mêmes devoirs pour eux. Orate pro invicem et salvemini ».
Mais il prétend n'exercer absolument aucune action sur les affaires du diocèse : « rien ne lui est plus désagréable que de l'engager à se mêler d'affaires quelconques ». Mgr Amelot, sous l'influence de l'archevêque de Narbonne, avait refusé sa démission au pape au moment du concordat, mais écrit peu après au recteur de Guern pour l'inviter à se soumettre à Mgr de Pancemont. Le 9 juin 1814, encore en Angleterre, il répondait à l'archevêque de Reims qui lui avait transmis l'offre faite par Mgr de Beausset de donner sa démission du siège de Vannes en sa faveur : « Je paraîtrais approuver le concordat et ses suites, reconnaître l'évêque qui occupe mon siège, faire dépendre l'exercice de ma fonction de l'acceptation de sa démission et du sacrifice qu'il veut bien faire de son titre ». Geanno copia cette lettre et la conserva. En 1815 Mgr Amelot envoyait sa démission au roi tout en refusant, l'année suivante, de se joindre à six de ses collègues qui se soumettaient au pape. Le 6 mai 1820 M. Grinne écrivait à M. Baron, chanoine de la cathédrale : « J'admirais cet aveugle si patient, si résigné, et aussi éclairé que jamais des yeux de l'âme. En parlant de sa démission il disait : Ce n'est pas que je m'atttende que le roi et le pape la jugent nécessaire, mais je la crois telle. J'ai reconnu et fait savoir dans mon diocèse qu'on ne devait avoir aucune inquiétude sur le pouvoir des évêques nommés pour gouverner le Morbihan, puisque ces pouvoirs viennent du chef de l'Église que je n'ai jamais cessé de reconnaître pour Souverain Pontife, successeur de saint Pierre, et vicaire de Jésus-Christ, et que je voudrais que tous reconnussent comme [moi] ; puissent les membres de la Petite [Église] tous agir de même » [Note : On ne saurait dire avec certitude si ce dernier membre de phrase, à partir de « puissent », est de Mg, Amelot ou de M. Grinne. Lettre dont la copie était conservée par Geanno. Archives du Morbihan, E. 11]. Toutefois, dans sa lettre à M. le Gal, du 2 avril 1821 (Le Mené. Histoire du diocèse de Vannes, t. II, p. 450), Mgr Amelot ne vise toujours que sa demission au roi. Il n'en vit pas moins « en communion avec les évêques concordataires » (3) pratique le jeûne et l'abstinence, assiste à la messe. Bien mieux, il se montre satisfait de la dernière allocution de son « saint successeur », Mgr Garnier (lettre de le Priol du 5 avril 1827), et s'unit aux prières des fidèles du diocèse qui demandent à Dieu un nouvel évêque. Déjà, le 12 décembre 1825, M. le Priol avait pu écrire : « Les derniers moments de X le Fou sont déplorables. Voilà où mène l'entêtement, l'esprit de coterie, l'attache à ses propres sentiments au mépris de ceux quos posait S.S. regere Ecclesiam Dei. Dieu veuille du moins réaliser tes conjectures et toucher les cœurs des pauvres condisciples Le Leveh (?) et Mahé. Notre bon Maître partage vivement nos voeux à cet égard ». Mgr Amelot mourut à Paris le 2 avril 1829, à 88 ans, après avoir reçu « avec une grande édification tous les sacrements » (Uzareau, article Amelot, dans Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Paris, Letouzey, 1913).
L'ancien sous-principal du collège de Vannes, le P. Grinne, qui vivait aussi à Paris, l'avait précédé dans la tombe. Le Priol et Geanno se dévouèrent pour soutenir ce malheureux, victime de « misérables canailles » qui abusaient de sa crédulité pour « le dépouiller jusqu'aux os ». Geanno recueille des aumônes pour lui venir en aide, lui fait faire des chemises, tandis que le Priol visite, nettoie et remplace ses soutanes, lui achète une corde de bois, et lui fait promettre d'être sage. Mais le pauvre homme n'en recommence pas moins à « exercer sa générosité aux dépens des donateurs et des prêteurs ». C'est « un abîme sans fond, s'écrie le Priol… Il est inutile de travailler à le combler ». Le récit des derniers moments du malheureux, dans la plus noire misère, est un tableau profondément lamentable.
Tels sont les amis du loin dont les nouvelles se lisaient en famille à Château-Gaillard, faisaient ensuite l'objet des commentaires des amis de la ville, le bon puis le vénérable P. Basset, MM. le Bouhelec, Jollivet, Gayet [Note : M. Rio parle longuement de cet ecclésiastique, professeur du Collège, dans son Épilogue à l'Art chrétien], Jourdan, Janet, etc. Nous n'avons fait ici que servir d'écho à ce qu'entendirent, il y a plusieurs siècles, les murs du vieil hôtel.
Après la mort de M. et Mme Geanno, Château-Gaillard demeura indivis entre leurs deux filles : Louise, veuve de M. Monnier, député à l'Assemblée législative, et Jeanne. Celle-ci l'habitait généralement seule, quand M. Louis de Bonnecarère de Monlaur en fit l'acquisition le 10 juillet 1869. M. de Monlaur mourut le 19 avril 1890. Son fils loua Château-Gaillard à M. et Mme le Bobinnec, qui en devinrent à leur tour acquéreur le 17 avril 1897 et le cédèrent, le 20 juillet 1912, à la Société Polymathique (Buguel, notaire).
Blasons des propriétaires et habitants de Château-Gaillard.
Dans la salle du rez-de-chaussée de Château-Gaillard brillent sur les poutres les blasons des familles que ce nom évoque. La croix des Templiers, celle des Hospitaliers, l'écartelé des Tournemine, les besants des Malestroit voisinent avec les armoiries des présidents du Parlement, les billettes des Francheville.
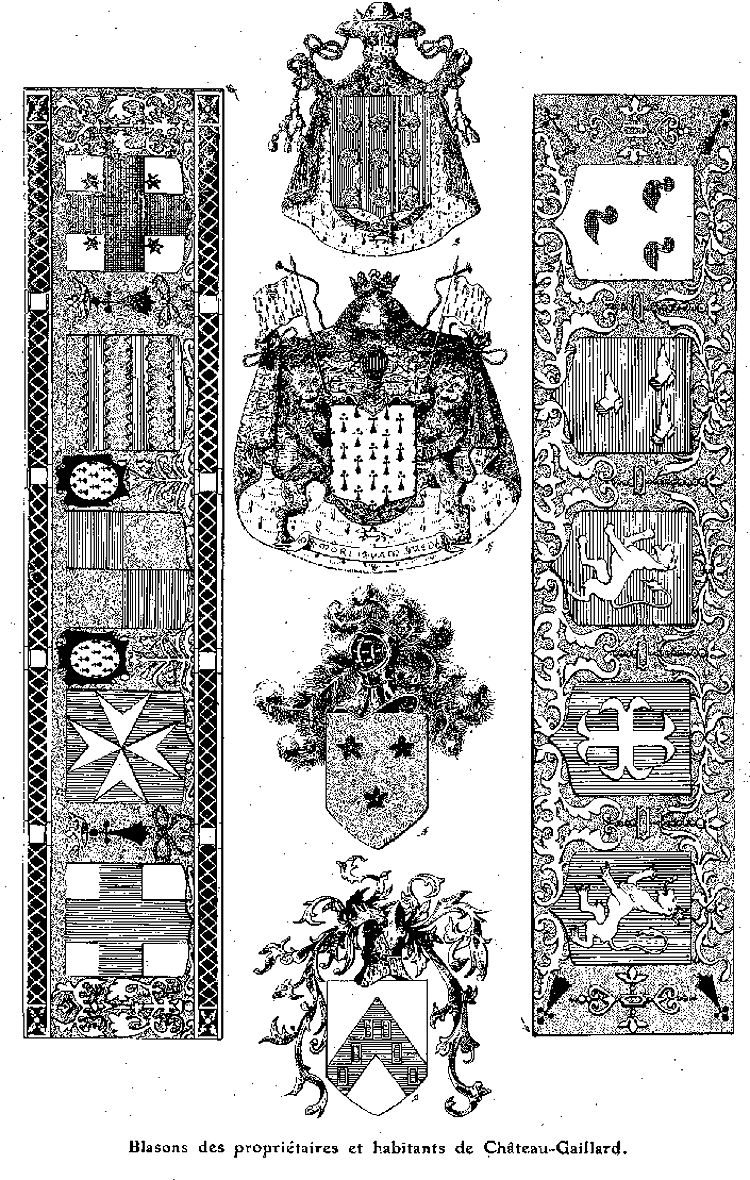
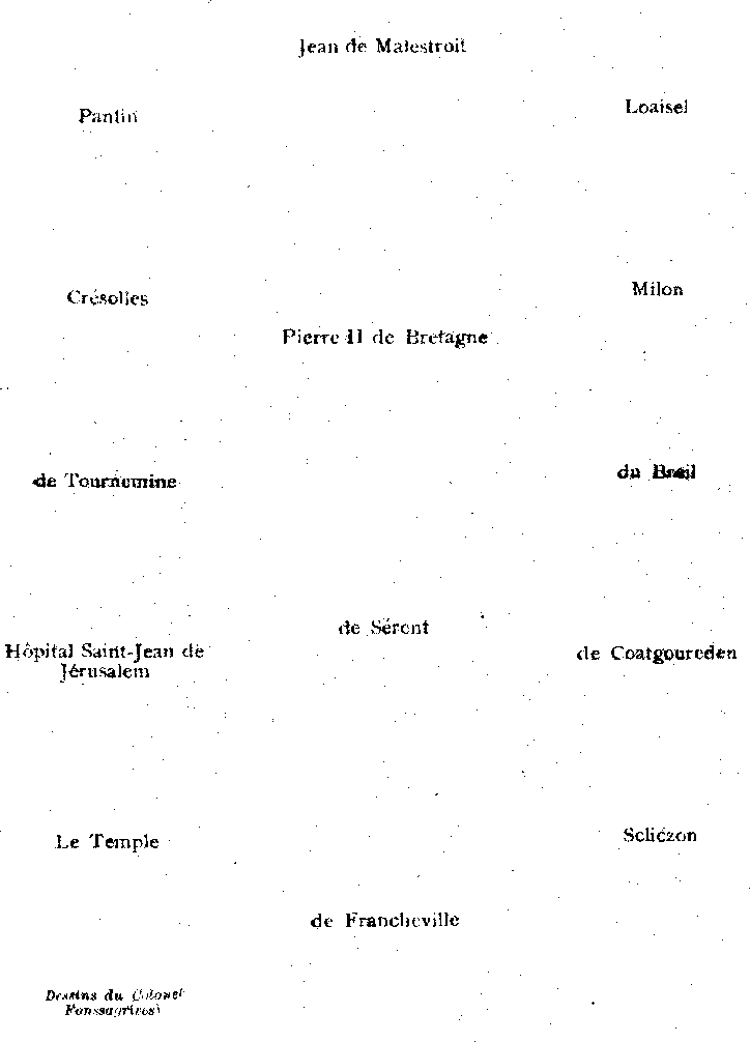
(J. DE LA MARTINIÈRE).
© Copyright - Tous droits réservés.