|
Bienvenue chez les Saint-Aubinois |
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE |
Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Aubin-d'Aubigné
La
commune de Saint-Aubin-d'Aubigné ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
Saint-Aubin-d'Aubigné vient de Saint-Aubin, évêque d'Angers au VIème siècle, et d'Aubigné, baronnie voisine dont la paroisse était une dépendance féodale.
La paroisse de Saint-Aubin-d'Aubigné est ancienne, puisqu'en 1161 le pape Alexandre III confirma l'abbaye de Saint-Sulpice dans la possession de son église, « ecclesiam Sancti Albini de Albiniaco » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1), mais nous n'en savons rien de plus. Les religieuses de Saint-Sulpice y fondèrent un prieuré-cure et présentèrent jusqu'à la Révolution le prieur-recteur, auquel elles firent une portion congrue, étant seules décimatrices dans la paroisse.
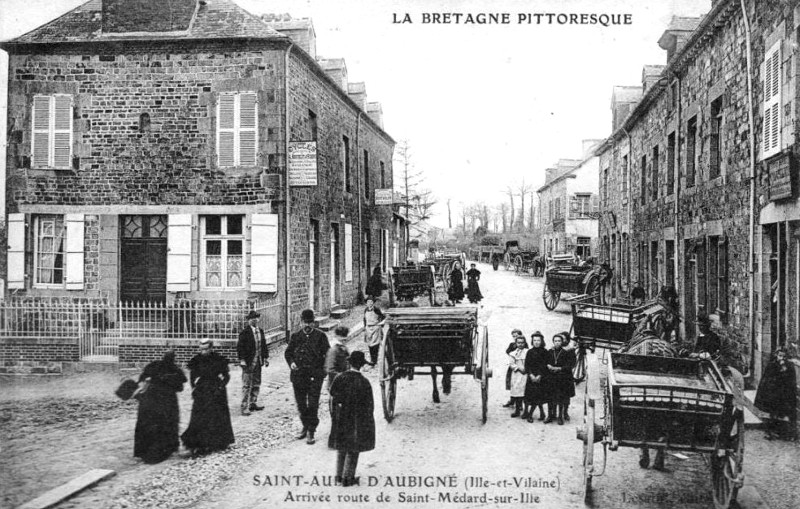
A cette époque la seigneurie du lieu, relevant de la baronnie d'Aubigné, appartient à la famille Montgermont. La famille de Freslon entre au XVème siècle en possession du château et des fiefs qui en dépendent.
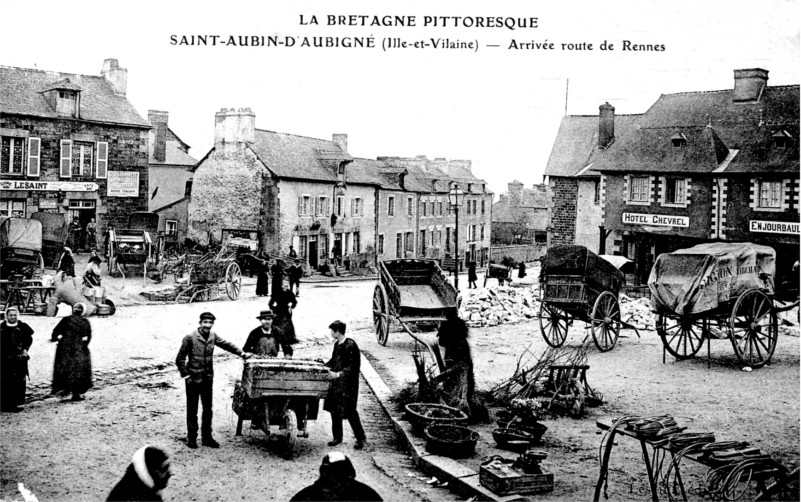
Le recteur de Saint-Aubin-d'Aubigné rend aveu en 1724 à Emmanuel Freslon, seigneur de Saint-Aubin, pour son presbytère et son jardin, situés au Midi de l'église. Il reconnaît en même temps que ce presbytère avait été donné à l'un de ses prédécesseurs « par Julien Freslon, bisaïeul dudit seigneur de Saint-Aubin », à charge seulement de prières nominales pour le donateur, seigneur de la paroisse, faites au prône de la grand'messe (Archives du château de Saint-Aubin-d'Aubigné). En 1790, le recteur Gilles Aubrée déclare qu'il n'avait que ce presbytère, estimé valoir 36 livres de rente, et la portion congrue que lui faisait l'abbesse de Saint-Sulpice (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25).
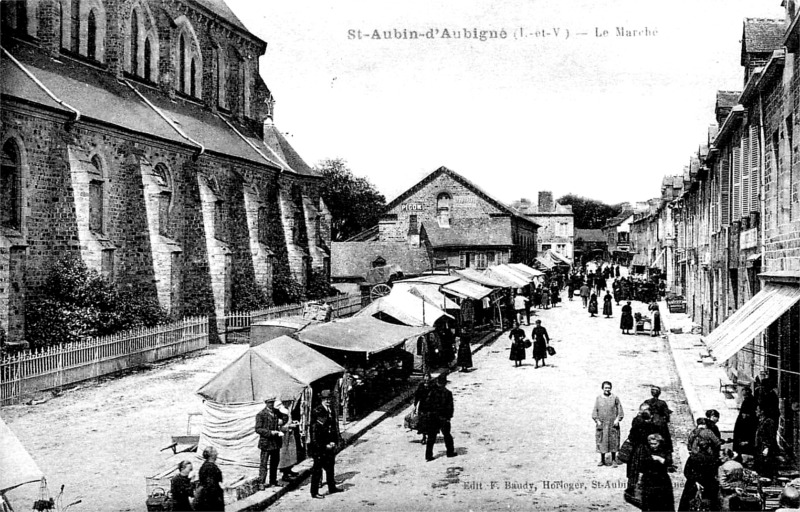
L’armée bretonne passe à Saint-Aubin-d'Aubigné en 1488 avant la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. La paroisse de Saint-Aubin-d'Aubigné dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.
On rencontre les appellations suivantes : Sanctus Albinus de Albiniaco (en 1161), Sanctus Albinus prope Albigneyum (en 1516).
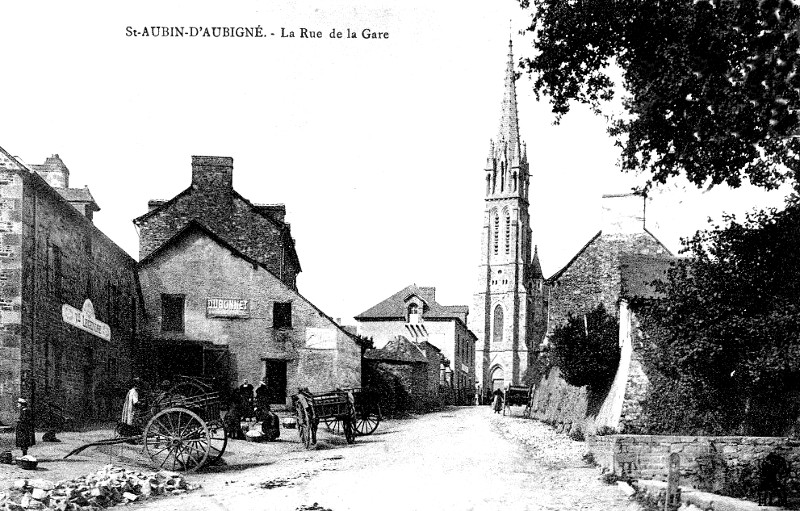
Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Aubin-d'Aubigné : Frère Pierre (religieux Condonat de Saint-Sulpice, il refusa de rendre ses comptes en 1330 à l'abbesse de ce monastère), Jean Day (en 1630), Pierre Garnier (décédé en 1649), René Briand (1649-1658), Jean Besnard (en 1659), N... Jugault (en 1670), Julien Languillet (1672-1696, inhumé dans l'église, devant l'autel du Rosaire), Jacques Rimasson (1696-1717, inhumé dans l'église, à côté de l'autel du Rosaire), Jean Bouvet (1717-1761), Gilles-Joseph Aubrée (1761-1789), François-Jean Vannier (1803-1820), Guy Brette (1820-1821), René Lebreton (1821-1847), Julien Chesnay (1847-1854), Marie-Joseph Voiton (en 1854), Pierre Ridard (1854-1869), Honoré Renault (à partir de 1869), ...
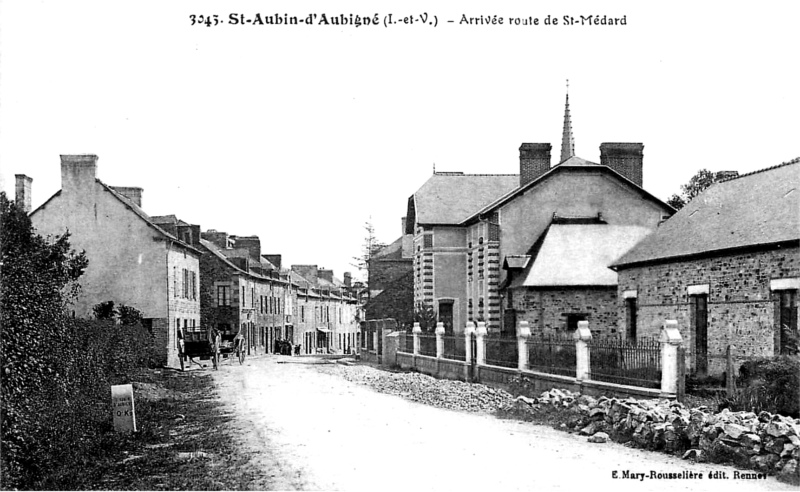
Note 2 : L'ancienne Compaignie des canons d'Andouillé comptait sept associés : Olivier Frotet de La Touche, Julien Pépin du Bignon, Jean Briand de Lesrie, Jean Pépin du Boyscléret, Michel Guillaudeu de Lespayère, Ambroise Audouin du Chastellier et Jean Picot de La Giquelay. Le maître de forges se nommait Martin Chapelet de La Gouronnière. Les fondeurs étaient anglais, ils avaient pour truchement un petit garçon entretenu aux forges et payé par la compagnie. La plupart des canons étaient vendus à l'étranger ; ils valaient 15 livres le cent. Cette fonderie de canon n’a pas été mentionnée par Ogée dans son dictionnaire historique.
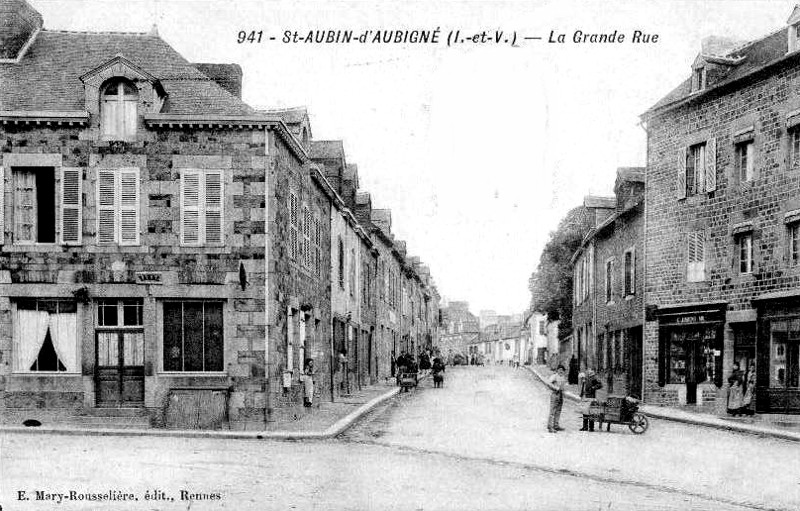
Voir
![]() "
Le
cahier de doléances de Saint-Aubin-d'Aubigné en 1789
".
"
Le
cahier de doléances de Saint-Aubin-d'Aubigné en 1789
".
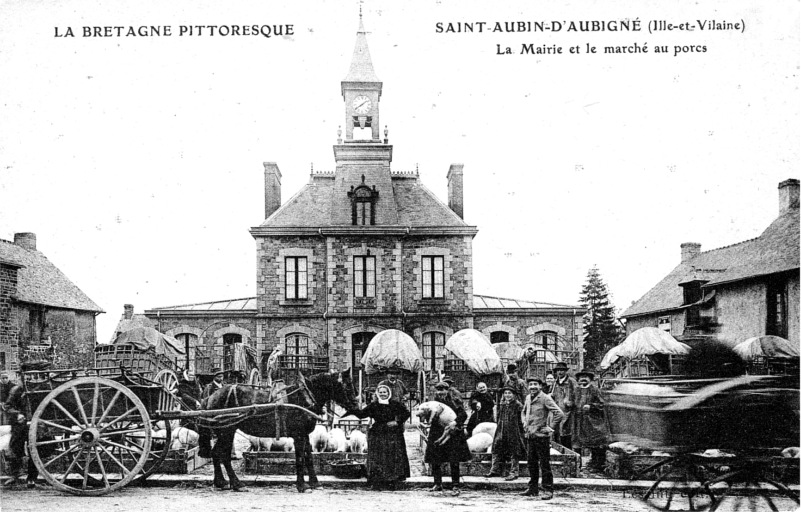
![]()
PATRIMOINE de SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
![]() l'église
Saint-Aubin (1896), édifiée d'après les plans de l'architecte Arthur
Regnault. Elle remplace un ancien édifice datant du XIème
siècle. Deux chapelles avaient été ajoutées à la nef vers la fin du
XVIIème siècle : celle du sud datée de 1676, celle du nord vers 1680.
Quant au choeur, il avait aussi été reconstruit avec chevet droit à la
même époque. La confrérie du Rosaire fut érigée dans la chapelle septentrionale
de cette église le 2 mai 1683, à la requête du recteur Julien Languillet,
par Jean Le Bel, dominicain de Bonne-Nouvelle (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). Les prééminences et le droit de fondation
appartenaient en cette église — dans les derniers siècles au moins —
au seigneur de Saint-Aubin-d'Aubigné ; aussi en 1602 Julien Freslon,
seigneur de la Freslonnière et de Saint-Aubin, fut-il, en qualité de
seigneur de la paroisse, parrain d'une nouvelle cloche (Pouillé de Rennes).
il reste deux pierres tombales qui proviennent probablement d'un enfeu
seigneurial, mais leurs armoiries sont effacées, et l'on n'y distingue plus
sur l'une qu'une épée posée près de l'écu. Le vitrail représentant
Saint-Michel date de 1898 et il est l'oeuvre du maître-verrier Eugène Rault ;
l'église
Saint-Aubin (1896), édifiée d'après les plans de l'architecte Arthur
Regnault. Elle remplace un ancien édifice datant du XIème
siècle. Deux chapelles avaient été ajoutées à la nef vers la fin du
XVIIème siècle : celle du sud datée de 1676, celle du nord vers 1680.
Quant au choeur, il avait aussi été reconstruit avec chevet droit à la
même époque. La confrérie du Rosaire fut érigée dans la chapelle septentrionale
de cette église le 2 mai 1683, à la requête du recteur Julien Languillet,
par Jean Le Bel, dominicain de Bonne-Nouvelle (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). Les prééminences et le droit de fondation
appartenaient en cette église — dans les derniers siècles au moins —
au seigneur de Saint-Aubin-d'Aubigné ; aussi en 1602 Julien Freslon,
seigneur de la Freslonnière et de Saint-Aubin, fut-il, en qualité de
seigneur de la paroisse, parrain d'une nouvelle cloche (Pouillé de Rennes).
il reste deux pierres tombales qui proviennent probablement d'un enfeu
seigneurial, mais leurs armoiries sont effacées, et l'on n'y distingue plus
sur l'une qu'une épée posée près de l'écu. Le vitrail représentant
Saint-Michel date de 1898 et il est l'oeuvre du maître-verrier Eugène Rault ;
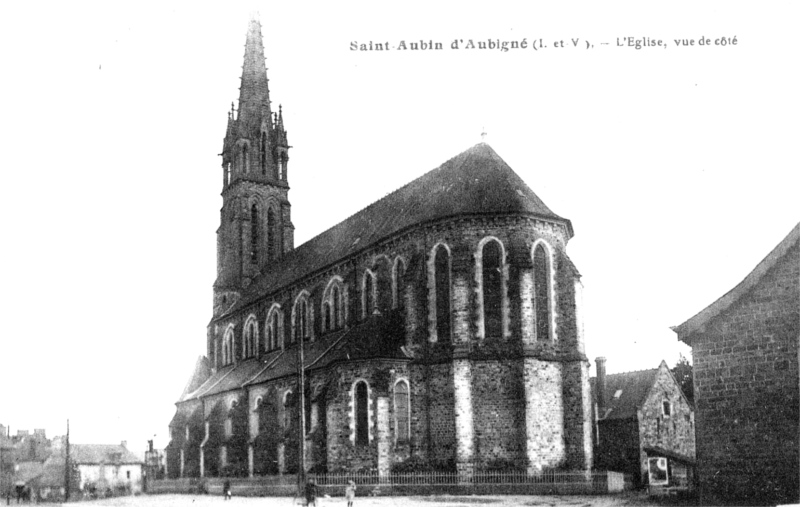
![]() l'ancien
prieuré. Nous ne connaissons point les origines de ce prieuré. Dès l'an
1161, le pape Alexandre III confirma les religieuses de Saint-Sulpice dans
la possession de leur église de Saint-Aubin-d'Aubigné, « ecclesiam Sancti Albini de Albiniaco » (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). Nous savons également qu'en 1330, Pierre, frère
Condonat de Saint-Sulpice, jouissait du prieuré-cure de
Saint-Aubin-d'Aubigné. L'abbesse de Saint-Sulpice présenta même pour ce bénéfice
des religieux bénédictins jusqu'en 1662. Elle était seule décimatrice dans la paroisse ;
l'ancien
prieuré. Nous ne connaissons point les origines de ce prieuré. Dès l'an
1161, le pape Alexandre III confirma les religieuses de Saint-Sulpice dans
la possession de leur église de Saint-Aubin-d'Aubigné, « ecclesiam Sancti Albini de Albiniaco » (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). Nous savons également qu'en 1330, Pierre, frère
Condonat de Saint-Sulpice, jouissait du prieuré-cure de
Saint-Aubin-d'Aubigné. L'abbesse de Saint-Sulpice présenta même pour ce bénéfice
des religieux bénédictins jusqu'en 1662. Elle était seule décimatrice dans la paroisse ;
![]() le
château de Saint-Aubin (XV-XIXème siècle). On y trouve un colombier et un
puits. Il était aux seigneurs de ce nom en 1220. Propriété successive des
familles Montgermont (vers 1414), Freslon, seigneurs de la Freslonnière (en
1436 et 1789). Le manoir de Saint-Aubin était en 1427 à Pierre de Beaucé
et en 1513 à Bonabes Freslon, seigneur de la Freslonnière. Depuis cette
dernière époque, il est demeuré entre les mains de la famille Freslon ;
le
château de Saint-Aubin (XV-XIXème siècle). On y trouve un colombier et un
puits. Il était aux seigneurs de ce nom en 1220. Propriété successive des
familles Montgermont (vers 1414), Freslon, seigneurs de la Freslonnière (en
1436 et 1789). Le manoir de Saint-Aubin était en 1427 à Pierre de Beaucé
et en 1513 à Bonabes Freslon, seigneur de la Freslonnière. Depuis cette
dernière époque, il est demeuré entre les mains de la famille Freslon ;
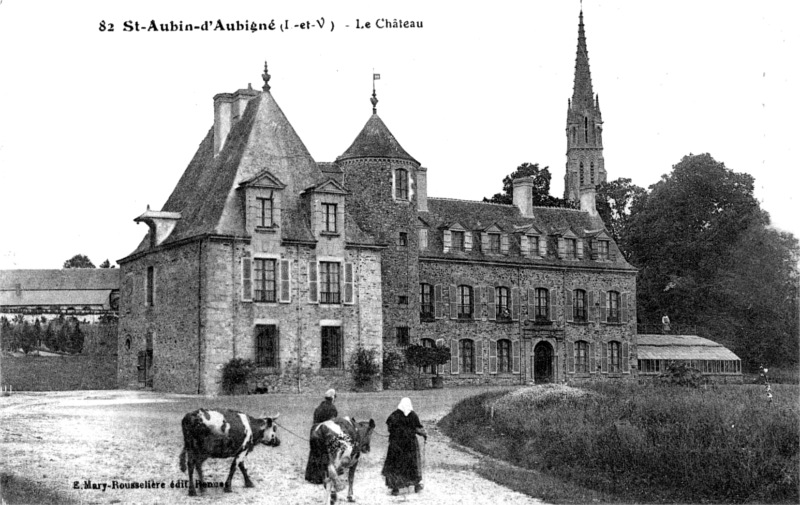
![]() le
manoir de la Gavouyère ou la Garonière (XVIIème siècle). Une chapelle
aujourd’hui disparue est édifiée en 1636 puis reconstruite en 1729. Le
premier sanctuaire élevé près du manoir de ce nom fut bâti vers 1636 par
Bonabes Le Bel, seigneur de la Gavouyère, demeurant à la Marchée, en
Saulnières, pour accomplir les dernières volontés de son père. Le 25 août
1636, il y fonda trois messes par semaine. Cette fondation fut augmentée le
même mois d'une autre messe hebdomadaire, que dotèrent les tantes du
seigneur de la Gavouyère, Anne et Barbe Le Bel, dames des Vergers et de la
Chèze (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 39). Cette double
fondation rapportait en 1690 à Claude Razé, chapelain de la Gavouyère, 65
livres de rente, mais elle n'était plus que de trois messes par semaine.
Pierre Lambin, puis Joseph Briand (1709) la desservirent ensuite. Cette
chapelle tombant en ruine, Madeleine Le Bel, veuve de Claude Denyau,
seigneur du Teilleul, et dame de la Gavouyère, construisit près de ce
manoir un nouveau sanctuaire : « Sachant que ses ancêtres avaient fondé
quatre messes par semaine à la Gavouyère, et que la chapelle de la Gretais,
lui appartenant, mais alors ruinée, était également fondée d'une messe
», cette dame réunit et augmenta ces deux fondations. Par acte du 1er
septembre 1729, elle régla que le titulaire de sa nouvelle chapelle y
dirait la messe tous les jours, sauf certaines fêtes de l'année, y ferait
le catéchisme et tiendrait l'école des garçons de la paroisse. Elle lui
donna pour traitement la métairie de Launay-Blanchet, en Chasné , valant
250 livres de rente. Ces actes furent approuvés par l'évêque de Rennes le
2 septembre 1729. Jean Touchais, décédé en 1775, et Mathurin Bécherie
desservirent la chapelle de la Gavouyère (Pouillé de Rennes). Le domaine
était aux seigneurs de ce nom dès 1397. Propriété de la famille le Bel
(en 1513), puis de la famille Guérin, seigneurs de la Grasserie (vers 1722 et en 1789) ;
le
manoir de la Gavouyère ou la Garonière (XVIIème siècle). Une chapelle
aujourd’hui disparue est édifiée en 1636 puis reconstruite en 1729. Le
premier sanctuaire élevé près du manoir de ce nom fut bâti vers 1636 par
Bonabes Le Bel, seigneur de la Gavouyère, demeurant à la Marchée, en
Saulnières, pour accomplir les dernières volontés de son père. Le 25 août
1636, il y fonda trois messes par semaine. Cette fondation fut augmentée le
même mois d'une autre messe hebdomadaire, que dotèrent les tantes du
seigneur de la Gavouyère, Anne et Barbe Le Bel, dames des Vergers et de la
Chèze (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 39). Cette double
fondation rapportait en 1690 à Claude Razé, chapelain de la Gavouyère, 65
livres de rente, mais elle n'était plus que de trois messes par semaine.
Pierre Lambin, puis Joseph Briand (1709) la desservirent ensuite. Cette
chapelle tombant en ruine, Madeleine Le Bel, veuve de Claude Denyau,
seigneur du Teilleul, et dame de la Gavouyère, construisit près de ce
manoir un nouveau sanctuaire : « Sachant que ses ancêtres avaient fondé
quatre messes par semaine à la Gavouyère, et que la chapelle de la Gretais,
lui appartenant, mais alors ruinée, était également fondée d'une messe
», cette dame réunit et augmenta ces deux fondations. Par acte du 1er
septembre 1729, elle régla que le titulaire de sa nouvelle chapelle y
dirait la messe tous les jours, sauf certaines fêtes de l'année, y ferait
le catéchisme et tiendrait l'école des garçons de la paroisse. Elle lui
donna pour traitement la métairie de Launay-Blanchet, en Chasné , valant
250 livres de rente. Ces actes furent approuvés par l'évêque de Rennes le
2 septembre 1729. Jean Touchais, décédé en 1775, et Mathurin Bécherie
desservirent la chapelle de la Gavouyère (Pouillé de Rennes). Le domaine
était aux seigneurs de ce nom dès 1397. Propriété de la famille le Bel
(en 1513), puis de la famille Guérin, seigneurs de la Grasserie (vers 1722 et en 1789) ;

![]() le
manoir de la Morlais ou Morlays ou Morlaye (XVII-XXème siècle). La Morlais relevait
de la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Propriété successive
des familles Brays (en 1427), Gérard (en 1440), Haugomar (en 1457), du Bé
(vers 1513), Perrault (en 1514), Henry, seigneurs de la Motte (en 1618),
Couespelle (en 1636), Marbeuf (en 1639), Hersart, seigneurs de la Roche (en
1651), Prez, seigneurs de la Gidonnaye (vers 1674 et en 1789 ;
le
manoir de la Morlais ou Morlays ou Morlaye (XVII-XXème siècle). La Morlais relevait
de la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Propriété successive
des familles Brays (en 1427), Gérard (en 1440), Haugomar (en 1457), du Bé
(vers 1513), Perrault (en 1514), Henry, seigneurs de la Motte (en 1618),
Couespelle (en 1636), Marbeuf (en 1639), Hersart, seigneurs de la Roche (en
1651), Prez, seigneurs de la Gidonnaye (vers 1674 et en 1789 ;

Voir
![]() "
Archives
de la seigneurie de la Morlaye ou Morlais
".
"
Archives
de la seigneurie de la Morlaye ou Morlais
".
![]() la
maison à porche (XVIIIème siècle), située place de l’église ;
la
maison à porche (XVIIIème siècle), située place de l’église ;
![]() les
fours à chaux (XIXème siècle ;
les
fours à chaux (XIXème siècle ;
![]() la
statue Notre-Dame de Bon-Secours (1865), située route de Chasné ;
la
statue Notre-Dame de Bon-Secours (1865), située route de Chasné ;
![]() les
anciennes halles (1892 ;
les
anciennes halles (1892 ;
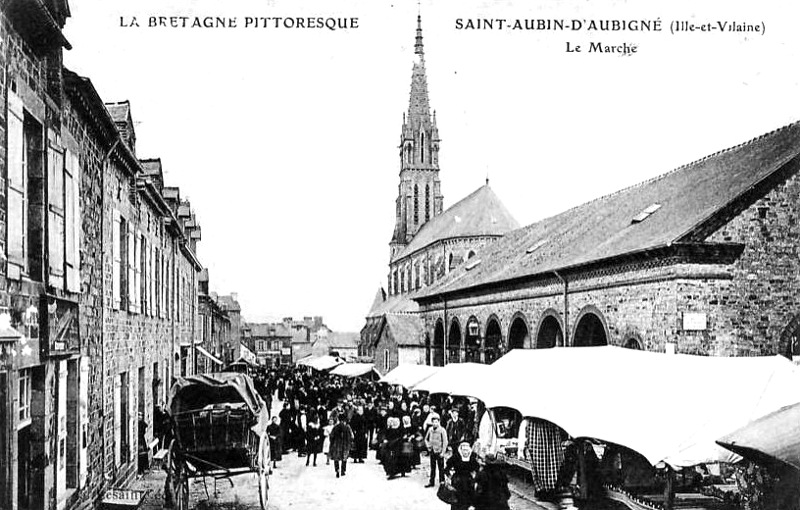
![]() un moulin ;
un moulin ;
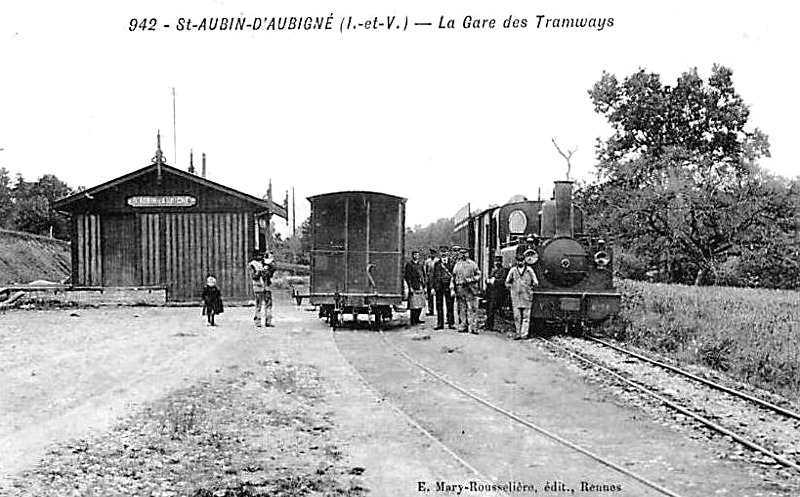
A signaler aussi :
![]() l'ancien
manoir de la Pilais ou de la Piguelais. Il était à la famille Piguelais en 1481 ;
l'ancien
manoir de la Pilais ou de la Piguelais. Il était à la famille Piguelais en 1481 ;
![]() le
manoir de Thoriel. Propriété successive des familles Cornuel (en 1427 et
1513), Bruslon, seigneurs de la Musse (en 1559), Piguelais (en 1599),
Graindorge, sieurs de Bellenoue (en 1624), Kerléan, Bouays (en 1650), Gourdon-Moro ;
le
manoir de Thoriel. Propriété successive des familles Cornuel (en 1427 et
1513), Bruslon, seigneurs de la Musse (en 1559), Piguelais (en 1599),
Graindorge, sieurs de Bellenoue (en 1624), Kerléan, Bouays (en 1650), Gourdon-Moro ;
![]() l'ancien
manoir de Gâtines. Propriété successive des familles Joullain (fin XVème
siècle et en 1513), Carré (en 1552), Lauzanne (début XVIIIème siècle), Danot (en 1749 ;
l'ancien
manoir de Gâtines. Propriété successive des familles Joullain (fin XVème
siècle et en 1513), Carré (en 1552), Lauzanne (début XVIIIème siècle), Danot (en 1749 ;
![]() l'ancien
manoir de la Guesfrais ou de la Grifferais. Propriété successive des
familles la Gavouyère (en 1513), Doulxamy (en 1552), Freslon, seigneurs de
Saint-Aubin (en 1680 et 1789 ;
l'ancien
manoir de la Guesfrais ou de la Grifferais. Propriété successive des
familles la Gavouyère (en 1513), Doulxamy (en 1552), Freslon, seigneurs de
Saint-Aubin (en 1680 et 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de la Grandais. Il possédait autrefois une chapelle. Le domaine relevait de
la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Propriété successive des
familles Brécart et de Macé (en 1427), Séneschal (en 1552), Graindorge
(en 1598), Kerléan (vers 1652), Caradeuc (en 1682 et 1789). Le domaine
appartenait en 1427 à Jamet Brécart et Jean Macé, et en 1682 à Jacques
de Caradeuc, seigneur de la Chalotais ;
l'ancien
manoir de la Grandais. Il possédait autrefois une chapelle. Le domaine relevait de
la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Propriété successive des
familles Brécart et de Macé (en 1427), Séneschal (en 1552), Graindorge
(en 1598), Kerléan (vers 1652), Caradeuc (en 1682 et 1789). Le domaine
appartenait en 1427 à Jamet Brécart et Jean Macé, et en 1682 à Jacques
de Caradeuc, seigneur de la Chalotais ;
![]() l'ancien
manoir de la Mézeray. Il possédait autrefois une chapelle. Pierre Radenatz,
recteur de Saint-Germain de Rennes (décédé vers 1621), y fonda une
chapellenie de quatre messes par semaine, valant 150 livres de rente en
1690. Jean Nourry (1651), Pierre Huet (1690), Mathurin Aubrée, Antoine de
Mareil (1729), François Gaschet, Pierre Crespel (1736) et Michel Audiger en
furent successivement chapelains. Ce dernier prit possession en 1744 de la
chapelle de Mezeray et de la maison de Gastines, affectée probablement au
logement du titulaire (Pouillé de Rennes). Propriété
successive des familles Vaillant (Jean Vaillant en 1427), Boberil (fin XVème siècle),
Bintinaye (en 1513), Radenatz (en 1602), Henry, sieurs de la Motte (en
1633), Regnier, sieurs de la Haye (en 1637), Collin, sieurs de la Biochaye,
Rabeau, sieurs de la Pinelaye (vers 1656), Uguet, seigneurs de l’Aumosme (vers 1666 et en 1679 ;
l'ancien
manoir de la Mézeray. Il possédait autrefois une chapelle. Pierre Radenatz,
recteur de Saint-Germain de Rennes (décédé vers 1621), y fonda une
chapellenie de quatre messes par semaine, valant 150 livres de rente en
1690. Jean Nourry (1651), Pierre Huet (1690), Mathurin Aubrée, Antoine de
Mareil (1729), François Gaschet, Pierre Crespel (1736) et Michel Audiger en
furent successivement chapelains. Ce dernier prit possession en 1744 de la
chapelle de Mezeray et de la maison de Gastines, affectée probablement au
logement du titulaire (Pouillé de Rennes). Propriété
successive des familles Vaillant (Jean Vaillant en 1427), Boberil (fin XVème siècle),
Bintinaye (en 1513), Radenatz (en 1602), Henry, sieurs de la Motte (en
1633), Regnier, sieurs de la Haye (en 1637), Collin, sieurs de la Biochaye,
Rabeau, sieurs de la Pinelaye (vers 1656), Uguet, seigneurs de l’Aumosme (vers 1666 et en 1679 ;
![]() l'ancien
manoir de la Grétais. Sa chapelle était en ruine dès 1729 : elle fut fondée
le 3 mars 1646 d'une messe par semaine et dotée de 20 livres de rente. Etant
tombée en ruine en 1729, sa fondation fut transférée à la Gavouyère. Propriété
successive des familles Ravenel (en 1427), Garnier (en 1643), le Correc (en
1652), Denyau (en 1709), Guérin, seigneurs de la Grasserie (en 1757 et en 1775 ;
l'ancien
manoir de la Grétais. Sa chapelle était en ruine dès 1729 : elle fut fondée
le 3 mars 1646 d'une messe par semaine et dotée de 20 livres de rente. Etant
tombée en ruine en 1729, sa fondation fut transférée à la Gavouyère. Propriété
successive des familles Ravenel (en 1427), Garnier (en 1643), le Correc (en
1652), Denyau (en 1709), Guérin, seigneurs de la Grasserie (en 1757 et en 1775 ;
![]() l'ancien
manoir de la Grande-Rivière. Propriété successive des familles la
Rivière, du Gué (en 1427 et 1513), Deshayes, Huart, seigneurs de la Noë
(en 1619), Guérin, seigneurs de Saint-Brice (en 1682), Phélippot,
seigneurs de la Piguelaye (en 1710), Freslon (en 1789 ;
l'ancien
manoir de la Grande-Rivière. Propriété successive des familles la
Rivière, du Gué (en 1427 et 1513), Deshayes, Huart, seigneurs de la Noë
(en 1619), Guérin, seigneurs de Saint-Brice (en 1682), Phélippot,
seigneurs de la Piguelaye (en 1710), Freslon (en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de la Petite-Rivière ou de la Rivière-Islet. Propriété successive
des familles Bastard, Dangéon, seigneurs de Tréhan (en 1513), Launay (en
1552), Perrault (en 1595), Carion (en 1601), Castellan (en 1680),
Phélippot, seigneurs de la Piguelaye (en 1710), Freslon, seigneurs de Saint-Aubin (en 1789 ;
l'ancien
manoir de la Petite-Rivière ou de la Rivière-Islet. Propriété successive
des familles Bastard, Dangéon, seigneurs de Tréhan (en 1513), Launay (en
1552), Perrault (en 1595), Carion (en 1601), Castellan (en 1680),
Phélippot, seigneurs de la Piguelaye (en 1710), Freslon, seigneurs de Saint-Aubin (en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de la Corbière. Propriété successive des familles Bruslon (fin
XVème et milieu du XVIème siècle), la Piguelaye (en 1599), Graindorge,
sieurs de Ballenoue (en 1624), Kerléan, du Bouays (en 1650), Malo, sieurs
du Clairé, Adam (en 1718), Montbourcher (en 1721 ;
l'ancien
manoir de la Corbière. Propriété successive des familles Bruslon (fin
XVème et milieu du XVIème siècle), la Piguelaye (en 1599), Graindorge,
sieurs de Ballenoue (en 1624), Kerléan, du Bouays (en 1650), Malo, sieurs
du Clairé, Adam (en 1718), Montbourcher (en 1721 ;
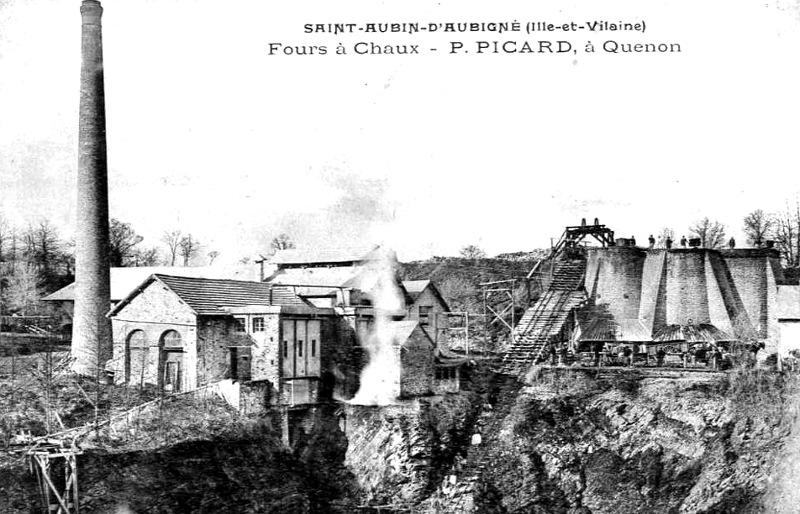
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Eon Pofraie et Jamet Baude, plusieurs nobles sont mentionnés à Saint-Aubin-d'Aubigné :
![]() Pierre
de Beaude, sr. du manoir de St Aulbin (Saint-Aubin) et de celui de la hauretiers ;
Pierre
de Beaude, sr. du manoir de St Aulbin (Saint-Aubin) et de celui de la hauretiers ;
![]() Messire
Amaury de Gué, sr. du manoir de la Ripvière (Rivière) ;
Messire
Amaury de Gué, sr. du manoir de la Ripvière (Rivière) ;
![]() Agaisse
Raguenel (Ravenel), sr. de la Gretaie ;
Agaisse
Raguenel (Ravenel), sr. de la Gretaie ;
![]() Jamet
Gabonnière, sr. de l'hôtel de la Gabonière (Garonière) ;
Jamet
Gabonnière, sr. de l'hôtel de la Gabonière (Garonière) ;
![]() Jean
Brerard (Brécart) et Jean de Mace, sr. de l'hôtel de Grandaie ;
Jean
Brerard (Brécart) et Jean de Mace, sr. de l'hôtel de Grandaie ;
![]() Pierre
de Brais (Brays), sr. de l'hôtel de la Morlais ;
Pierre
de Brais (Brays), sr. de l'hôtel de la Morlais ;
![]() la
dame du Vergier (Verger), dame de l'hôtel de la Ripvière (Rivière) ;
la
dame du Vergier (Verger), dame de l'hôtel de la Ripvière (Rivière) ;
![]() Jean
Vaillant, sr. de l'hôtel de Meszeray (Mézeray) ;
Jean
Vaillant, sr. de l'hôtel de Meszeray (Mézeray) ;
![]() Guillaume
Coruvel (Cornuel), sr. de l'hôtel de Toriel (Thoriel).
Guillaume
Coruvel (Cornuel), sr. de l'hôtel de Toriel (Thoriel).
A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Sainct Aulbin d'Aulbigné" :
- Jehan Le Sénéchal : "Jehan Le Sénéchal seigneur de La Grandaye en robe a présenté pour luy ung homme monté et armé en estat d'archer. Et remonstre que le sieur de Landécot luy avoit esté baillé pour adjoinct qui depuix est mort et décebdé et les enffens estre soubz l'asge de ouict ans et leur bien estre en baill soubz Fougères et en offre informez. Et supplye luy estre pourveu d'aultres adjoinctz.
Et pour informer a produict Michel Boterel et Jehan de Malenoë présens qui ont par serment mesmes et le sieur de Lesquelée [Note : François Quénouaz, sieur de Lesquelée] raporté que ledict sieur de Landécot [Note : Manoir de Landescot, en Saint-Etienne-en-Coglès] qui avoit nom Gilles [Le Gaigneur] estoit mort et décebdé et ses enffens estre myneurs soubz dix an et sa terre en baill à la court ducal de Foulgères [Note : « Sa terre en baill à la court ducal de Foulgères » ; le vieux droit de bail était, par exception, encore exercé dans le ressort rayal de Fougères, et ce n'est qu'en 1559 que le roi en a ordonné la mutation en droit de rachat, conformément aux constitutions bretonnes (A.D.L.A., B 1400)].
Actendu laquelle information il sera pourveu sur l'adjonction requise par ledit Le Sénéchal. Lequel a au parsur faict serment. Et a dit celuy Le Sénéchal avoir en revenu noble LV livres de rente. Et a esté réservé au procureur du Roy de recharger les myneurs de Landécot le baill finy".
- François L'Evesque : "Françoys L'Évesque seigneur de La Morinaye se présente en paroil monté et armé en estat d'archer. Et déclare avoir en fief noble environ cinquante livres de rente. Et supplye estre adjoinet avecq ledit sieur de La Grandaye son beaupère cy présent qui en paroil l'a requis comme ledit Le Sénéchal (sic). Et a ledit L'Évesque faict le serment".
- Georges Le Bel : "Georges Le Bel sieur de La Tour [Note : Manoir de la Tour, en Saint-Pern] se présente monté et armé en estat d'archer pour luy et maistre Eustache Le Bel sieur de La Gavouyère son père. Et a déclaré le revenu d'il et sondit père valloir par an en commune estimation la somme de ouict vigns dix livres monnaye ou environ. Et a esté receu et faict le serment. Et a requis luy estre pourveu d'ajoinct. Et est ledit Le Bel présent qui a vériffié la déclaration cy dessur estre véritable".
- Gilles André : "Gilles André se présente monté et armé en estat d'archer pour Julian André, Gilles du Verger, Gilles Rouxel et ses consors de la Penauldaye, et pour ceulx du Rocher Doulxamy [Note : Manoir du Rocher-Doulxémy, nunc : Rocher des Amis, en Ercé-près-Liffré] ses adjoinctz. Et a ledit André dit son revenu noble valloir quinze livres. Maistre Jehan Pantonnyer pour sa femme et consors du Rocher Doulxamy vignt deux livres. Gilles du Verger pour il et ses enffens vignt [cinq ?]. Ledit Gilles Rouxel pour il et ses consors de La Penauldaye quinze livres. Et l'ont vériffié par serment et ont requis avoir uncore des adjoinctz. Et ont faict le serment".
(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.