|
Bienvenue chez les Ploudalméziens |
PLOUDALMEZEAU |
Retour page d'accueil Retour Canton de Ploudalmézeau
La commune de Ploudalmézeau ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLOUDALMEZEAU
Ploudalmézeau vient du breton « ploe » (paroisse) et « tel » (bosse) et « medovie » (milieu).
Ploudalmézeau est une ancienne paroisse primitive qui englobait autrefois les territoires actuels de Ploudalmézeau, de Saint-Pabu (sa trève) et de Lampaul-Ploudalmézeau.
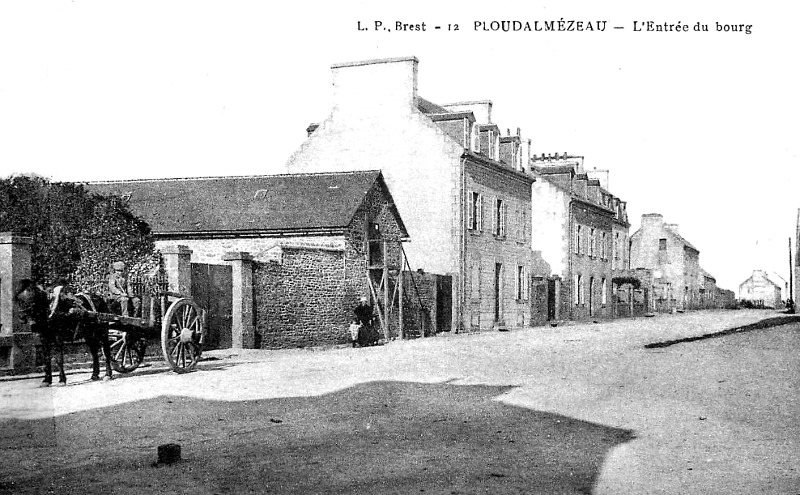
Le chef-lieu primitif de la paroisse se trouvait au village de Guitalmeze-Coz (le vieux-Gwitalmezeau) et dépendait de l'ancien évêché de Léon. Ce transfert semble antérieur à 1544. En 1951, a été créée sur le territoire de Ploudalmézeau la paroisse de Port-Sall (noté Portsall en 1394, du breton porz "port" et sal "château"), dédiée à Notre-Dame du Scapulaire.
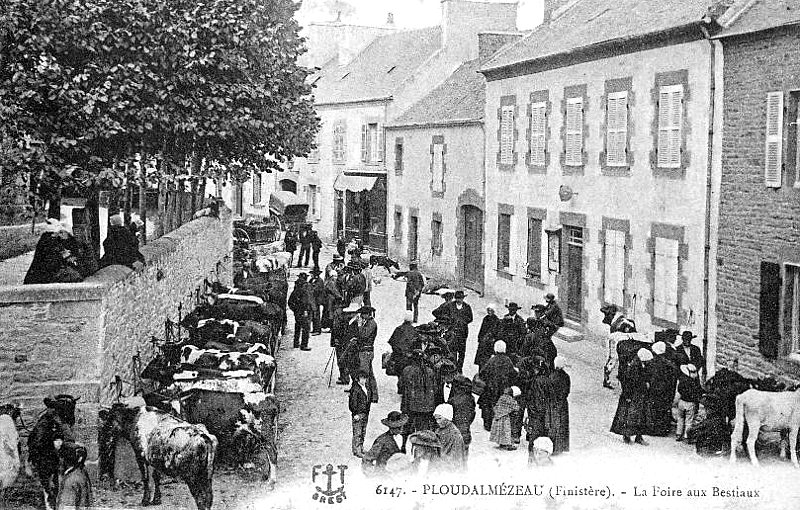
Si nous croyons Laborderie, c'est à Portsall, près d'une roche surnommée Amachdu, que saint Paul Aurélien aurait débarqué sur le continent. Il fonda le Ploutemedou (plebs talmedonia) devenue successivement Ploue telmedou, Ploue telmedzo, Ploudalmézeau. Saint Paul séjourna dans le pays assez longtemps et établit son ermitage à Lanna Paulé (Lampaul - Ploudalmézeau).
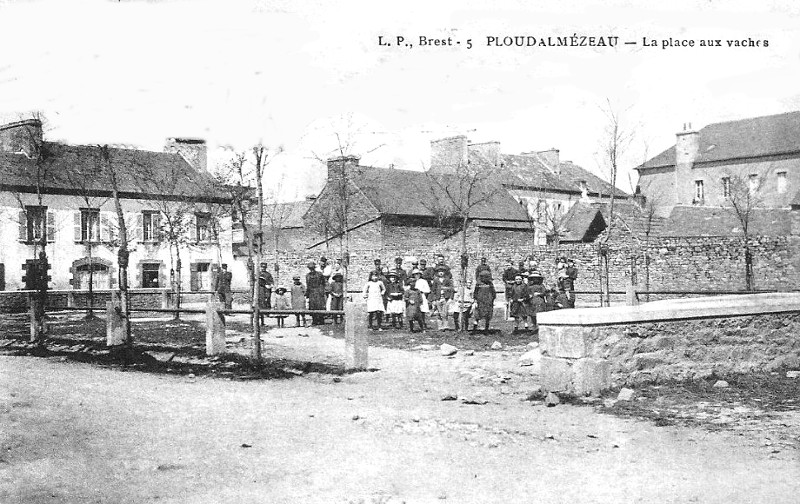
On rencontre les appellations suivantes : Plebs Telmedovia (en 884), Ploedalmezeu (vers 1330 et en 1467), Ploedalmezeau, Guytalmezeau (en 1544).
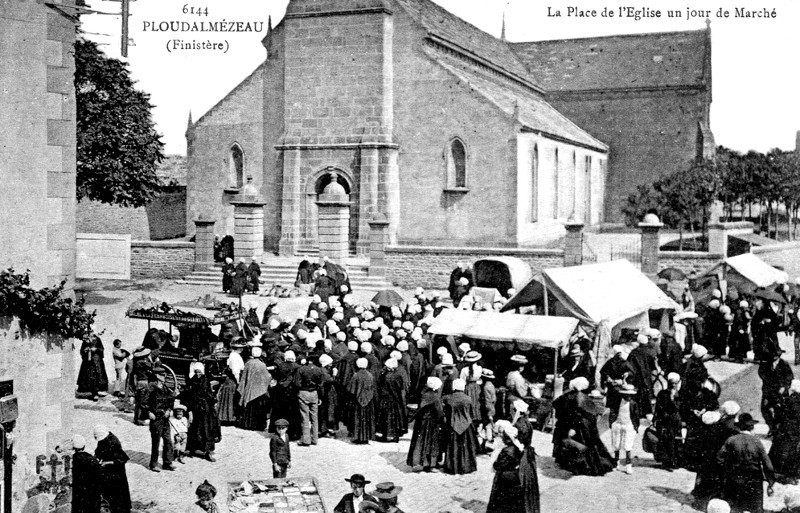
Note : M. Barbier, maire de Ploudalmézeau, est guillotiné à Brest le 9 avril 1794 (durant la Révolution). L'abbé Michel Grall (1846-1917), curé de Ploudalmézeau à partir du 8 mai 1888, fait bâtir trois chapelles : Portsall en 1895, l'Immaculée Conception en 1903, Saint-Joseph en 1913. Il fonde l'Apostolat de la Prière dès 1888, le Tiers-Ordre de Saint-François en 1889, la Confrérie du Saint-Sacrement en 1891, la Confrérie des hommes du Sacré-Coeur en 1904. Le 16 mars 1978, un pétrolier géant, l'Amoco Cadiz, avec en cale 232 182 tonnes de pétrole brut, s'échoue sur les roches de Portsall.
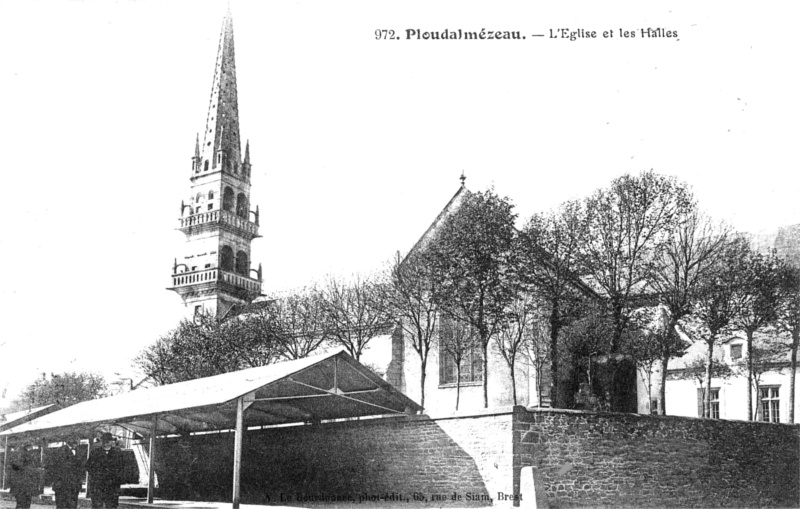
![]()
PATRIMOINE de PLOUDALMEZEAU
![]() l'église Saint-Pierre
et Saint-Vincent Ferrier (XVIIIème siècle), reconstruite en
1857 (date gravée sur l'un des contre-forts) et consacrée en 1859. L'église actuelle aurait été rebâtie sur l'emplacement d'une autre
érigée au XVIème siècle (vers 1504). L'édifice comprend,
précédée d'un clocher extérieur, une nef de cinq travées avec
bas-côtés, un transept, sur chacune des ailes duquel s'ouvrent deux
chapelles et un choeur comprenant une travée accostée de deux chapelles
communiquant avec le transept et une autre sans bas-côtés à chevet droit.
Le clocher, qui date de 1775-1776, a été édifié par François Cornou, maître maçon de Saint Renan, sur les plans de
Gales, recteur de Plouzévédé, et possède deux rangs
de galeries avec clochetons d'angles se reliant au clocher par des
arcs-boutants. Les vitraux modernes de la nef retracent des épisodes de la
vie de Saint Pierre, la maîtresse vitre contient une Crucifixion, les
vitraux des côtés représentent, au nord, saint Thomas, et, au sud, le
mémorial de congrès eucharistique des 28-29 mars 1910 à Ploudalmézeau.
Les peintures murales sont d'André Mériel-Bussy et ont pour thèmes la vie
de saint Paul Aurélien. On y trouvait jadis deux tableaux de
Yann d'Argent : Descente de Croix et Délivrance d'une âme du Purgatoire. On y trouve un reliquaire dans lequel est conservé
une phalange de la main de Saint Vincent Ferrier. Outre une Pietà du
XVIème siècle, le mobilier comprend encore une chaire de 1741 dont les
panneaux illustrent en bas-reliefs la vie de saint Budoc. L'église abrite
aussi les statues de saint Herbot et saint Vincent Ferrier ;
l'église Saint-Pierre
et Saint-Vincent Ferrier (XVIIIème siècle), reconstruite en
1857 (date gravée sur l'un des contre-forts) et consacrée en 1859. L'église actuelle aurait été rebâtie sur l'emplacement d'une autre
érigée au XVIème siècle (vers 1504). L'édifice comprend,
précédée d'un clocher extérieur, une nef de cinq travées avec
bas-côtés, un transept, sur chacune des ailes duquel s'ouvrent deux
chapelles et un choeur comprenant une travée accostée de deux chapelles
communiquant avec le transept et une autre sans bas-côtés à chevet droit.
Le clocher, qui date de 1775-1776, a été édifié par François Cornou, maître maçon de Saint Renan, sur les plans de
Gales, recteur de Plouzévédé, et possède deux rangs
de galeries avec clochetons d'angles se reliant au clocher par des
arcs-boutants. Les vitraux modernes de la nef retracent des épisodes de la
vie de Saint Pierre, la maîtresse vitre contient une Crucifixion, les
vitraux des côtés représentent, au nord, saint Thomas, et, au sud, le
mémorial de congrès eucharistique des 28-29 mars 1910 à Ploudalmézeau.
Les peintures murales sont d'André Mériel-Bussy et ont pour thèmes la vie
de saint Paul Aurélien. On y trouvait jadis deux tableaux de
Yann d'Argent : Descente de Croix et Délivrance d'une âme du Purgatoire. On y trouve un reliquaire dans lequel est conservé
une phalange de la main de Saint Vincent Ferrier. Outre une Pietà du
XVIème siècle, le mobilier comprend encore une chaire de 1741 dont les
panneaux illustrent en bas-reliefs la vie de saint Budoc. L'église abrite
aussi les statues de saint Herbot et saint Vincent Ferrier ;
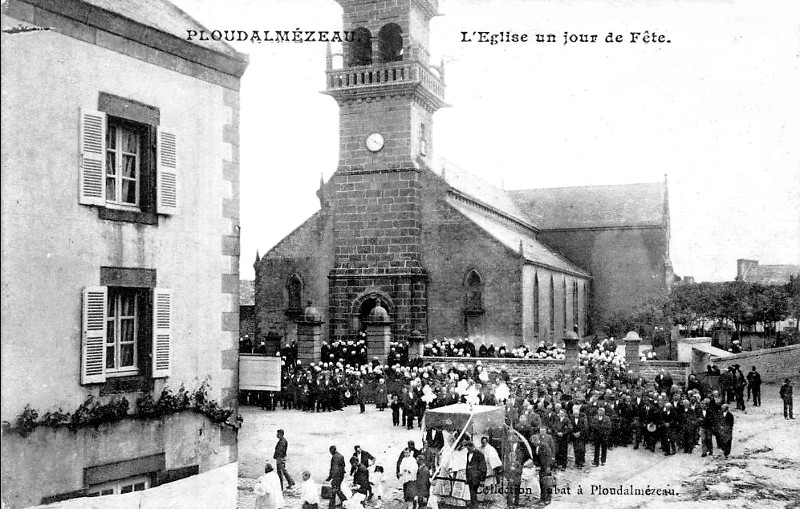

![]() l'église Notre-Dame-du-Scapulaire
ou de Portsall (1895-1921-1956). Erigée primitivement, en forme
de croix sur les plans de M. Le Guerrannic et grâce à l'aide financière de la famille Carof, en 1895-1896, la
chapelle de Portsall est agrandie une première fois en 1921 (du temps de l'abbé Derrien), puis à
nouveau augmentée au sud d'une vaste chapelle alignée sur le chevet et sur
la face ouest de l'ancien croisillon sud. En 1953,
Portsall est pourvu d'un presbytère. En 1956, c'est l'inauguration et la
bénédiction d'un grand bâtiment consacré à l'enseignement. L'église
est de nouveau agrandie, sur les plans de MM. Heuzé, Le Jeune et
Laforest, de Morlaix, en 1956-1957 (le chantier s'ouvre le 10
avril 1957 et l'entreprise Squiban fils de Porspoder est en charge
des travaux) avec l'ajout d'une aile supplémentaire
qui deviendra la nef principale, puis elle est bénie par Mgr Fauvel le 19
septembre 1957, à l'occasion de la Mission organisée
dans les paroisses avoisinantes de Landunvez, Porspoder, Brélès,
Saint-Pabu et Portsall ;
l'église Notre-Dame-du-Scapulaire
ou de Portsall (1895-1921-1956). Erigée primitivement, en forme
de croix sur les plans de M. Le Guerrannic et grâce à l'aide financière de la famille Carof, en 1895-1896, la
chapelle de Portsall est agrandie une première fois en 1921 (du temps de l'abbé Derrien), puis à
nouveau augmentée au sud d'une vaste chapelle alignée sur le chevet et sur
la face ouest de l'ancien croisillon sud. En 1953,
Portsall est pourvu d'un presbytère. En 1956, c'est l'inauguration et la
bénédiction d'un grand bâtiment consacré à l'enseignement. L'église
est de nouveau agrandie, sur les plans de MM. Heuzé, Le Jeune et
Laforest, de Morlaix, en 1956-1957 (le chantier s'ouvre le 10
avril 1957 et l'entreprise Squiban fils de Porspoder est en charge
des travaux) avec l'ajout d'une aile supplémentaire
qui deviendra la nef principale, puis elle est bénie par Mgr Fauvel le 19
septembre 1957, à l'occasion de la Mission organisée
dans les paroisses avoisinantes de Landunvez, Porspoder, Brélès,
Saint-Pabu et Portsall ;
![]() la chapelle Saint-Eloi
(vers 1880), dite aussi Sainte-Barbe, située au village de Kerlanou et construite à
l’emplacement d’une ancienne chapelle. Il s'agit d'une fondation
des seigneurs des Salles. L'édifice est de plan
rectangulaire avec chevet droit reconstruit au XIXème siècle. Eloi fut ministre et
confident de Dagobert. Il mourut à Noyon en 660 ;
la chapelle Saint-Eloi
(vers 1880), dite aussi Sainte-Barbe, située au village de Kerlanou et construite à
l’emplacement d’une ancienne chapelle. Il s'agit d'une fondation
des seigneurs des Salles. L'édifice est de plan
rectangulaire avec chevet droit reconstruit au XIXème siècle. Eloi fut ministre et
confident de Dagobert. Il mourut à Noyon en 660 ;
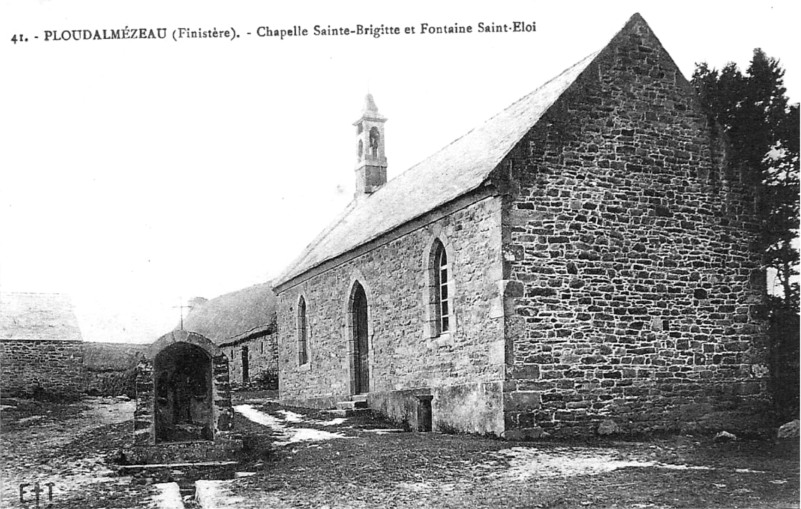
![]() la
chapelle de Saint-Roch (1642). Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire
avec clocheton à dôme reconstruit en 1822. La chapelle abrite les statues
de saint Roch, saint Yves et la sainte Vierge ;
la
chapelle de Saint-Roch (1642). Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire
avec clocheton à dôme reconstruit en 1822. La chapelle abrite les statues
de saint Roch, saint Yves et la sainte Vierge ;
![]() l'ancienne
chapelle Sainte-Anne (1901). Il s'agit de la chapelle de l'école des
filles. Edifice de plan rectangulaire avec tribune en bas de la nef. La
chapelle abrite une statue de saint Grignon de Montfort ;
l'ancienne
chapelle Sainte-Anne (1901). Il s'agit de la chapelle de l'école des
filles. Edifice de plan rectangulaire avec tribune en bas de la nef. La
chapelle abrite une statue de saint Grignon de Montfort ;
![]() l'ancienne
chapelle Saint-Joseph. Il s'agit de la chapelle de l'école des garçons ;
l'ancienne
chapelle Saint-Joseph. Il s'agit de la chapelle de l'école des garçons ;
![]() l'ancienne
chapelle de l'Hospice (début du XIXème siècle). Il s'agit d'une salle
rectangulaire aménagée ;
l'ancienne
chapelle de l'Hospice (début du XIXème siècle). Il s'agit d'une salle
rectangulaire aménagée ;
![]() les
anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : la chapelle de Kerlech
(dédiée jadis à sainte Brigitte), la chapelle
Saint-Usven (située jadis à Portsall), la chapelle de Kerouanok (ancienne
chapelle privée), la chapelle de Kernatous (ancienne chapelle privée), la
chapelle de Kervezennec (ancienne chapelle privée), la chapelle de
Lestrémeur (ancienne chapelle privée) et la chapelle de Pratmeur (ancienne
chapelle privée) ;
les
anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : la chapelle de Kerlech
(dédiée jadis à sainte Brigitte), la chapelle
Saint-Usven (située jadis à Portsall), la chapelle de Kerouanok (ancienne
chapelle privée), la chapelle de Kernatous (ancienne chapelle privée), la
chapelle de Kervezennec (ancienne chapelle privée), la chapelle de
Lestrémeur (ancienne chapelle privée) et la chapelle de Pratmeur (ancienne
chapelle privée) ;
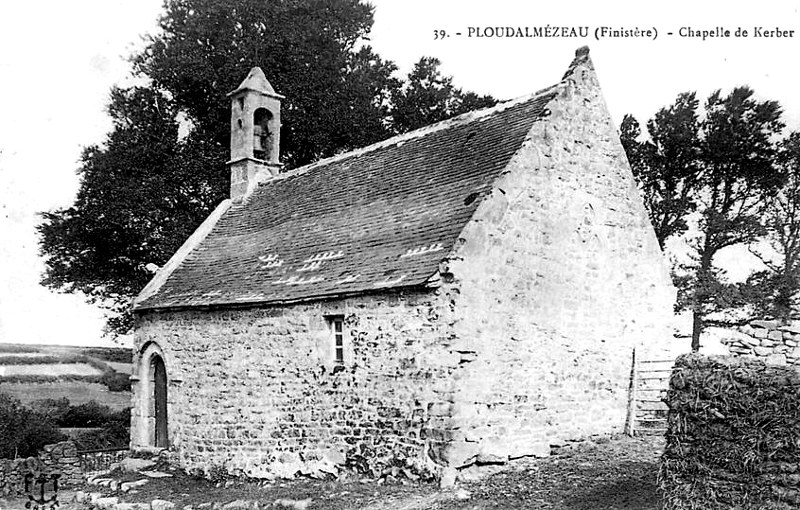
![]() la croix de l’église Saint-Pierre (XIIIème siècle) ;
la croix de l’église Saint-Pierre (XIIIème siècle) ;
![]() la
croix de Barr-al-Lan (XVIème siècle). Cette croix (Croix-de-Leurgéar)
provient de Porsall-Goz. Elle est restaurée en 1957 ;
la
croix de Barr-al-Lan (XVIème siècle). Cette croix (Croix-de-Leurgéar)
provient de Porsall-Goz. Elle est restaurée en 1957 ;
![]() la
croix de Bar-al-Lan ou Le Guilliguy (Moyen Age). Cette croix se trouvait
autrefois près de la chapelle de Saint-Usven, dans le cimetière d'enclos jusqu'en 1895 ;
la
croix de Bar-al-Lan ou Le Guilliguy (Moyen Age). Cette croix se trouvait
autrefois près de la chapelle de Saint-Usven, dans le cimetière d'enclos jusqu'en 1895 ;
![]() la
croix de Tréoulan (XIIIème siècle), restaurée en 1950 ;
la
croix de Tréoulan (XIIIème siècle), restaurée en 1950 ;
![]() d'autres
croix ou vestiges de croix : la croix de Cléguer (1955), la croix de
Croaz-ar-Belec (Moyen Age), la croix Croaz-ar-Reun (1914), la croix de la
Fontaine-Blanche (Moyen Age), les trois croix de Gymnase (Haut Moyen Age),
la croix de Hanter-Hent ou Croas-ar-Guiguerien (Moyen Age), la croix de
Kerdéniel (Moyen Age), la croix de Kerdialaës (Moyen Age), la croix de
Kerigou (Haut Moyen Age), la croix de Kerlannou (Moyen Age), la croix de
Kerloroc (Haut Moyen Age), la croix de Kerloroc (Moyen Age), la croix de
Kernatous (Moyen Age), la croix de Kerozern (1915), la croix de Lestrehone
(Moyen Age), la croix de Kerlannou ou Lestrehone (Moyen Age), la croix de
Coras-an-Ouennou, en Lestrehone (Moyen Age), la croix située route de
Gouranou (Moyen Age), la croix de Keribin (XVème siècle), la croix située
place Charles-de-Gaule ou Croas-Karn (Haut Moyen Age), la croix de
Ploudalmézeau (1873), la croix monolithe de Porastel-Ruz, la croix de
l'église de Portsall (1950), la croix du cimetière de Portsall (1956), la
croix de Prat-Léac'h (Haut Moyen Age), la croix de la chapelle Saint-Roch,
la croix de Saint-Roch (Moyen Age). A signaler également des croix
aujourd'hui disparues : la croix de Kervao, la croix de Croaz-Dibenn
(située sur la route des dunes de Kerlannou à Tréompan), la croix de
Guiellé (située sur les terres de Pratmeur), la croix de Kerloroc ou de
Toul-al-Lern, la croix de Kroas-Hir (Lézérouté) ;
d'autres
croix ou vestiges de croix : la croix de Cléguer (1955), la croix de
Croaz-ar-Belec (Moyen Age), la croix Croaz-ar-Reun (1914), la croix de la
Fontaine-Blanche (Moyen Age), les trois croix de Gymnase (Haut Moyen Age),
la croix de Hanter-Hent ou Croas-ar-Guiguerien (Moyen Age), la croix de
Kerdéniel (Moyen Age), la croix de Kerdialaës (Moyen Age), la croix de
Kerigou (Haut Moyen Age), la croix de Kerlannou (Moyen Age), la croix de
Kerloroc (Haut Moyen Age), la croix de Kerloroc (Moyen Age), la croix de
Kernatous (Moyen Age), la croix de Kerozern (1915), la croix de Lestrehone
(Moyen Age), la croix de Kerlannou ou Lestrehone (Moyen Age), la croix de
Coras-an-Ouennou, en Lestrehone (Moyen Age), la croix située route de
Gouranou (Moyen Age), la croix de Keribin (XVème siècle), la croix située
place Charles-de-Gaule ou Croas-Karn (Haut Moyen Age), la croix de
Ploudalmézeau (1873), la croix monolithe de Porastel-Ruz, la croix de
l'église de Portsall (1950), la croix du cimetière de Portsall (1956), la
croix de Prat-Léac'h (Haut Moyen Age), la croix de la chapelle Saint-Roch,
la croix de Saint-Roch (Moyen Age). A signaler également des croix
aujourd'hui disparues : la croix de Kervao, la croix de Croaz-Dibenn
(située sur la route des dunes de Kerlannou à Tréompan), la croix de
Guiellé (située sur les terres de Pratmeur), la croix de Kerloroc ou de
Toul-al-Lern, la croix de Kroas-Hir (Lézérouté) ;
![]() le manoir de Kereunou (XVème siècle), édifié par la famille
Keruznou. Ce manoir comprenait deux moulins à eau, une chapelle et un colombier,
aujourd’hui disparus ;
le manoir de Kereunou (XVème siècle), édifié par la famille
Keruznou. Ce manoir comprenait deux moulins à eau, une chapelle et un colombier,
aujourd’hui disparus ;
![]() le manoir de Lestrémeur (XVème siècle), restauré au XIXème
siècle, édifié par la famille Torieuc ;
le manoir de Lestrémeur (XVème siècle), restauré au XIXème
siècle, édifié par la famille Torieuc ;
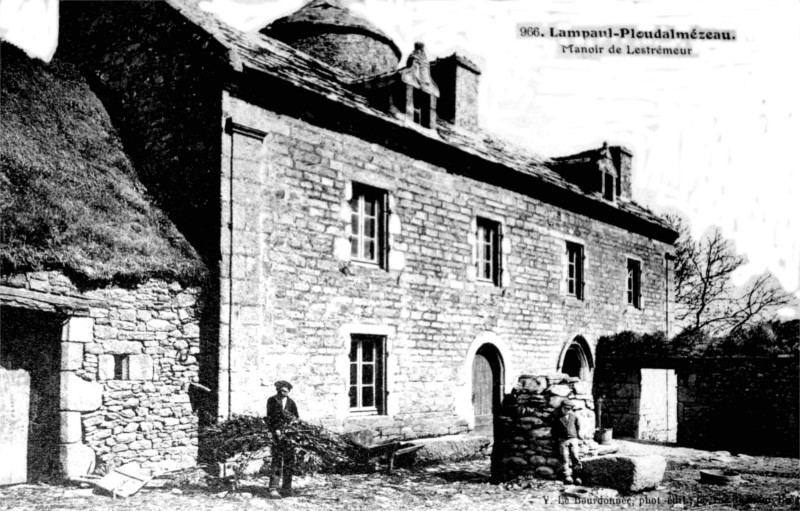
![]() le
manoir de Pratmeur. Propriété de Ollivier Rannou en 1481. Ollivier Rannou
est le fils de Guiomarch Rannou. En 1476, Olivier Rannou rend aveu au duc
François II pour le manoir de Pratmeur ;
le
manoir de Pratmeur. Propriété de Ollivier Rannou en 1481. Ollivier Rannou
est le fils de Guiomarch Rannou. En 1476, Olivier Rannou rend aveu au duc
François II pour le manoir de Pratmeur ;

![]() la maison de Kervezennec (XVIIème siècle) ;
la maison de Kervezennec (XVIIème siècle) ;
![]() la maison de Kerescat (1833-1898) ;
la maison de Kerescat (1833-1898) ;
![]() l'ancienne
fontaine Saint-Eloi, avec niche abritant trois statues en kersanton dont
deux de saint Jean-Baptiste ;
l'ancienne
fontaine Saint-Eloi, avec niche abritant trois statues en kersanton dont
deux de saint Jean-Baptiste ;
![]() le
moulin de Kerlech (XIXème siècle) ;
le
moulin de Kerlech (XIXème siècle) ;
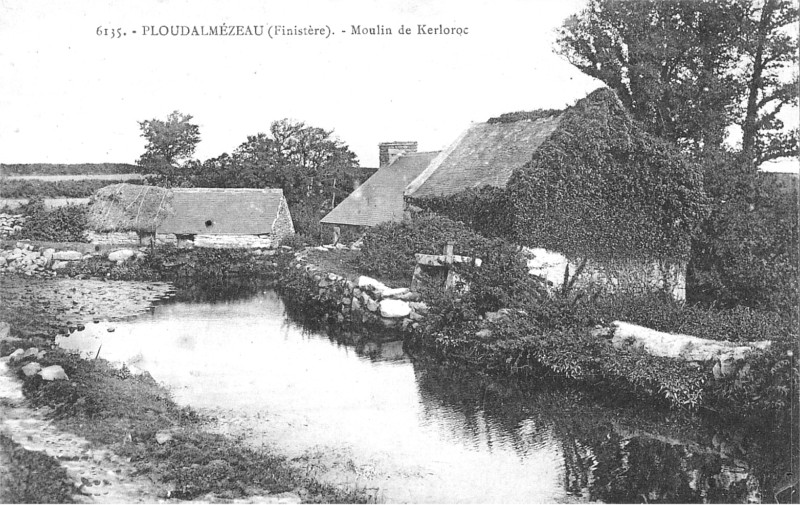
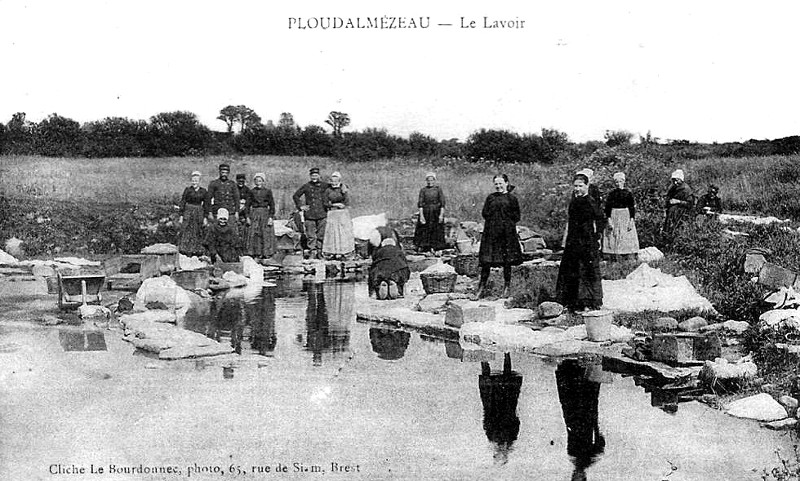
A signaler aussi :
![]() le dolmen de Le Guilliguy (époque néolithique),
qui surplombe Portsall ;
le dolmen de Le Guilliguy (époque néolithique),
qui surplombe Portsall ;
![]() le cairn de l’île Carn (époque
néolithique, daté de 4200 ans avant J.C.). Cet édifice qui
comporte trois allées couvertes a eu pour vocation d'abriter des sépultures ;
le cairn de l’île Carn (époque
néolithique, daté de 4200 ans avant J.C.). Cet édifice qui
comporte trois allées couvertes a eu pour vocation d'abriter des sépultures ;
![]() la stèle de Sandrioné (âge de fer),
d'une hauteur de 110 mètres et située à l'entrée d'une ferme ;
la stèle de Sandrioné (âge de fer),
d'une hauteur de 110 mètres et située à l'entrée d'une ferme ;
![]() la stèle de la place aux chevaux (âge de fer) ;
la stèle de la place aux chevaux (âge de fer) ;
![]() l'ancien
manoir de Kerlech. La famille Kerlech était jadis la plus influente de la
commune. Propriété de Hervé de Kerlech en 1481. Hervé de Kerlech est
l'épouse de Catherine de Penhoadic, décédée après le 11 octobre 1507. La terre de Kerlech est passée
successivement par voie d'héritage au duc de Lauzun (vers 1780), puis aux
familles Tourzel et Hunolstein ;
l'ancien
manoir de Kerlech. La famille Kerlech était jadis la plus influente de la
commune. Propriété de Hervé de Kerlech en 1481. Hervé de Kerlech est
l'épouse de Catherine de Penhoadic, décédée après le 11 octobre 1507. La terre de Kerlech est passée
successivement par voie d'héritage au duc de Lauzun (vers 1780), puis aux
familles Tourzel et Hunolstein ;
![]() le
chemin de fer est inauguré à Ploudalmézeau le 22 mai 1893. La ligne n'est
plus utilisée à partir de 1940 ;
le
chemin de fer est inauguré à Ploudalmézeau le 22 mai 1893. La ligne n'est
plus utilisée à partir de 1940 ;

![]()
ANCIENNE NOBLESSE de PLOUDALMEZEAU
La plus ancienne et la plus célèbre famille de Ploudalmézeau est celle des du Châtel (ou Chastel), dont la suzeraineté s'étendait sur une partie du Léon. Au XIVème siècle, un juveigneur du Châtel épousa une héritière de Kerlech. Le château de Trémazan était le chef-lieu du fief de la famille des du Châtel. En 1575, la branche aînée des du Châtel s'éteint, par contre les du Châtel-Kerlech figurent sur les registres jusqu'en 1707. La famille de Kerlech s'éteignit dans les Kergroades, qui eux-même disparurent dans les Roquelaure. Le fief de Kerlech avait droit de haute et basse justice et le siège de la juridiction se trouvait au bourg de Ploudalmézeau.
Une autre famille a laissé dans le pays un souvenir durable : il s'agit de la famille de Sanzay (mariage de René de Sanzay avec Renée Rannou), qui demeurait au manoir de Pratmeur, en Ploudalmézeau.
Les Rannou comparurent aux réformes et montres, de 1426 à 1534, en Ploudalmézeau, évêché de Léon. Blason : Losange d'argent et de sable. On trouve Olivier Rannou entre les nobles de Ploudalmézeau, à la réforme de 1443. — Guillaume Rannou et Marie de Keraldanet, mariés vers l'an 1580, eurent une autre fille, Renée, qui épousa, vers 1620, René de Sansay, neveu du comte de la Maignane, capitaine ligueur. Le 5 avril 1630, Tanguy de Kersauson (fils d'Hervé de Kersauson et de Françoise de Kerouartz), écuyer, chef de nom et armes de sa maison, qualifié haut et puissant, sr. de Pennendreff, Lavallot, Penandour, Penalan, Kerbriec, et autres lieux, épousa Gabrielle Rannou, dame du Glazéou, fille puînée de noble et puissant Guillaume Rannou, en son vivant chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et de noble et puissante dame Marguerite de Keraldanet, sr. et dame de Keribert, en Ploudalmézeau, — du Beaudiez, en Landunvez, et vicomtes de Pratmeur, aussi en Ploudalmézeau (Archives de Pennendreff). Gabrielle Rannou, dame de Kersauson, mourut en 1655, d'après les registres paroissiaux de Plourin.
Lors de la Réformation de l'évêché de Léon en 1443, plusieurs familles nobles sont mentionnées à Ploudalmézeau :
![]() Kerguizien
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau. D’or à trois
roses de gueules. Hervé se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau.
Kerguizien
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau. D’or à trois
roses de gueules. Hervé se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau.
![]() Keribert
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau, et de Kervénouan,
paroisse de Guisseny. D’argent au lion de sable. Salaun se trouve
mentionné entre les nobles de Guisseny.
Keribert
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau, et de Kervénouan,
paroisse de Guisseny. D’argent au lion de sable. Salaun se trouve
mentionné entre les nobles de Guisseny.
![]() Kerlec'h
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau. D’azur à dix
sonnettes d’argent, 4, 3, 2 et 1. Ce sont les armes de l'ancienne
maison de Kerlec'h qu’on dit tombée dans une branche du Chastel qui
depuis a pris ce nom, et dont était le seigneur de Kerlec'h mentionné
entre les nobles de Ploudalmézeau.
Kerlec'h
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau. D’azur à dix
sonnettes d’argent, 4, 3, 2 et 1. Ce sont les armes de l'ancienne
maison de Kerlec'h qu’on dit tombée dans une branche du Chastel qui
depuis a pris ce nom, et dont était le seigneur de Kerlec'h mentionné
entre les nobles de Ploudalmézeau.
![]() Kerlozrec
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau, et de Lavallot,
paroisse de Ploudiry. Palé d’or et d’azur de six pièces. Jean
se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau et de Ploudiry.
Kerlozrec
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau, et de Lavallot,
paroisse de Ploudiry. Palé d’or et d’azur de six pièces. Jean
se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau et de Ploudiry.
![]() Rannou,
seigneur de Keribert, paroisse de Ploudalmézeau. Losangé d’argent et
de sable. Olivier se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau.
Rannou,
seigneur de Keribert, paroisse de Ploudalmézeau. Losangé d’argent et
de sable. Olivier se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau.
![]() Ros
(an), seigneur de Mesmean, paroisse de Ploudalmézeau. De gueules à l’épée
d’argent en barre, la pointe en haut. Jean se trouve mentionné entre
les nobles de Plouguin.
Ros
(an), seigneur de Mesmean, paroisse de Ploudalmézeau. De gueules à l’épée
d’argent en barre, la pointe en haut. Jean se trouve mentionné entre
les nobles de Plouguin.
A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven en 1481, on comptabilise la présence de 19 nobles de Ploudalmézeau :
![]() le
sire de COËTIVI (500 livres de revenu) : absent. Il s'agit de Charles de
Coëtivy (fils d'Olivier de Coëtivy, décédé vers 1478-1480, et de
Marguerite, seconde fille du roi Charles VII et d'Agnès Sorel), comte de
Taillebourg, prince de Mortagne et de Gironde, baron de Coëtivy, du Menant,
de Forestic et de Trégouroy (époux de Jeanne d'Orléans). Il vendit le 26
juin 1497 ses terres de Coëtivy, du Menant, de Forestic et de Trégouroy à
Jean, baron du Juch, qui passèrent ensuite dans la maison du Chastel ;
le
sire de COËTIVI (500 livres de revenu) : absent. Il s'agit de Charles de
Coëtivy (fils d'Olivier de Coëtivy, décédé vers 1478-1480, et de
Marguerite, seconde fille du roi Charles VII et d'Agnès Sorel), comte de
Taillebourg, prince de Mortagne et de Gironde, baron de Coëtivy, du Menant,
de Forestic et de Trégouroy (époux de Jeanne d'Orléans). Il vendit le 26
juin 1497 ses terres de Coëtivy, du Menant, de Forestic et de Trégouroy à
Jean, baron du Juch, qui passèrent ensuite dans la maison du Chastel ;
![]() Guyon
DU VAL (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît
armé d'une vouge ;
Guyon
DU VAL (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît
armé d'une vouge ;
![]() Ollivier
DU TERTRE (100 sols de revenu), mineur, remplacé par Morice Lesguen : porteur d'une
brigandine, comparaît en archer ;
Ollivier
DU TERTRE (100 sols de revenu), mineur, remplacé par Morice Lesguen : porteur d'une
brigandine, comparaît en archer ;
![]() Vincent
HEUSSA (37 livres de revenu), fils de Jehan Heussaff et de Catherine
Touronce, seigneur de Kervasdoué et époux de Marguerite de Kerlozrec, remplacé par Olivier Coëtlosquet : porteur d'une brigandine, comparaît
armé d'une vouge ;
Vincent
HEUSSA (37 livres de revenu), fils de Jehan Heussaff et de Catherine
Touronce, seigneur de Kervasdoué et époux de Marguerite de Kerlozrec, remplacé par Olivier Coëtlosquet : porteur d'une brigandine, comparaît
armé d'une vouge ;
![]() Guillaume
KERGROAZES (20 livres de revenu), remplacé par Sylvestre : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer. Guillaume Kergroades est l'époux d'Azéline An Heol, fille de
Jacob An Heol, seigneur du Stang an Heol, en Ploudalmézeau ;
Guillaume
KERGROAZES (20 livres de revenu), remplacé par Sylvestre : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer. Guillaume Kergroades est l'époux d'Azéline An Heol, fille de
Jacob An Heol, seigneur du Stang an Heol, en Ploudalmézeau ;
![]() Prigent
KERGUIZIN (35 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Hervé : porteur d'une brigandine, comparaît
armé d'une vouge ;
Prigent
KERGUIZIN (35 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Hervé : porteur d'une brigandine, comparaît
armé d'une vouge ;
![]() le
dit Hervé KERGUIZIN (60 livres de revenu) ;
le
dit Hervé KERGUIZIN (60 livres de revenu) ;
![]() le
sire de KERLECH (200 livres de revenu) ;
le
sire de KERLECH (200 livres de revenu) ;
![]() Morice
KERLOZREUC, mineur (102 livres de revenu), remplacé par Allain Kerlozreuc :
porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
Morice
KERLOZREUC, mineur (102 livres de revenu), remplacé par Allain Kerlozreuc :
porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
![]() Marie
KERMELLEUC (20 livres de revenu), remplacée par Jehan Cozyan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
Marie
KERMELLEUC (20 livres de revenu), remplacée par Jehan Cozyan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
![]() Marguerite
KERNEZEUC (52 livres de revenu), remplacée par Allain Bras : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
Marguerite
KERNEZEUC (52 livres de revenu), remplacée par Allain Bras : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
![]() Bernard
KERROS (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
Bernard
KERROS (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
![]() Ollivier
KERUZNOU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
Ollivier
KERUZNOU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
![]() Jehan
LE GOEZOU (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
Jehan
LE GOEZOU (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
![]() Guillaume
LESCAZNOAL (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
Guillaume
LESCAZNOAL (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;
![]() ledit
Morice LESGUEN (100 sols) ;
ledit
Morice LESGUEN (100 sols) ;
![]() Hamon
PARLIER (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
Hamon
PARLIER (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
![]() Ollivier
RANNOU (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
Ollivier
RANNOU (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
![]() Yvon
TROUREON (60 sols de revenu) : absent ;
Yvon
TROUREON (60 sols de revenu) : absent ;
A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven le 25 septembre 1503, plusieurs nobles de Ploudalmézeau (Ploedalmezeau) sont mentionnés :
![]() Le
sieur de Kerlech, lance. Injonction se monter et s'armer ;
Le
sieur de Kerlech, lance. Injonction se monter et s'armer ;
![]() Morice
Kerlozrec, sieur de Kerlozreuc, o deux hommes en habillement. Enjoinct
fournir lance, monter et armer ;
Morice
Kerlozrec, sieur de Kerlozreuc, o deux hommes en habillement. Enjoinct
fournir lance, monter et armer ;
![]() Olivier
Ranezou, sieur de Keriber, o deux hommes en habillement et ung paige ;
Olivier
Ranezou, sieur de Keriber, o deux hommes en habillement et ung paige ;
![]() Jehan
Heussaff, en brigandine ;
Jehan
Heussaff, en brigandine ;
![]() Bertram
de Saint Goueznou, en habillement d'archer ;
Bertram
de Saint Goueznou, en habillement d'archer ;
![]() Jehan
Duval, en habillement d'archer ;
Jehan
Duval, en habillement d'archer ;
![]() Prigent
le Goëzou, en vougier ;
Prigent
le Goëzou, en vougier ;
![]() Loys
du Tertre, représenté par Olivier du Tertre, mal habillé. Injonction s'accoustrer ;
Loys
du Tertre, représenté par Olivier du Tertre, mal habillé. Injonction s'accoustrer ;
![]() Yvon
Kerros. Injonction de s'habiller ;
Yvon
Kerros. Injonction de s'habiller ;
![]() Hamon
Julien, en vougier ;
Hamon
Julien, en vougier ;
![]() Prigent
Lescazual, en habillement d'archer ;
Prigent
Lescazual, en habillement d'archer ;
![]() Jehan
Lescazual, en vougier ;
Jehan
Lescazual, en vougier ;
![]() François
Kerlech, en vougier ;
François
Kerlech, en vougier ;
![]() Hervé
Kergoezou, en vougier ;
Hervé
Kergoezou, en vougier ;
![]() Hervé
Kervizien, en vougier ;
Hervé
Kervizien, en vougier ;
![]() Olivier
Gestin, absent. Excusé parce qu'il est malade ;
Olivier
Gestin, absent. Excusé parce qu'il est malade ;
![]() André
Penkaer, en vougier ;
André
Penkaer, en vougier ;
![]() Deryan
an Ros, en vougier. Injonction de s'habiller.
Deryan
an Ros, en vougier. Injonction de s'habiller.
A la « montre » (réunion de tous les hommes d’armes) de l’évêché de Léon reçue à Saint-Renan le 24 août 1557, plusieurs nobles de Ploudalmézeau (Plœdalmezeu) sont mentionnés :
![]() Le sr.
de Keruzanan (Claude Pilguen ?) ;
Le sr.
de Keruzanan (Claude Pilguen ?) ;
![]() Olivier
Kerlech, sr. de Kerouanec ;
Olivier
Kerlech, sr. de Kerouanec ;
![]() Tanguy
de Saint-Geznou ;
Tanguy
de Saint-Geznou ;
![]() François
Lescazval ;
François
Lescazval ;
![]() Bernard
Keruznou ;
Bernard
Keruznou ;
![]() Guillaume
le Roz ;
Guillaume
le Roz ;
![]() Pierre
Lescazval ;
Pierre
Lescazval ;
(à compléter) © Copyright - Tous droits réservés.![]() François
le Goezou ;
François
le Goezou ; ![]() Hervé
Millon.
Hervé
Millon.