|
Bienvenue chez les Esséens |
ESSE |
Retour page d'accueil Retour Canton de Retiers
La commune
d'Essé ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE d'ESSE
Essé vient de "Essus" (dieu gaulois) ou du latin "Essius".
Au Moyen Age, les moines bénédictins de Béré, près de Châteaubriant ainsi que les chanoines de la cathédrale de Rennes se partagent les dîmes de la paroisse d'Essé. La paroisse d'Essé dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.
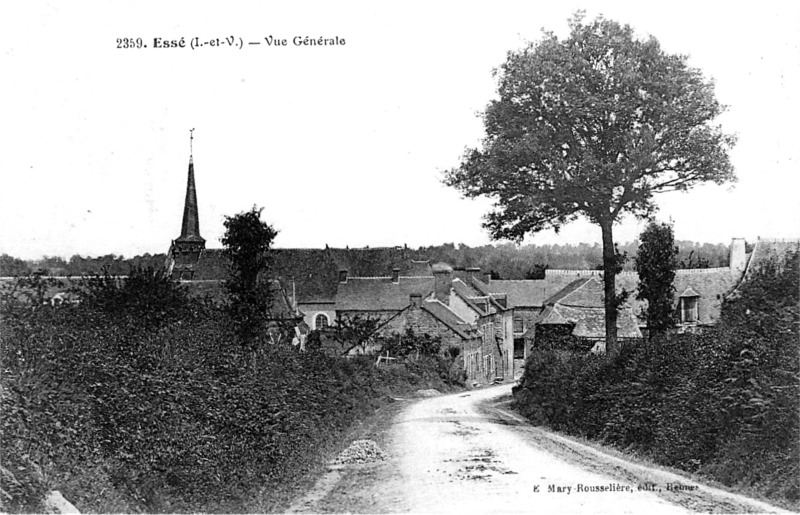
Le titre le plus ancien en faveur d'Essé est ce qui reste debout de sa primitive église. Cette portion de l'édifice annonce, en effet, le XIème siècle, et prouve par suite l'existence de la paroisse à une époque reculée. Au moyen-âge, les moines du prieuré de Béré, près de Châteaubriant, et les chanoines de la cathédrale de Rennes, avaient quelques droits de dîmes en Essé. Quand vint la Révolution, le recteur, M. Marchand, déclara jouir en 1790 de certaines grosses dîmes valant 1 500 livres, et des dîmes vertes, alors très nombreuses, parce qu'on faisait beaucoup de chanvre et de blé noir à Essé. Le tout de son revenu brut valait, d'après lui, 4 000 livres. Mais, charges déduites, il n'était que de 3 424 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29 - Pouillé de Rennes).

Les droits sur les terres d'Essé étaient autrefois répartis entre le prince de Condé, baron de Châteaubriant, le seigneur de La Rigaudière au Theil et le seigneur de Rouvray.
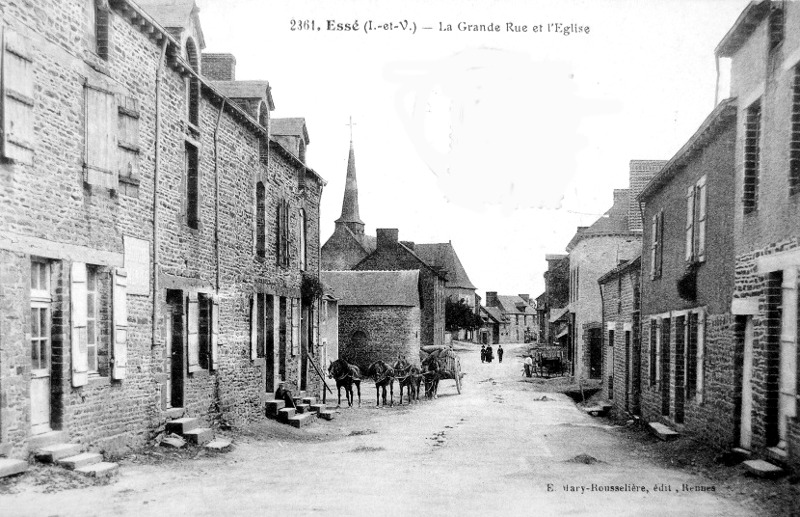
Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse d'Essé : N... d'Argentré (en 1549), Jehan Gauvain (vers 1569), François Gauvain (en 1581), Pierre Gauvain (en 1585), Louis Préobert (en 1640 et en 1644), Pierre du Boisadam (en 1669 et jusqu'en 1677, inhumé dans le chanceau de son église), François Bazouin (en 1677 et jusqu'en 1702), Jacques Guéhenneuc (1702-1726), Thomas-Jacques Lamballais (vers 1726-1727), Louis Méheust (1727-1745), François Cogranne (1745-1754), Julien-François Hairault (1755-1771), Joseph Marchand (1771-1789), Michel Roullé (1803-1810), Louis-Jean Legoux (1810-1828), Isidore Morel (1828-1835), Pierre Faisant (1835-1873), Jean-Marie Fresnel (1873-1877), Célestin Hubert (à partir de 1877), ....

Voir
![]() "
Le
cahier de doléances d'Essé en 1789
".
"
Le
cahier de doléances d'Essé en 1789
".
![]()
PATRIMOINE d'ESSE
![]() l'église
Notre-Dame (XII-XVIIème siècle). Notre-Dame est la patronne de l'église
d'Essé, qui se trouvait encore, semble-t-il, un édifice roman complet au
commencement du XVIIème siècle. C'était une simple nef terminée par un
arc triomphal et un choeur à chevet droit semblable à celui de Brie. Mais
vers 1640 François du Rouvray, seigneur dudit lieu, construisit une
chapelle au haut et au Nord de la nef, avec la permission du seigneur de la
Rigaudière et des paroissiens. Vers le même temps, les sieurs de l'Espinay
et de la Bouestelière-Hardy bâtirent ensemble une autre chapelle semblable
et formant une seconde aile à l'église ; ils y placèrent un banc aux
armes du sieur de l'Espinay et du sieur Jarret de la Trousselière, son
beau-frère. A la même époque, on trouva que l'arc triomphal supportant le
clocher ôtait la vue du choeur ; les paroissiens le détruisirent donc et bâtirent
un nouveau clocher au bas de la nef. Ainsi fut formée l'église actuelle, où
l'on retrouve encore les premières assises romanes de la nef et du chevet,
de nombreux contreforts plats de même style et une dernière fenêtre en
meurtrière sur la façade occidentale ; les autres ouvertures ont été
refaites à diverses époques. Au XVIème siècle, cette église offrait une
singularité : la moitié de l'édifice et du cimetière dépendaient de la
seigneurie de la Rigaudière, au Theil, et l'autre moitié du seigneur du
Rouvray, en Essé, à cause de son Grand bailliage du Bourg d'Essé, dit
aussi bailliage de la Marzelière. De ce dernier fief relevait également le
presbytère d'Essé, avec ses deux jardins et son pré. C'est ce que nous
apprend un aveu rendu en 1569 par Jehan Gauvain, recteur d'Essé, à François
du Rouvray, seigneur dudit lieu ; on voit, en outre, dans cet acte que le
recteur d'Essé payait au seigneur du Rouvray une rente de 12 deniers ; de
plus, à chaque mutation du titulaire de ladite cure, le nouveau recteur
devait au même seigneur « deux pots de vin d'Anjou et un couple de
pains blancs sur l'aultier de pierre dudit seigneur, à présent situé
audit cimetière, au bout du pignon oriental de l'église parrochiale ».
On appelait cet autel extérieur, placé au Midi du chevet, l'autel de la
Marzelière. Peu d'églises offraient ainsi que celle d'Essé un aussi grand
nombre de blasons, comme nous le montre l'inventaire qu'en firent en 1663
les officiers du prince de Condé, baron de Châteaubriant. Ce dernier se
disait, en effet, seigneur supérieur et fondateur d'Essé à cause de sa
seigneurie de Châteaubriant-au-Theil, ce que lui contestait le seigneur de
la Rigaudière. Extérieurement, on y voyait alors gravé, au-dessus de la
vitre du chevet, un grand écusson portant : écartelé aux 1er et 4ème
de gueules à la croix d'argent, qui est du Loroux (terre annexée à
celle de la Rigaudière), et aux 2ème et 3ème de gueules au croissant
d'argent vairé d'azur, qui est de Maure. Les sires de Maure
possédèrent longtemps, en effet, la seigneurie de la Rigaudière, située
au Theil, mais s'étendant beaucoup en Essé. Intérieurement, les armoiries
de la famille de Lopriac : de sable au chef d'argent chargé de trois
coquilles, paraissaient au haut de la maîtresse vitre, derrière le
grand autel. Après la mort de Louise de Maure, la Rigaudière était
devenue, en effet, la propriété du seigneur de Lopriac. Dans cette même
vitre étaient aussi les armoiries des sires de Maure avec leurs alliances.
Sur la porte de la sacristie, des deux côtés du maître-autel et sur une
lisière faisant le tour du choeur et se continuant dans le haut des
chapelles, étaient les armes écartelées de Maure et de la Rigaudière ;
elles paraissaient encore sur le banc seigneurial placé dans le choeur, du
côté de l'évangile. Du côté de l'épître était, dans le choeur, une
autre verrière ainsi décrite en 1623 et subsistant encore en 1663 : «
En une vitre à costé du grand autel, devers l'espitre, est un escusson de
gueules fretté d'hermines, qu'on nous a dit estre des anciens seigneurs de
la Rigaudière, brisé du second quartier : de gueules à la croix d'argent,
qui est du Loroux ». Il y avait aussi en 1623, « à la descente du
grand aulter, du costé de l'évangile, un banc sur l'accoudouer duquel y a
un grand escusson couronné, écartelé aux 1er et 4ème de Maure, aux 2ème
et 3ème contre-écartelé de Navarre, d'Evreux et de Rohan ; sur le tout,
de Bretagne parti de Milan ; et au pied dudit banc y a un écusson écartelé
de Parthenay et de la Rigaudière ». Ces armoiries des sires de Maure
et de leurs alliés se retrouvaient sur une chasuble donnée par eux au
recteur d'Essé. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). Dans la
chapelle du Nord, « prétendue prohibitive par le sieur du Rouvray-Leduc
», on voyait au haut de la vitre un écusson écartelé de Maure et
de Rochechouart ; c'était celui de Gaspard de Rochechouart, qui épousa
vers 1600 Louise de Maure, dame de la Rigaudière. Trois lisières
d'armoiries entouraient cette chapelle : la première portait écartelé
de Maure et de la Rigaudière, la deuxième du Rouvray écartelé de
ses alliances, la troisième simplement du Rouvray : d'azur à trois
merlettes d'or. Dans cette chapelle étaient deux bancs aux armes de la
Rigaudière. La chapelle du Midi était « prétendue prohibitive par le
sieur de l'Espinay et par celui de la Bouestelière-Hardy ». Dans la
vitre étaient trois écussons ; en haut, celui des sires de Maure ; plus
bas, en parallèle, l'un : d'argent au croissant de gueules accompagné
de six billettes de sable, 3, 3, qui est de l'Espinay ; l'autre : d'argent
à quatre aiglons d'azur membrés et becqués d'or, qui est Hardy. Comme
dans la chapelle précédente, il y avait une triple litre de blasons : la
première portait écartelé de Maure et de la Rigaudière, la deuxième
écartelé de l'Espinay et de ses alliances avec les Jarret, du
Rouvray et Loisel ; la troisième avait les armoiries du sieur Hardy
écartelées de ses alliances. Lesdits sieurs de l'Espinay et Hardy
avaient chacun dans cette chapelle leurs bancs clos et ornés de leurs armes
(Les églises sous la baronnie de Châteaubriant en 1663, p. 31-34). De ce
grand luxe de blasons il ne reste plus de traces. Mais si elle a perdu son
cachet héraldique, l'église d'Essé a du moins été restaurée avec goût
(Pouillé de Rennes). On voit sur une pierre de remploi l'inscription "Surexi
Christo et parentib 1640". La maîtresse-vitre était aux armes des de Maure,
seigneurs de la Rigaudière au Theil (au XVIème siècle), et des de Lopriac
(au XVII et XVIIIème siècles). Une autre verrière, au sud du chœur,
portait au XVIIème siècle les armes des seigneurs de la Rigaudière et du
Loroux. Les armes des de la Roche-Huon et de Rochedouart se voyaient aussi
sur plusieurs autres vitres ;
l'église
Notre-Dame (XII-XVIIème siècle). Notre-Dame est la patronne de l'église
d'Essé, qui se trouvait encore, semble-t-il, un édifice roman complet au
commencement du XVIIème siècle. C'était une simple nef terminée par un
arc triomphal et un choeur à chevet droit semblable à celui de Brie. Mais
vers 1640 François du Rouvray, seigneur dudit lieu, construisit une
chapelle au haut et au Nord de la nef, avec la permission du seigneur de la
Rigaudière et des paroissiens. Vers le même temps, les sieurs de l'Espinay
et de la Bouestelière-Hardy bâtirent ensemble une autre chapelle semblable
et formant une seconde aile à l'église ; ils y placèrent un banc aux
armes du sieur de l'Espinay et du sieur Jarret de la Trousselière, son
beau-frère. A la même époque, on trouva que l'arc triomphal supportant le
clocher ôtait la vue du choeur ; les paroissiens le détruisirent donc et bâtirent
un nouveau clocher au bas de la nef. Ainsi fut formée l'église actuelle, où
l'on retrouve encore les premières assises romanes de la nef et du chevet,
de nombreux contreforts plats de même style et une dernière fenêtre en
meurtrière sur la façade occidentale ; les autres ouvertures ont été
refaites à diverses époques. Au XVIème siècle, cette église offrait une
singularité : la moitié de l'édifice et du cimetière dépendaient de la
seigneurie de la Rigaudière, au Theil, et l'autre moitié du seigneur du
Rouvray, en Essé, à cause de son Grand bailliage du Bourg d'Essé, dit
aussi bailliage de la Marzelière. De ce dernier fief relevait également le
presbytère d'Essé, avec ses deux jardins et son pré. C'est ce que nous
apprend un aveu rendu en 1569 par Jehan Gauvain, recteur d'Essé, à François
du Rouvray, seigneur dudit lieu ; on voit, en outre, dans cet acte que le
recteur d'Essé payait au seigneur du Rouvray une rente de 12 deniers ; de
plus, à chaque mutation du titulaire de ladite cure, le nouveau recteur
devait au même seigneur « deux pots de vin d'Anjou et un couple de
pains blancs sur l'aultier de pierre dudit seigneur, à présent situé
audit cimetière, au bout du pignon oriental de l'église parrochiale ».
On appelait cet autel extérieur, placé au Midi du chevet, l'autel de la
Marzelière. Peu d'églises offraient ainsi que celle d'Essé un aussi grand
nombre de blasons, comme nous le montre l'inventaire qu'en firent en 1663
les officiers du prince de Condé, baron de Châteaubriant. Ce dernier se
disait, en effet, seigneur supérieur et fondateur d'Essé à cause de sa
seigneurie de Châteaubriant-au-Theil, ce que lui contestait le seigneur de
la Rigaudière. Extérieurement, on y voyait alors gravé, au-dessus de la
vitre du chevet, un grand écusson portant : écartelé aux 1er et 4ème
de gueules à la croix d'argent, qui est du Loroux (terre annexée à
celle de la Rigaudière), et aux 2ème et 3ème de gueules au croissant
d'argent vairé d'azur, qui est de Maure. Les sires de Maure
possédèrent longtemps, en effet, la seigneurie de la Rigaudière, située
au Theil, mais s'étendant beaucoup en Essé. Intérieurement, les armoiries
de la famille de Lopriac : de sable au chef d'argent chargé de trois
coquilles, paraissaient au haut de la maîtresse vitre, derrière le
grand autel. Après la mort de Louise de Maure, la Rigaudière était
devenue, en effet, la propriété du seigneur de Lopriac. Dans cette même
vitre étaient aussi les armoiries des sires de Maure avec leurs alliances.
Sur la porte de la sacristie, des deux côtés du maître-autel et sur une
lisière faisant le tour du choeur et se continuant dans le haut des
chapelles, étaient les armes écartelées de Maure et de la Rigaudière ;
elles paraissaient encore sur le banc seigneurial placé dans le choeur, du
côté de l'évangile. Du côté de l'épître était, dans le choeur, une
autre verrière ainsi décrite en 1623 et subsistant encore en 1663 : «
En une vitre à costé du grand autel, devers l'espitre, est un escusson de
gueules fretté d'hermines, qu'on nous a dit estre des anciens seigneurs de
la Rigaudière, brisé du second quartier : de gueules à la croix d'argent,
qui est du Loroux ». Il y avait aussi en 1623, « à la descente du
grand aulter, du costé de l'évangile, un banc sur l'accoudouer duquel y a
un grand escusson couronné, écartelé aux 1er et 4ème de Maure, aux 2ème
et 3ème contre-écartelé de Navarre, d'Evreux et de Rohan ; sur le tout,
de Bretagne parti de Milan ; et au pied dudit banc y a un écusson écartelé
de Parthenay et de la Rigaudière ». Ces armoiries des sires de Maure
et de leurs alliés se retrouvaient sur une chasuble donnée par eux au
recteur d'Essé. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). Dans la
chapelle du Nord, « prétendue prohibitive par le sieur du Rouvray-Leduc
», on voyait au haut de la vitre un écusson écartelé de Maure et
de Rochechouart ; c'était celui de Gaspard de Rochechouart, qui épousa
vers 1600 Louise de Maure, dame de la Rigaudière. Trois lisières
d'armoiries entouraient cette chapelle : la première portait écartelé
de Maure et de la Rigaudière, la deuxième du Rouvray écartelé de
ses alliances, la troisième simplement du Rouvray : d'azur à trois
merlettes d'or. Dans cette chapelle étaient deux bancs aux armes de la
Rigaudière. La chapelle du Midi était « prétendue prohibitive par le
sieur de l'Espinay et par celui de la Bouestelière-Hardy ». Dans la
vitre étaient trois écussons ; en haut, celui des sires de Maure ; plus
bas, en parallèle, l'un : d'argent au croissant de gueules accompagné
de six billettes de sable, 3, 3, qui est de l'Espinay ; l'autre : d'argent
à quatre aiglons d'azur membrés et becqués d'or, qui est Hardy. Comme
dans la chapelle précédente, il y avait une triple litre de blasons : la
première portait écartelé de Maure et de la Rigaudière, la deuxième
écartelé de l'Espinay et de ses alliances avec les Jarret, du
Rouvray et Loisel ; la troisième avait les armoiries du sieur Hardy
écartelées de ses alliances. Lesdits sieurs de l'Espinay et Hardy
avaient chacun dans cette chapelle leurs bancs clos et ornés de leurs armes
(Les églises sous la baronnie de Châteaubriant en 1663, p. 31-34). De ce
grand luxe de blasons il ne reste plus de traces. Mais si elle a perdu son
cachet héraldique, l'église d'Essé a du moins été restaurée avec goût
(Pouillé de Rennes). On voit sur une pierre de remploi l'inscription "Surexi
Christo et parentib 1640". La maîtresse-vitre était aux armes des de Maure,
seigneurs de la Rigaudière au Theil (au XVIème siècle), et des de Lopriac
(au XVII et XVIIIème siècles). Une autre verrière, au sud du chœur,
portait au XVIIème siècle les armes des seigneurs de la Rigaudière et du
Loroux. Les armes des de la Roche-Huon et de Rochedouart se voyaient aussi
sur plusieurs autres vitres ;

![]() 5 moulins
dont les moulins à eau du Loroux, de la Lande, et les moulins à vent de la Rigaudière, de la Lande du Saule ;
5 moulins
dont les moulins à eau du Loroux, de la Lande, et les moulins à vent de la Rigaudière, de la Lande du Saule ;
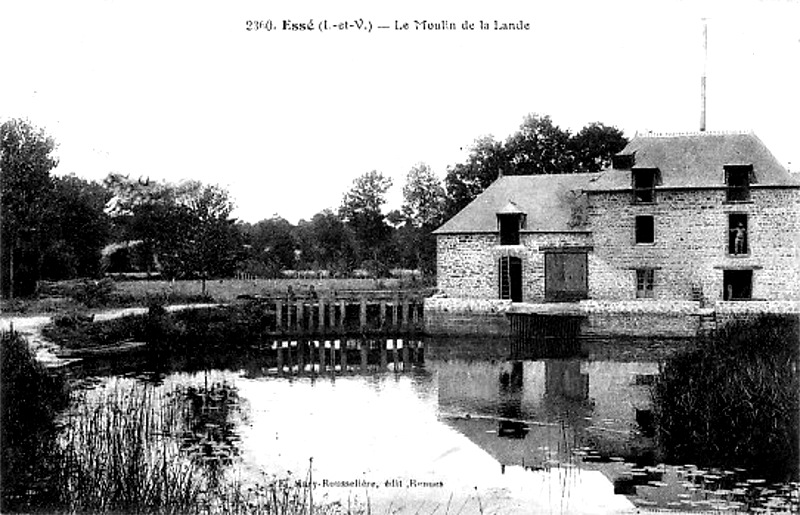
A signaler aussi :
![]() l'allée
couverte et les mégalithes situés à La Roche-aux-Fées (époque néolithique) ;
l'allée
couverte et les mégalithes situés à La Roche-aux-Fées (époque néolithique) ;
Nota : C'est un des plus grands monuments mégalithiques de France. Orienté Nord-Ouest-Sud-Est, il se compose de trente et une pierres formant assises et huit grosses pierres recouvrant l'allée qui est divisée en plusieurs chambres. On estime le poids de la plus grosse pierre à 45.000 kilogs. Elle doit mesurer de 5 à 6 mètres sur 2 mètres de largeur et 1 m. 50 à 2 m. 20 d'épaisseur. Ces pierres ont été équarrées pour former le monument d'une façon plus solide et plus stable. On dit qu'elles proviennent de la forêt du Theil, non loin de là. Des légendes qui entourent ce monument nous sont souvent évoquées avec beaucoup d'humour. Depuis celle de saint Armel et de son dragon, jusqu'à la pierre branlante témoignant de la fidélité conjugale (M. Bourde de la Rogerie, 1930).
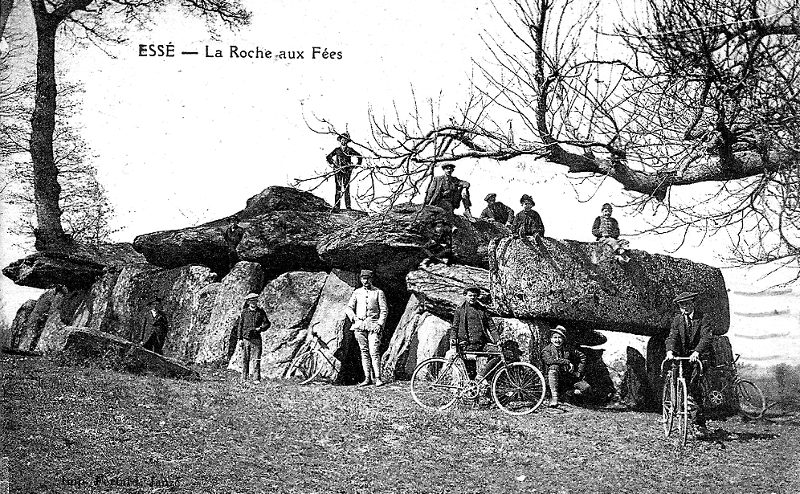
![]() l'ancienne
auberge des Trois-Chênes (vers 1656), située au bourg ;
l'ancienne
auberge des Trois-Chênes (vers 1656), située au bourg ;
![]() l'ancien
manoir de l'Arturais ;
l'ancien
manoir de l'Arturais ;
![]() l'ancien
manoir de Courgeon. Propriété de la famille Laurens en 1513 ;
l'ancien
manoir de Courgeon. Propriété de la famille Laurens en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Pironnière. Propriété de la famille Jarret en 1434 puis de la famille Morel en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Pironnière. Propriété de la famille Jarret en 1434 puis de la famille Morel en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de Lasse-Jambe. Il possédait autrefois une chapelle privative
dédiée à Sainte-Barbe et qui datait du XVIIème siècle. Luc Godart, seigneur des Loges et de Lasse-Jambe,
ayant perdu sa femme, Julienne Girault, construisit une chapelle près de
son manoir de Lasse-Jambe et la dédia à sainte Barbe. Puis, par acte du 3
septembre 1631, il y fonda deux messes par semaine, le dimanche et le samedi
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80 et 84 - Pouillé de
Rennes). Propriété successive des familles la Maudeyais
(en 1434), Godet (en 1513), Godart, seigneurs des Loges (en 1631) ;
l'ancien
manoir de Lasse-Jambe. Il possédait autrefois une chapelle privative
dédiée à Sainte-Barbe et qui datait du XVIIème siècle. Luc Godart, seigneur des Loges et de Lasse-Jambe,
ayant perdu sa femme, Julienne Girault, construisit une chapelle près de
son manoir de Lasse-Jambe et la dédia à sainte Barbe. Puis, par acte du 3
septembre 1631, il y fonda deux messes par semaine, le dimanche et le samedi
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80 et 84 - Pouillé de
Rennes). Propriété successive des familles la Maudeyais
(en 1434), Godet (en 1513), Godart, seigneurs des Loges (en 1631) ;
![]() l'ancien
manoir de la Trousselière. Sa chapelle privative datait de 1666. Dès 1434,
Jean Jarret possédait la Trousselière. Le 4 octobre 1666, Pierre Jarret,
également seigneur de la Trousselière, ayant fait bâtir une chapelle près
de ce manoir, la fonda de deux messes hebdomadaires (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80 - Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Jarret en 1434 et en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Trousselière. Sa chapelle privative datait de 1666. Dès 1434,
Jean Jarret possédait la Trousselière. Le 4 octobre 1666, Pierre Jarret,
également seigneur de la Trousselière, ayant fait bâtir une chapelle près
de ce manoir, la fonda de deux messes hebdomadaires (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80 - Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Jarret en 1434 et en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir du Rouvray. Il possédait une chapelle ruinée dès le XVIIème
siècle. En 1649, René de la Noë fonda deux messes, l'une en l'église d'Essé,
l'autre en la chapelle Sainte-Anne du Rouvray. En 1675, Anne du Rouvray,
dame dudit lieu et veuve de Luc Le Duc, seigneur du Petitbois, présenta
Julien Prodault pour desservir la chapellenie du Rouvray ; mais à cette époque
les deux messes se disaient en l'église d'Essé, parce que la chapelle du
manoir du Rouvray était ruinée (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Frade (en 1434), Morel (en
1513), du Rouvray (en 1539 et 1675), de Kerouan (à la fin du XVIIIème siècle) ;
l'ancien
manoir du Rouvray. Il possédait une chapelle ruinée dès le XVIIème
siècle. En 1649, René de la Noë fonda deux messes, l'une en l'église d'Essé,
l'autre en la chapelle Sainte-Anne du Rouvray. En 1675, Anne du Rouvray,
dame dudit lieu et veuve de Luc Le Duc, seigneur du Petitbois, présenta
Julien Prodault pour desservir la chapellenie du Rouvray ; mais à cette époque
les deux messes se disaient en l'église d'Essé, parce que la chapelle du
manoir du Rouvray était ruinée (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Frade (en 1434), Morel (en
1513), du Rouvray (en 1539 et 1675), de Kerouan (à la fin du XVIIIème siècle) ;
![]() l'ancien
manoir du Rozay. Propriété de la famille des Mottes en 1434 et de la famille Loysel en 1513 ;
l'ancien
manoir du Rozay. Propriété de la famille des Mottes en 1434 et de la famille Loysel en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir du Bois-Clérissay. Le manoir du Bois, appartenant en 1513 à
Bertrand Perrin, et appelé en 1768 le Bois-Clérissay, du nom d'un de ses
propriétaires, avait une chapelle fondée de messes, mais ruinée en 1768.
La fondation en était, à cause de cela, desservie à la chapelle de la
Coudre à cette dernière époque et valait alors 45 livres de rente
(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Perrin (en 1513), Clérissay, Montbourcher (en 1650) ;
l'ancien
manoir du Bois-Clérissay. Le manoir du Bois, appartenant en 1513 à
Bertrand Perrin, et appelé en 1768 le Bois-Clérissay, du nom d'un de ses
propriétaires, avait une chapelle fondée de messes, mais ruinée en 1768.
La fondation en était, à cause de cela, desservie à la chapelle de la
Coudre à cette dernière époque et valait alors 45 livres de rente
(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Perrin (en 1513), Clérissay, Montbourcher (en 1650) ;
![]() l'ancien
manoir de la Coudre. Il possédait autrefois une chapelle privative,
dédiée à Notre-Dame. Julien de Montalembert et Jeanne du Rouvray,
seigneur et dame de la Coudre et de la Rivière, demeurant à leur manoir de
la Coudre et y ayant fait bâtir une chapelle en l'honneur de la Sainte
Vierge, y fondèrent deux messes les dimanches et vendredis par acte du 20 décembre
1633. Ils donnèrent au chapelain le lieu de la Motte-Colombel et obtinrent
de l'ordinaire une approbation datée du 8 août 1634. En 1725, le recteur
d'Essé fit interdire cette chapelle, mais Guy de Lopriac, alors seigneur de
la Coudre, obtint de l'évêque sa réconciliation ; la cérémonie en fut
faite le 19 mars 1733 par M. Laumaillé, recteur du Theil, et l'on y
continua le service des deux messes fondées. Le premier chapelain de la
Coudre fut en 1634 Mathurin Geffroy, et le dernier Julien Hairault, pourvu
en 1768 (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80, 84 - Pouillé
de Rennes). Propriété successive des familles Loaisel (en 1434 et 1513), Montalembert
(en 1589 et 1633), de Lopriac (en 1725) ;
l'ancien
manoir de la Coudre. Il possédait autrefois une chapelle privative,
dédiée à Notre-Dame. Julien de Montalembert et Jeanne du Rouvray,
seigneur et dame de la Coudre et de la Rivière, demeurant à leur manoir de
la Coudre et y ayant fait bâtir une chapelle en l'honneur de la Sainte
Vierge, y fondèrent deux messes les dimanches et vendredis par acte du 20 décembre
1633. Ils donnèrent au chapelain le lieu de la Motte-Colombel et obtinrent
de l'ordinaire une approbation datée du 8 août 1634. En 1725, le recteur
d'Essé fit interdire cette chapelle, mais Guy de Lopriac, alors seigneur de
la Coudre, obtint de l'évêque sa réconciliation ; la cérémonie en fut
faite le 19 mars 1733 par M. Laumaillé, recteur du Theil, et l'on y
continua le service des deux messes fondées. Le premier chapelain de la
Coudre fut en 1634 Mathurin Geffroy, et le dernier Julien Hairault, pourvu
en 1768 (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80, 84 - Pouillé
de Rennes). Propriété successive des familles Loaisel (en 1434 et 1513), Montalembert
(en 1589 et 1633), de Lopriac (en 1725) ;
![]() l'ancien
manoir de la Morinière. Propriété de la famille Masson en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Morinière. Propriété de la famille Masson en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Tremblaye. Il possédait autrefois une chapelle privative.
Cette chapelle, dédiée à Sainte-Anne et bâtie auprès du manoir de la
Tremblaye, avait été fondée par la famille Mellet ; il en est fait
mention en 1747, quand M. Mellet de la Tremblaye fonda une autre chapelle
Sainte-Anne à Martigné, dont il était recteur. Le dernier chapelain de la
chapelle d'Essé fut, en 1787, M. Le Veyer de la Touche (Pouillé de Rennes).
Propriété de la famille Busson en 1434 et de la famille Mellet (en 1735) ;
l'ancien
manoir de la Tremblaye. Il possédait autrefois une chapelle privative.
Cette chapelle, dédiée à Sainte-Anne et bâtie auprès du manoir de la
Tremblaye, avait été fondée par la famille Mellet ; il en est fait
mention en 1747, quand M. Mellet de la Tremblaye fonda une autre chapelle
Sainte-Anne à Martigné, dont il était recteur. Le dernier chapelain de la
chapelle d'Essé fut, en 1787, M. Le Veyer de la Touche (Pouillé de Rennes).
Propriété de la famille Busson en 1434 et de la famille Mellet (en 1735) ;
![]() l'ancien
manoir de Maupérier. Propriété de la famille Mellet en 1513 ;
l'ancien
manoir de Maupérier. Propriété de la famille Mellet en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Griffardière. Propriété de la famille Jarret en 1434 et en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Griffardière. Propriété de la famille Jarret en 1434 et en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Bussonnais. Propriété de la famille Mellet en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Bussonnais. Propriété de la famille Mellet en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Touche-Bouëterel. Propriété de la famille Bouëtel en 1434 et de la famille Maudet (en 1513) ;
l'ancien
manoir de la Touche-Bouëterel. Propriété de la famille Bouëtel en 1434 et de la famille Maudet (en 1513) ;
![]() l'ancien
château du Loroux. Il possédait des douves, un colombier et un droit de
haute justice. Propriété de la famille la Feillée en 1434 et de la famille Rohan en 1513 ;
l'ancien
château du Loroux. Il possédait des douves, un colombier et un droit de
haute justice. Propriété de la famille la Feillée en 1434 et de la famille Rohan en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Boitelière. Propriété de la famille des Vaux en 1434 et en
1629, puis de la famille Beschais, seigneurs des Garmeaux en 1710 ;
l'ancien
manoir de la Boitelière. Propriété de la famille des Vaux en 1434 et en
1629, puis de la famille Beschais, seigneurs des Garmeaux en 1710 ;
![]() l'ancienne
maison Boitelière-Maudet. Propriété de la famille Maudet en 1513 ;
l'ancienne
maison Boitelière-Maudet. Propriété de la famille Maudet en 1513 ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE d'ESSE
La
montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à
Essé les nobles suivants :
" Jacques du Rouvray se présente
monté et armé pour Jacquette Moricet et Jehan du Rouvray ses
mère et frère aisné en estat d'archer. Et vérifie par serment ne tenir que
environ soixante livres de revenu en fief noble. Et requiert estre adjoinct
ovecques Guy Morel, Jacques de L'Ousche en son nom et tuteur des enffens myneurs
de feu Maistre Fronçoys de L'Ousche et Pierre de La Vallecte cy présentz en
robe. Il y sera pourveu comme de raison. Et ce pendant a esté ledict du Rouvray
receu. Et a faict le serment.
Maistre Luc Godard seigneur de Lasse Jambe se présente en robe. Et remonstre ses prédécesseurs de Lasse Jambe avoir acoustumé se monstrez en ladicte parrouesse. Et de présent ledict Godard estre il et Bertranne Godet sa compaigne demourans en ladicte ville de Rennes là où il entend se monstrer en armes par davant le capitayne pour le tout de son revenu noble qu'il déclarera. Suppliant y estre renvoyé. A esté ordonné que ladicte Godet aura acte de sa remonstrance.
Bertran Perrin seigneur du Boays se présente en robe et présente pour luy Jacques Perrin son filz monté et armé en estat d'archer. Et déclare ledict Bertran Perrin tenir en fié noble soixante cinq livres. Et demande pour adjoinct Rolland Mellet seigneur de La Tramblaye qui est présent et déclare tenir quatre vigns livres de rente, Jehan des Vaulx Bouestelière aussi présent qui déclare cinquante livres de rente. Et a ledict Bertran faict le serment.
Jehan Mellet se présente monté et armé en estat d'archer pour il et Rolland Mellet son frère. Et déclarent tenir lesdictz Mellet environ quatre vigns livres de rente. Et requièrent adjonction des nomméz en l'article cy davant. Et ont lesdictz Mellet faict le serment.
Jehan des Vaulx Bouestelière se présente monté et armé en estat d'archer, disant par cy davant Anthoyne Lorans luy avoir esté baillé pour adjoinct. Lequel depuix a vendu sa terre, et par ce moyen n'avoir plus de ayde dudict Lorans. Suppliant luy estre pourveu d'aultres adjoinctz, sçavoir ledict Bertran Perrin et aultres dénommez et requis par ledict Perrin. Et a déclaré comme davant tenir L livres rente.
Artuz Loaysel seigneur du Rozay se présente monté et armé en estat d'archer. Et a présenté sa déclaracion qui contient environ XXXII livres de rente et la vériffie véritable. Et dit se présentez aussi pour Françoys Morel l'Abbaye [Note : Manoir de l'Abbaye, en Bais] présent qui confesse trèze livres dix soulz de rente. Et requiert pour adjoinctz Françoys Morel Plesseix [Note : Manoir du Plessis-Beaume ou du Plessis-Morel, en Le Theil-de-Bretagne] et Me Guillaume Godet et ses adjoinctz. Et a faict le serment.
Thommas Maudet Tramblaye se présente monté et armé en
estat d'archer. Et dit tenir noblement quarante livres de rente. Et le revenu de
Françoys de L'Espinay cy davant luy adjoinct valloir environ quarante ouict livres
de rente. Et remonstre Jehanne du Boayspéan sa mère estre morte et décebdée. Et
ses facultéz et richesses estre allées en aultres mains.
Requérant aultres
adjoinctz, sçavoir Bertran Perrin Le Boays, le seigneur de La Bouestelière cy
davant nommé. Et a faict le serment.
Maistre Françoys Mellet aura acte de ce qu'il a dict estre de la ville et avoir cy davant esté renvoyé à la monstre de [ladicte] ville et supplye y estre uncore renvoyé. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.