|
Bienvenue chez les Coverois |
LA COUYERE |
Retour page d'accueil Retour Canton du Sel-de-Bretagne
La commune de
La Couyère ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LA COUYERE
La Couyère vient, semble-t-il, de Couyer ou Coyer.
L'histoire de La Couyère est liée au château du Plessis et au manoir du Bois-Hamon, propriétés de François Gardin au XVIIème siècle.
Nous ne trouvons mention de la paroisse de La Couyère qu'au XIIIème siècle, lorsqu'en 1240 Geoffroy de Pouencé, seigneur de la Guerche, dote sa fille Thomasse en la mariant à André, baron de Vitré. Le seigneur de la Guerche donne, entre autres choses, à sa fille tout ce qu'il possède dans le bourg et la paroisse de La Couyère "in burgo et parrochia de Coheria" (D. Morice Preuves de l'Histoire de Bretagne, I. 917).
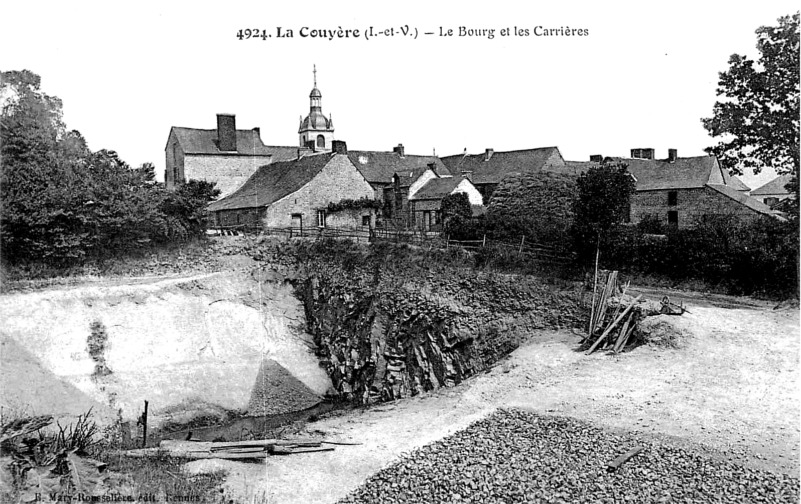
La Couyère était jadis divisée en quatre traits : le Bourg, la Tétardière, la Rimbergère et le Chahin. Le recteur, à la présentation de l'ordinaire, était grand décimateur dans sa paroisse, comme le prouve un long règlement arrêté en 1752 par le Parlement de Bretagne en faveur de la fabrique de La Couyère. Le rôle diocésain ms. de 1646 dit qu'à cette époque le recteur de La Couyère avait au moins 800 livres de rente. La paroisse de La Couyère dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.
On rencontre l'appellation Coheria en 1240.
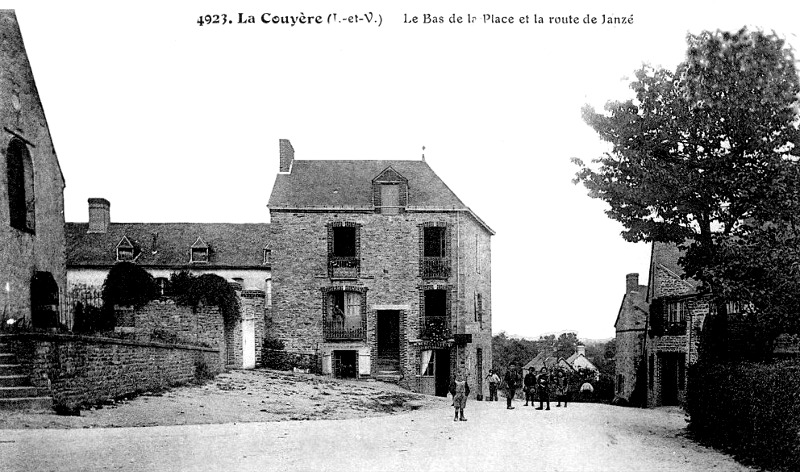
Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de La Couyère : N... Hurel (nous ne savons quand vivait ce recteur, mais il fonda une messe chaque samedi dans son église paroissiale ; cette chapellenie, dite des Hureaux, est mentionnée en 1646). N... Phelippé (il paraît en 1617 ; décédé en 1631 et inhumé dans l'église). René Ermyne (originaire de Brie, pourvu en 1632, il résigna en faveur du suivant). Pierre Chappel (il fut nommé vers 1664 ; décédé en 1688). N... Picoul (1688-1689). Julien Jarry (prêtre de la paroisse, il fut pourvu vers 1689 et fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'azur à trois canards d'argent, posés 2, 1. Il se démit en 1725). Julien Prevel (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 19 avril 1725 ; décédé en 1751). Joseph Desgrées (prêtre du diocèse, il fut nommé le 28 juillet 1751 ; décédé en 1754). Pierre Fontaine (prêtre de Rennes, pourvu le 26 août 1754, décédé le 22 juillet 1788 au presbytère de Thourie, il fut inhumé le lendemain dans le cimetière de La Couyère). René Chaussonnière (il fut nommé le 17 décembre 1788 ; décédé le 23 mai 1789). Thomas Aulnette (vicaire à Bais, pourvu le 2 septembre 1789, il prit possession le lendemain, émigra, dit-on, à la Révolution, puis rentra à La Couyère et se retira en 1803 à Saint-Briac, où il mourut). Joseph-Marie Bercegeay (1803, décédé en 1813). N... Cotterel (1813-1819). Antoine-François Legendre (1820-1827). Julien-Jean Poulier (1827-1858). Julien Escolan (1858, décédé en 1860). Georges Bagourd (à partir de 1860), ....

Voir
![]() "
Le
cahier de doléances de La Couyère en 1789
".
"
Le
cahier de doléances de La Couyère en 1789
".
![]()
PATRIMOINE de LA COUYERE
![]() l'église
Notre-Dame (XVII-XIXème siècle). Cette église est signalée en 1240 puis
reconstruite au XVIIème ou au XVIIIème siècle et transformée en 1835.
L'église se composait primitivement d'une simple nef, d'un coeur et d'une chapelle
dédiée à Sainte Anne : la nef seule subsiste. Le choeur a été refait et deux chapelles ont
été construites en 1835. Dans le choeur se trouvaient l'enfeu et le banc
des seigneurs du Plessix. C'est dans cet enfeu que sont successivement
inhumés René Bonnier en 1649, Pierre Bonnier en 1653, Pierre de la
Chévière en 1682, etc ..., tous seigneurs du Boishamon, résidant au
manoir du Plessix. Ils se disaient, en effet, seigneurs fondateurs et
prééminenciers de l'église de La Couyère, mais la supériorité
appartenait au baron de Poligné, de qui relevaient le Boishamon et le
Plessix, et qui prétendait même en 1679 à tous les droits de
prééminences et de fondation de La Couyère (Archives Nationales, P. 1710).
Au-dessus de l'autel majeur était un grand écusson : d'azur à trois
gerbes de blé d'or, qui est Gardin, et sur le banc du Plessix était
cet autre écu : d'azur au sautoir d'or, accompagné de quatre billettes
de même, qui est de Langle. Au milieu du siècle dernier, en effet,
Claude de Langle, seigneur de Coëtuhan, avait épousé Thérèse Gardin,
dame du Boishamon et du Plessix. L'église
renfermait aussi les tombes ou enfeus des seigneurs de la Nourière (ou
Norière), de la Ville-Oger et du Jaulna, principalement dans la chapelle
Sainte-Anne. Concernant les les seigneurs et dame de la Norière, on trouve
les tombes de Louis Le Lardeux (décédé en 1651), Nicolas Le Lardeux
(décédé en 1655) et Georgine de Châteaugiron (décédée en 1659).
Concernant les seigneurs et dame de la Ville-Oger, on trouve les tombes de
Pierre de Guénour (décédé en 1621) et Renée du Houssay (décédée en
1627). On trouve aussi les tombes de Briant de Châteaugiron, seigneur de la
Garenne (décédé en 1668), Françoise de la Tullaye (décédée en 1659), etc... ;
l'église
Notre-Dame (XVII-XIXème siècle). Cette église est signalée en 1240 puis
reconstruite au XVIIème ou au XVIIIème siècle et transformée en 1835.
L'église se composait primitivement d'une simple nef, d'un coeur et d'une chapelle
dédiée à Sainte Anne : la nef seule subsiste. Le choeur a été refait et deux chapelles ont
été construites en 1835. Dans le choeur se trouvaient l'enfeu et le banc
des seigneurs du Plessix. C'est dans cet enfeu que sont successivement
inhumés René Bonnier en 1649, Pierre Bonnier en 1653, Pierre de la
Chévière en 1682, etc ..., tous seigneurs du Boishamon, résidant au
manoir du Plessix. Ils se disaient, en effet, seigneurs fondateurs et
prééminenciers de l'église de La Couyère, mais la supériorité
appartenait au baron de Poligné, de qui relevaient le Boishamon et le
Plessix, et qui prétendait même en 1679 à tous les droits de
prééminences et de fondation de La Couyère (Archives Nationales, P. 1710).
Au-dessus de l'autel majeur était un grand écusson : d'azur à trois
gerbes de blé d'or, qui est Gardin, et sur le banc du Plessix était
cet autre écu : d'azur au sautoir d'or, accompagné de quatre billettes
de même, qui est de Langle. Au milieu du siècle dernier, en effet,
Claude de Langle, seigneur de Coëtuhan, avait épousé Thérèse Gardin,
dame du Boishamon et du Plessix. L'église
renfermait aussi les tombes ou enfeus des seigneurs de la Nourière (ou
Norière), de la Ville-Oger et du Jaulna, principalement dans la chapelle
Sainte-Anne. Concernant les les seigneurs et dame de la Norière, on trouve
les tombes de Louis Le Lardeux (décédé en 1651), Nicolas Le Lardeux
(décédé en 1655) et Georgine de Châteaugiron (décédée en 1659).
Concernant les seigneurs et dame de la Ville-Oger, on trouve les tombes de
Pierre de Guénour (décédé en 1621) et Renée du Houssay (décédée en
1627). On trouve aussi les tombes de Briant de Châteaugiron, seigneur de la
Garenne (décédé en 1668), Françoise de la Tullaye (décédée en 1659), etc... ;

![]() l'ancienne
chapelle Saint-Denis du Boishamon, aujourd'hui disparue. Les seigneurs du
Bois-Hamon (ou Boishamon) fondèrent de deux messes par semaine la chapelle
de leur manoir. Le chapelain Thomas Pâris étant mort, Pierre Bonnier,
seigneur de la Coquerie et du Boishamon, présenta pour le remplacer Louis
Duguéret, qu'accepta l'évêque en 1617 (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 9G, 14). Les messes fondées se disaient alors partie en
cette chapelle, partie à Janzé. Mais quand les seigneurs du Boishamon
vinrent habiter le Plessix, ils transférèrent leur fondation dans la chapelle du Plessix ;
l'ancienne
chapelle Saint-Denis du Boishamon, aujourd'hui disparue. Les seigneurs du
Bois-Hamon (ou Boishamon) fondèrent de deux messes par semaine la chapelle
de leur manoir. Le chapelain Thomas Pâris étant mort, Pierre Bonnier,
seigneur de la Coquerie et du Boishamon, présenta pour le remplacer Louis
Duguéret, qu'accepta l'évêque en 1617 (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 9G, 14). Les messes fondées se disaient alors partie en
cette chapelle, partie à Janzé. Mais quand les seigneurs du Boishamon
vinrent habiter le Plessix, ils transférèrent leur fondation dans la chapelle du Plessix ;
![]() la
chapelle du Plessix (XVIIème siècle). Olivier Gardin, archidiacre du
Désert, habitant le Plessix de La Couyère en 1690, pourrait bien être le
fondateur de cette chapelle, dont il desservit les messes jusqu'à sa mort,
arrivée vers 1719. A cette époque, Gilles Gardin, seigneur du Plessix,
présenta pour le remplacer Jean Demé, qui eut pour successeurs N...
Faligot, puis Jean Noroy en 1746. Cette chapelle renferme les tombeaux
modernes du marquis de Langle et de la marquise sa femme, née de Ghaisme de
Bourmont, propriétaires du Plessix ;
la
chapelle du Plessix (XVIIème siècle). Olivier Gardin, archidiacre du
Désert, habitant le Plessix de La Couyère en 1690, pourrait bien être le
fondateur de cette chapelle, dont il desservit les messes jusqu'à sa mort,
arrivée vers 1719. A cette époque, Gilles Gardin, seigneur du Plessix,
présenta pour le remplacer Jean Demé, qui eut pour successeurs N...
Faligot, puis Jean Noroy en 1746. Cette chapelle renferme les tombeaux
modernes du marquis de Langle et de la marquise sa femme, née de Ghaisme de
Bourmont, propriétaires du Plessix ;
![]() l'ancienne
croix du cimetière, en schiste et armoriée, située devant l'église ;
l'ancienne
croix du cimetière, en schiste et armoriée, située devant l'église ;
![]() l'ancien
manoir du Boishamon ou Bois-Hamon (XVème siècle), situé route de Janzé.
Le manoir et la seigneurie relevaient partie de la baronnie de Poligné et
partie de la châtellenie du Désert. Cette maison donna son nom à une
noble et ancienne famille alliée à celle de la Marzelière par le mariage
d'Amette du Boishamon, dame dudit lieu, de la Touche-Huet, en la Mézière,
et de Montgerval, en Gévezé, veuve de Jean de Beaumanoir, vicomte du Besso,
qui épousa en secondes noces Pierre de la Marzelière, seigneur dudit lieu,
en Bain, et décédé en 1462. Le manoir possédait jadis une chapelle privée.
Propriété successive des seigneurs du Boishamon (en 1427), de la Marzelière (au XVème siècle et en
1513), Bonnier seigneurs de la Coquerie (en 1617 et en 1649), de la
Chevière (en 1670), François Gardin seigneur de Lestrillay (en 1685), de
Langle seigneurs de Coëthulan (au XVIIIème siècle), Gardin du Boisduliers
(au XIXème siècle). Les du Boishamon, semblent être un ramage de la
famille de Saulnières. Au XIVème siècle, Olivier de Saulnières épousa
Marquize du Boishamon. Olivier du Boishamon jura en 1379 l'association des
seigneurs bretons ligués contre l'invasion étrangère, et en 1427 Georges
du Boishamon possédait le manoir de ce nom. Au XVIème siècle, le
Boishamon appartenait à la famille de la Marzelière, probablement par
suite de l'alliance mentionnées plus haut. En 1503, Arthur de la
Marzelière, seigneur dudit lieu et du Boishamon, petit-fils d'Amette du
Boishamon, reconnut que partie de sa seigneurie du Boishamon relevait de la
châtellenie du Désert. En 1513, Pierre de la Marzelière, écuyer,
possédait le manoir du Boishamon (Réformation de la noblesse). Vinrent
ensuite les Bonnier. En 1617, Pierre Bonnier, seigneur de la Coquerie, en
Saint-Aubin-des-Châteaux, était propriétaire de la seigneurie et du
manoir du Boishamon et mourut en 1653. René Bonnier, seigneur du Boishamon,
mourut le 9 novembre 1649. La famille de la Chevière suivit. Jean François
de la Chevière est décédé le 1er janvier 1670 au Boishamon, que
possédait alors Pierre de la Chevière, seigneur du Boishamon, et Gilonne
de Boisadam, sa femme. En 1679, ce Pierre de la Chevière reconnut "tenir
et relever de la baronnie de Poligné les maisons et métairies du Boishamon
et de la Ville, avec les maison, métairie et dépendances du Plessix et La
Couyère" (Archives départementales de Loire-Inférieure, baronnie
de Poligné). François Gardin, seigneur de Lestrillay, en Bruz, était en
1685 seigneur du Boishamon et du Plessix de La Couyère. Ce dernier avait
épousé Catherine Le Ray, qui lui apporta, semble-t-il, ces deux dernières
seigneuries. Gilles Gardin, était en 1719 seigneur du Plessix et du
Boishamon, et était marié à Renée Tranchant du Tret. De leur temps
vivaient Olivier Gardin, archidiacre du Désert, et Godefroy Gardin, qui
remplaça celui-ci en 1715 dans l'archidiaconat du Désert et qui mourut
chanoine de Rennes en 1755. En 1745 vivaient Jean Guy Gardin, seigneur du
Boishamon, et Sainte-Louise du Boispéan, sa femme, mais ils habitaient
alors la Séguintière, en Martigné-Ferchaud (Registre de l'état civil de La Couyère) ;
l'ancien
manoir du Boishamon ou Bois-Hamon (XVème siècle), situé route de Janzé.
Le manoir et la seigneurie relevaient partie de la baronnie de Poligné et
partie de la châtellenie du Désert. Cette maison donna son nom à une
noble et ancienne famille alliée à celle de la Marzelière par le mariage
d'Amette du Boishamon, dame dudit lieu, de la Touche-Huet, en la Mézière,
et de Montgerval, en Gévezé, veuve de Jean de Beaumanoir, vicomte du Besso,
qui épousa en secondes noces Pierre de la Marzelière, seigneur dudit lieu,
en Bain, et décédé en 1462. Le manoir possédait jadis une chapelle privée.
Propriété successive des seigneurs du Boishamon (en 1427), de la Marzelière (au XVème siècle et en
1513), Bonnier seigneurs de la Coquerie (en 1617 et en 1649), de la
Chevière (en 1670), François Gardin seigneur de Lestrillay (en 1685), de
Langle seigneurs de Coëthulan (au XVIIIème siècle), Gardin du Boisduliers
(au XIXème siècle). Les du Boishamon, semblent être un ramage de la
famille de Saulnières. Au XIVème siècle, Olivier de Saulnières épousa
Marquize du Boishamon. Olivier du Boishamon jura en 1379 l'association des
seigneurs bretons ligués contre l'invasion étrangère, et en 1427 Georges
du Boishamon possédait le manoir de ce nom. Au XVIème siècle, le
Boishamon appartenait à la famille de la Marzelière, probablement par
suite de l'alliance mentionnées plus haut. En 1503, Arthur de la
Marzelière, seigneur dudit lieu et du Boishamon, petit-fils d'Amette du
Boishamon, reconnut que partie de sa seigneurie du Boishamon relevait de la
châtellenie du Désert. En 1513, Pierre de la Marzelière, écuyer,
possédait le manoir du Boishamon (Réformation de la noblesse). Vinrent
ensuite les Bonnier. En 1617, Pierre Bonnier, seigneur de la Coquerie, en
Saint-Aubin-des-Châteaux, était propriétaire de la seigneurie et du
manoir du Boishamon et mourut en 1653. René Bonnier, seigneur du Boishamon,
mourut le 9 novembre 1649. La famille de la Chevière suivit. Jean François
de la Chevière est décédé le 1er janvier 1670 au Boishamon, que
possédait alors Pierre de la Chevière, seigneur du Boishamon, et Gilonne
de Boisadam, sa femme. En 1679, ce Pierre de la Chevière reconnut "tenir
et relever de la baronnie de Poligné les maisons et métairies du Boishamon
et de la Ville, avec les maison, métairie et dépendances du Plessix et La
Couyère" (Archives départementales de Loire-Inférieure, baronnie
de Poligné). François Gardin, seigneur de Lestrillay, en Bruz, était en
1685 seigneur du Boishamon et du Plessix de La Couyère. Ce dernier avait
épousé Catherine Le Ray, qui lui apporta, semble-t-il, ces deux dernières
seigneuries. Gilles Gardin, était en 1719 seigneur du Plessix et du
Boishamon, et était marié à Renée Tranchant du Tret. De leur temps
vivaient Olivier Gardin, archidiacre du Désert, et Godefroy Gardin, qui
remplaça celui-ci en 1715 dans l'archidiaconat du Désert et qui mourut
chanoine de Rennes en 1755. En 1745 vivaient Jean Guy Gardin, seigneur du
Boishamon, et Sainte-Louise du Boispéan, sa femme, mais ils habitaient
alors la Séguintière, en Martigné-Ferchaud (Registre de l'état civil de La Couyère) ;
![]() le
château du Plessix (XVIIIème siècle). Propriété successive des seigneurs du Plessis (en 1427),
d'Hélène du Houx, veuve de Jean Godart (en 1513), de Guénour (en 1516),
de Juzel (en 1541), du Hallay (en 1672), de la Chevière (en 1679), Gardin
seigneurs de Lestrillay (en 1685), de Langle (au milieu du XVIIIème
siècle). Il relevait jadis de la baronnie de
Poligné. Le château primitif appartenait en 1427 à Jean du Plessix, et en
1513 à Hélène du Houx, veuve de Jean Godart. En 1516, Jean de Guénour se
disait seigneur du Plessix de La Couyère. En 1541, N... de Juzel, seigneur
du Plessix de La Couyère, tenait du seigneur de Poligné "ledit
lieu du Plessix, contenant par fonds environ 70 journaux de terre, et un
bailliage en ladite paroisse de La Couyère, et vault le tout de rente 30
livres". Le 23 août 1672 fut inhumé dans l'église de La Couyère
Jean du Hallay, seigneur du Bois-Macé, en Retiers, décédé au Plessix,
qu'il habitait. Paul du Hallay et Perrine Morin, seigneur et dame du Plessix,
eurent plusieurs enfants baptisés à La Couyère, mais ils habitaient le
bourg de La Couyère, où ils moururent, Perrine Morin en 1689 et Paul du
Hallay en 1690. Le manoir du Plessix appartenait, en effet, dès 1679 à
Pierre de la Chevière, qui en rendit aveu au baron de Poligné. En 1682
mourut à Lieuron, le 15 octobre, "écuyer Pierre de la Chevière,
seigneur dudit lieu, âgé de 37 ans, faisant sa résidence ordinaire à sa
maison du Plessix, paroisse de La Couyère". Il fut inhumé dans
l'église de La Couyère le 17 octobre. François Gardin, sieur de
Lestrillay, possédait à la fois en 1685 le Plessix et le Boishamon. Sa
femme, Catherine Le Ray, séparée de biens d'avec son mari, sollicita en
1697 et obtint des lettres d'union, "sous le titre de seigneurie du
Plessix de La Couyère, des terres et fiefs du Plessix, le Boishamon, la
Verdière et la Ville-Oger, s'étendant dans les paroisses de La Couyère et
de Janzé" (Archives Nationales, B. 1254, 1715). En 1690, Olivier
Gardin, archidiacre du Désert, habitait le manoir du Plessix. Le château actuel est édifié vers 1725 par Gilles
Gardin, seigneur du Bois-Hamon, directeur de l'hôtel des monnaies de
Bretagne. Il devient, par alliance, la propriété de la famille de Langle
de Coëtuhan en 1730. En effet, Gilles Gardin, seigneur du Boishamon et du
Plessix, épouse Renée Tranchant du Tret. Leur fille, Bonne-Thérèse
Gardin, s'allie à Claude Marie de Langle, seigneur de Coëtuhan, paroisse
de Noyal-Pontivy, conseiller et plus tard président au Parlement de
Bretagne. En 1738, Renée Tranchant du Tret est veuve et possède à Rennes,
avec son gendre et sa fille, M. et Mme de Langle, l'hôtel du Boishamon, sis
rue de la Monnaie. En 1750, Mme du Boishamon vit encore : on lui attribue
vers 1735 un revenu de 1 000 livres en biens fonds dans la paroisse de La
Couyère. Toutefois, le Plessix est en 1746 la propriété de Claude Pélage
Gardin, seigneur du Plessix, car c'est lui qui présente à l'évêque à
cette époque Jean Noroy, clerc tonsuré de Tréguer, pour remplacer M.
Faligot comme chapelain du Plessix (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine). En 1771, Louis Guy de Langle, seigneur de Coëtuhan, du
Plessix de La Couyère, est, comme l'a été son père, président au
Parlement de Bretagne. Il est, semble-t-il, le dernier seigneur du Plessix.
Vers 1860, Bertrand de Langle, marquis et pair de
France, entreprend d'importants travaux. On y trouve une chapelle privative à clocheton construite en 1710.
Le retable de la chapelle date de 1725. Par lettres patentes du 6 octobre
1827, Charles X érige en majorat la terre du Plessix de La Couyère et
crée marquis M. Marie Fidèle de Langle, époux d'Ernestine de Ghaisne de
Bourmont. Leur fils, M. Bertrand Marie Fidèle marquis de Langle, marié à
Mlle de la Briffe, possède et habite le Plessix (L'Ouest aux Croisades, II, 99) ;
le
château du Plessix (XVIIIème siècle). Propriété successive des seigneurs du Plessis (en 1427),
d'Hélène du Houx, veuve de Jean Godart (en 1513), de Guénour (en 1516),
de Juzel (en 1541), du Hallay (en 1672), de la Chevière (en 1679), Gardin
seigneurs de Lestrillay (en 1685), de Langle (au milieu du XVIIIème
siècle). Il relevait jadis de la baronnie de
Poligné. Le château primitif appartenait en 1427 à Jean du Plessix, et en
1513 à Hélène du Houx, veuve de Jean Godart. En 1516, Jean de Guénour se
disait seigneur du Plessix de La Couyère. En 1541, N... de Juzel, seigneur
du Plessix de La Couyère, tenait du seigneur de Poligné "ledit
lieu du Plessix, contenant par fonds environ 70 journaux de terre, et un
bailliage en ladite paroisse de La Couyère, et vault le tout de rente 30
livres". Le 23 août 1672 fut inhumé dans l'église de La Couyère
Jean du Hallay, seigneur du Bois-Macé, en Retiers, décédé au Plessix,
qu'il habitait. Paul du Hallay et Perrine Morin, seigneur et dame du Plessix,
eurent plusieurs enfants baptisés à La Couyère, mais ils habitaient le
bourg de La Couyère, où ils moururent, Perrine Morin en 1689 et Paul du
Hallay en 1690. Le manoir du Plessix appartenait, en effet, dès 1679 à
Pierre de la Chevière, qui en rendit aveu au baron de Poligné. En 1682
mourut à Lieuron, le 15 octobre, "écuyer Pierre de la Chevière,
seigneur dudit lieu, âgé de 37 ans, faisant sa résidence ordinaire à sa
maison du Plessix, paroisse de La Couyère". Il fut inhumé dans
l'église de La Couyère le 17 octobre. François Gardin, sieur de
Lestrillay, possédait à la fois en 1685 le Plessix et le Boishamon. Sa
femme, Catherine Le Ray, séparée de biens d'avec son mari, sollicita en
1697 et obtint des lettres d'union, "sous le titre de seigneurie du
Plessix de La Couyère, des terres et fiefs du Plessix, le Boishamon, la
Verdière et la Ville-Oger, s'étendant dans les paroisses de La Couyère et
de Janzé" (Archives Nationales, B. 1254, 1715). En 1690, Olivier
Gardin, archidiacre du Désert, habitait le manoir du Plessix. Le château actuel est édifié vers 1725 par Gilles
Gardin, seigneur du Bois-Hamon, directeur de l'hôtel des monnaies de
Bretagne. Il devient, par alliance, la propriété de la famille de Langle
de Coëtuhan en 1730. En effet, Gilles Gardin, seigneur du Boishamon et du
Plessix, épouse Renée Tranchant du Tret. Leur fille, Bonne-Thérèse
Gardin, s'allie à Claude Marie de Langle, seigneur de Coëtuhan, paroisse
de Noyal-Pontivy, conseiller et plus tard président au Parlement de
Bretagne. En 1738, Renée Tranchant du Tret est veuve et possède à Rennes,
avec son gendre et sa fille, M. et Mme de Langle, l'hôtel du Boishamon, sis
rue de la Monnaie. En 1750, Mme du Boishamon vit encore : on lui attribue
vers 1735 un revenu de 1 000 livres en biens fonds dans la paroisse de La
Couyère. Toutefois, le Plessix est en 1746 la propriété de Claude Pélage
Gardin, seigneur du Plessix, car c'est lui qui présente à l'évêque à
cette époque Jean Noroy, clerc tonsuré de Tréguer, pour remplacer M.
Faligot comme chapelain du Plessix (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine). En 1771, Louis Guy de Langle, seigneur de Coëtuhan, du
Plessix de La Couyère, est, comme l'a été son père, président au
Parlement de Bretagne. Il est, semble-t-il, le dernier seigneur du Plessix.
Vers 1860, Bertrand de Langle, marquis et pair de
France, entreprend d'importants travaux. On y trouve une chapelle privative à clocheton construite en 1710.
Le retable de la chapelle date de 1725. Par lettres patentes du 6 octobre
1827, Charles X érige en majorat la terre du Plessix de La Couyère et
crée marquis M. Marie Fidèle de Langle, époux d'Ernestine de Ghaisne de
Bourmont. Leur fils, M. Bertrand Marie Fidèle marquis de Langle, marié à
Mlle de la Briffe, possède et habite le Plessix (L'Ouest aux Croisades, II, 99) ;
Note : Ce joli château du Plessis émerge des bois environnants tel une de ces « folies » nées du caprice des grands seigneurs. Il fut construit en 1724 par Gilles Gardin du Bois-Hamon qui le légua à sa fille dont un des descendants, M. de Langle, en est toujours propriétaire. La façade côté parc, la plus gracieuse, est typique de l'époque Louis XV avec son avant-corps central surmonté d'un fronton mais elle a été remaniée récemment. L'intérieur de ce château est un véritable musée ! Belles boiseries datant de l'époque du château avec encadrement de peintures, très beau mobilier, objets d'art de grande valeur. Le Plessis est entouré d'un jardin à la française et d'un grand parc boisé avec étangs. Une chapelle et un petit bâtiment d'orangerie sont accolés au château. (D. Robet).

![]() la
ferme (XIXème siècle), située près du château de Plessix. Il s'agit de
l'ancienne maison du régisseur du château du Plessix ;
la
ferme (XIXème siècle), située près du château de Plessix. Il s'agit de
l'ancienne maison du régisseur du château du Plessix ;
![]() le
puits (XVIII-XXème siècle), situé près de l'ancien presbytère occupé
aujourd'hui par la mairie ;
le
puits (XVIII-XXème siècle), situé près de l'ancien presbytère occupé
aujourd'hui par la mairie ;
![]() 2 moulins
à eau : Neuf et d'Abas ;
2 moulins
à eau : Neuf et d'Abas ;
A signaler aussi :
![]() l'ancien
manoir de la Ville-Oger, situé route de Janzé. Jean de Saulnières, maire de Vitré, est en 1427
seigneur de la Ville-Oger. A la même époque vit Raoul de la Ville-Oger,
fils naturel de feu Georges de Saulnières, seigneur de la Ville-Oger,
paroissien de Lalleu et "exercant alors la guerre". Le 30 mars
1461, Jean de Saulnières rend aveu pour sa seigneurie de la Ville-Oger. La
famille de Guénour devient ensuite propriétaire de la Ville-Oger,
probablement par suite des alliances contractées par Yvon de Guénour, qui
veuf de Robine Mauhugeon, épouse vers 1440 Jeanne de Saulnières, et de
Perrine de Guénour, qui est mariée dés 1427 avec Olivier de Saulnières.
Aussi, en 1474 Robert de Guénour, et en 1513 Pierre de Guénour sont ils
seigneurs de la Ville-Oger. Le 26 novembre 1621 est inhumé en l'église de
La Couyère Pierre de Guénour, seigneur de la Ville-Oger, mort assassiné.
Dans la même église reçoivent la sépulture : Renée du Houssay, femme du
seigneur de la Ville-Oger, morte en 1627, et Jacqueline de Garmeaux, dame de
la Ville-Oger, morte en 1672 à la Ville-Oger qu'elle habitait. En 1697,
Catherine Le Ray, femme séparée de biens de Francois Gardin, seigneur du
Boishamon, fait unir la terre et le fief de la Ville-Oger à la seigneurie
du Plessix de la Couyère (Château de La Couyère). La Ville-Oger est au
XIXème siècle une ferme appartenant à la famille Gardin du Boisduliers ;
l'ancien
manoir de la Ville-Oger, situé route de Janzé. Jean de Saulnières, maire de Vitré, est en 1427
seigneur de la Ville-Oger. A la même époque vit Raoul de la Ville-Oger,
fils naturel de feu Georges de Saulnières, seigneur de la Ville-Oger,
paroissien de Lalleu et "exercant alors la guerre". Le 30 mars
1461, Jean de Saulnières rend aveu pour sa seigneurie de la Ville-Oger. La
famille de Guénour devient ensuite propriétaire de la Ville-Oger,
probablement par suite des alliances contractées par Yvon de Guénour, qui
veuf de Robine Mauhugeon, épouse vers 1440 Jeanne de Saulnières, et de
Perrine de Guénour, qui est mariée dés 1427 avec Olivier de Saulnières.
Aussi, en 1474 Robert de Guénour, et en 1513 Pierre de Guénour sont ils
seigneurs de la Ville-Oger. Le 26 novembre 1621 est inhumé en l'église de
La Couyère Pierre de Guénour, seigneur de la Ville-Oger, mort assassiné.
Dans la même église reçoivent la sépulture : Renée du Houssay, femme du
seigneur de la Ville-Oger, morte en 1627, et Jacqueline de Garmeaux, dame de
la Ville-Oger, morte en 1672 à la Ville-Oger qu'elle habitait. En 1697,
Catherine Le Ray, femme séparée de biens de Francois Gardin, seigneur du
Boishamon, fait unir la terre et le fief de la Ville-Oger à la seigneurie
du Plessix de la Couyère (Château de La Couyère). La Ville-Oger est au
XIXème siècle une ferme appartenant à la famille Gardin du Boisduliers ;
![]() l'ancien
manoir de la Vigne, situé route de Janzé et aujourd'hui disparu. Propriété de la famille de
Châteaugiron au XVIIème siècle. Le 25 décembre 1668 est inhumé en
l'église de La Couyère Briand de Châteaugiron, écuyer, sieur de la
Garenne. En 1670 est baptisé à La Couyère un enfant né de Jacques de
Châteaugiron et de Thomasse Orain. Etienne de Châteaugiron, seigneur du
Jaulnay, en Châteaugiron, épouse Renée des Loges, dont il a en 1679
François René, qui est nommé par François de Châteaugiron, se disant
seigneur dudit lieu. Ces deux époux habitent la Vigne, où ils ont eu
plusieurs autres enfants. Renée des Loges y meurt et est inhumée le 23
juillet 1685 en l'église de La Couyère. François René de Châteaugiron,
seigneur de la Miotière, fils des précédents, se marie à Tourie le 6
mars 1711 avec Marie Anne Lambert, dame de Lorgeril ;
l'ancien
manoir de la Vigne, situé route de Janzé et aujourd'hui disparu. Propriété de la famille de
Châteaugiron au XVIIème siècle. Le 25 décembre 1668 est inhumé en
l'église de La Couyère Briand de Châteaugiron, écuyer, sieur de la
Garenne. En 1670 est baptisé à La Couyère un enfant né de Jacques de
Châteaugiron et de Thomasse Orain. Etienne de Châteaugiron, seigneur du
Jaulnay, en Châteaugiron, épouse Renée des Loges, dont il a en 1679
François René, qui est nommé par François de Châteaugiron, se disant
seigneur dudit lieu. Ces deux époux habitent la Vigne, où ils ont eu
plusieurs autres enfants. Renée des Loges y meurt et est inhumée le 23
juillet 1685 en l'église de La Couyère. François René de Châteaugiron,
seigneur de la Miotière, fils des précédents, se marie à Tourie le 6
mars 1711 avec Marie Anne Lambert, dame de Lorgeril ;
![]() l'ancien
manoir de la Nourière (ou Norière), situé route de Janzé. Propriété successive des
familles Guénour (en 1513), le Lardeux (au XVIIème siècle), de Cadelac
seigneurs de Chaufour (vers 1719), Geffrault (en 1752). On 1513, Olive de
Guénour possède "le manoir de la Nourière, qui fut à Caris de
Guénour, duquel fut héritier Pierre de Guénour, écuyer, lequel le donna
à ladite Olive pour sa part en la succession de Robert de Guénour, leur
père" (Réformation de la noblesse). La famille Le Lardeux
possède ensuite la Nourière, qu'elle habite. Le 17 juin 1651 est inhumé
en l'église de La Couyère Louis Le Lardeux, seigneur de la Nourière, et
en 1659 Georges de Châteaugiron, dame de la Nourière. Pierre Le Lardeux et
Anne de Broise, seigneur et dame de la Nourière, sont mariés à
Saint-Martin de Janzé, le 7 février 1668, par Etienne Le Lardeux, recteur
de Tresboeuf. Leur fils nommé Gabriel Charles est baptisé le 25 octobre
1671, et leur fille nommée Suzanne, en 1672. Ce Gabriel Charles Le Lardeux,
seigneur de la Gastière, au Sel-de-Bretagne, épouse Anne de la Haye, dont
il a Guy Le Lardeux, baptisé à La Couyère le 10 juillet 1696. Leur fille,
Charlotte Le Lardeux, apporte la Nourière à son mari, Pierre de Cadelac,
seigneur de Chaufour, qu'elle épouse en 1719, et dont elle a plusieurs
enfants baptisés à La Couyère. Cette dame habite encore la Nourière en
1752, lorsqu'elle vend cette maison aux frères René et Julien Geffrault
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 8G, 67) ;
l'ancien
manoir de la Nourière (ou Norière), situé route de Janzé. Propriété successive des
familles Guénour (en 1513), le Lardeux (au XVIIème siècle), de Cadelac
seigneurs de Chaufour (vers 1719), Geffrault (en 1752). On 1513, Olive de
Guénour possède "le manoir de la Nourière, qui fut à Caris de
Guénour, duquel fut héritier Pierre de Guénour, écuyer, lequel le donna
à ladite Olive pour sa part en la succession de Robert de Guénour, leur
père" (Réformation de la noblesse). La famille Le Lardeux
possède ensuite la Nourière, qu'elle habite. Le 17 juin 1651 est inhumé
en l'église de La Couyère Louis Le Lardeux, seigneur de la Nourière, et
en 1659 Georges de Châteaugiron, dame de la Nourière. Pierre Le Lardeux et
Anne de Broise, seigneur et dame de la Nourière, sont mariés à
Saint-Martin de Janzé, le 7 février 1668, par Etienne Le Lardeux, recteur
de Tresboeuf. Leur fils nommé Gabriel Charles est baptisé le 25 octobre
1671, et leur fille nommée Suzanne, en 1672. Ce Gabriel Charles Le Lardeux,
seigneur de la Gastière, au Sel-de-Bretagne, épouse Anne de la Haye, dont
il a Guy Le Lardeux, baptisé à La Couyère le 10 juillet 1696. Leur fille,
Charlotte Le Lardeux, apporte la Nourière à son mari, Pierre de Cadelac,
seigneur de Chaufour, qu'elle épouse en 1719, et dont elle a plusieurs
enfants baptisés à La Couyère. Cette dame habite encore la Nourière en
1752, lorsqu'elle vend cette maison aux frères René et Julien Geffrault
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 8G, 67) ;
![]() l'ancien
manoir de la Verdière, situé route de Sainte-Colombe. En 1513, Pierre de
Guénour, seigneur de la Ville-Oger, fils aîné et héritier principal de
défunt Robert de Guénour, possède "le manoir de la Verdière".
En 1697, la Verdière appartient à Catherine Le Ray, femme séparée de
biens de François Gardin, sieur de Lestrillay, qui l'unit à cette époque
à la seigneurie du Plessix ;
l'ancien
manoir de la Verdière, situé route de Sainte-Colombe. En 1513, Pierre de
Guénour, seigneur de la Ville-Oger, fils aîné et héritier principal de
défunt Robert de Guénour, possède "le manoir de la Verdière".
En 1697, la Verdière appartient à Catherine Le Ray, femme séparée de
biens de François Gardin, sieur de Lestrillay, qui l'unit à cette époque
à la seigneurie du Plessix ;
![]() l'ancien
manoir de la Ville, situé route de Corps-Nuds. Propriété de la famille de
la Marzelière en 1513, puis de la famille de la Chevière, seigneurs du
Boishamon en 1679. En 1513, Renaud de la Marzelière, écuyer, possède "le
manoir de la Ville". En 1679, Pierre de la Chevière, seigneur du
Boishamon, avoue qu'il tient de la baronnie de Poligné la maison et
métairie de la Ville (Archives Nationales, P. 1710) ;
l'ancien
manoir de la Ville, situé route de Corps-Nuds. Propriété de la famille de
la Marzelière en 1513, puis de la famille de la Chevière, seigneurs du
Boishamon en 1679. En 1513, Renaud de la Marzelière, écuyer, possède "le
manoir de la Ville". En 1679, Pierre de la Chevière, seigneur du
Boishamon, avoue qu'il tient de la baronnie de Poligné la maison et
métairie de la Ville (Archives Nationales, P. 1710) ;
![]() l'ancien
manoir du Champ-Robert, situé route de Corps-Nuds. Propriété de
Marguerite de Guénour et de son mari Nicolas Bougas ou Rougeu en 1513 ;
l'ancien
manoir du Champ-Robert, situé route de Corps-Nuds. Propriété de
Marguerite de Guénour et de son mari Nicolas Bougas ou Rougeu en 1513 ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de LA COUYERE
La
montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à
La Couyère les nobles suivants :
" Françoys de Guénouz se présente monté et armé
en estat d'archer pour il et Rolland de Guénouz curateur du seigneur de La
Villoger. Et déclare tenir cinquante livres de rente. Et ledict Villoger LXX livres.
Et a requis estre adjoinct o Françoys de Channé qui tient XXXVI livres de rente, o Richard de La Graslotaye qui tient environ IX livres de revenu, o Jehanne de La [Fo...] [Note : Tout porte à croire que cette Jehanne de La Fo... et Jehan de La Fontayne, ne constituent, en fait, qu'un seul et même personnage dont le rapporteur aurait, tout d'abord, mal saisi le prénom : mêmes adjoints, même revenu] de Chasteaubourg qui tient XV livres de rente, Me Jehan de la Martinière qui est présent et déclare tenir environ dix livres de rente, mesmes o les aultres dénomméz par ledict Françoys de Channé. Luy sera faict raison. Et a faict le serment.
Jacques Le Lardeux se présente monté à cheval en robe pour Ollive de Guénouz et pour [...] et Jehan Gouyn et Marie Gouyn seigneurs et Dames du Breill Gouyn et de La Nollière [Note : Peut-être y a-t-il eu, ici, confusion avec la Nourière, en La Couyère. Cf. B.M.S.A.I.V., t. XVII, 1887, p. 257]. Et dit seullement lesdictz deux lieux valloir de revenu noble environ vignt ouict livres de rente. Et a requis l'adjonction des seigneurs de Lousséère, de Villoger et aultres [desnomméz] cy dessur. Et a faict le serment. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.