|
Bienvenue ! |
| Les Bénéfices du diocèse de Saint-Malo |
Retour page d'accueil Retour page Evêchés Bretons
|
|
Division
du diocèse en archidiaconés et doyennés. — Archidiaconé de Dinan et
doyennés de Poulet, Poudouvre, Plumaudan et Bécherel. — Archidiaconé de
Porhoët et doyennés de Beignon, La Nouée, Montfort et Lohéac. —
Tableau des principaux bénéfices du diocèse, abbayes, cures et prieurés,
avec les noms de leurs présentateurs. — Importance de chaque
présentateur.
|
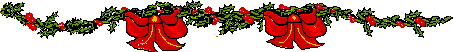
|
LES BENEFICES DU DIOCESE DE SAINT-MALO
Le diocèse de Saint-Malo renfermait 161 paroisses et 24 trèves, et était divisé en deux archidiaconés et huit doyennés. L'archidiaconé de Dinan comprenait : les quatre doyennés de Poulet, — Poudouvre, — Plumaudan — et Bécherel. L'archidiaconé de Porhoët comprenait : les quatre doyennés de Beignon, — La Nouée, — Montfort — et Lohéac. Il est certain que cette division du diocèse est très-ancienne ; cependant rien ne prouve, croyons-nous, l'assertion de l'abbé Manet, qui prétend qu'elle fut l'oeuvre de l'évêque Main, en 844. Nous ne parlerons pas ici des archidiacres, mais nous citerons quelques extraits des Statuts synodaux du cardinal de Montfort, en 1426, et de Mgr Le Gouverneur, en 1618, relatifs aux doyens ruraux du diocèse de Saint-Malo. « Les doyens ruraux, disent-ils, autrement nommés archiprestres, comme estant en plus éminent degré d'honneur, doivent par bonnes oeuvres donner exemple de lumière aux autres recteurs et prestres ; voire à tout le peuple qui habite par les paroisses de leur doyenné ; et remarquer d'une assidue circonspection la vie et le déportement des uns et des autres, pour Nous en tenir advertis et Nous ayder à extirper vices et planter vertus ». Les doyens doivent envoyer un prêtre le Jeudi-Saint chercher les saintes huiles à la cathédrale, « sous peine de payer un quart d'escu à chacun des recteurs du doyenné » ; mais pour subvenir aux frais du voyage fait pour cela à Saint-Malo, « lesdits doyens peuvent annuellement prendre de chaque recteur ou curé de leur décanat la somme de 6 sols et non plus ». Ils doivent régulièrement assister aux synodes « et y rendre raison des vices et delicts perpétrés en leurs doyennez et de la vie des recteurs et curés qui sont sous leur charge ». Les doyens ont enfin le privilège « de citer, chacun les delinquants et autres citables de son doyenné, par devant l'évesque ou ses officiaux, sans avoir besoin d'autre mandement spécial » (Statuts synodaux publiés en 1618, p. 102, 161, 529, etc.). Voici la nomenclature des paroisses de Saint-Malo d'après l'Etat du diocèse dressé par ordre de Mgr de la Bastie, évêque de 1739 à 1767 (nota : ce Pouillé ms., grand et beau volume d'environ 400 feuilles, renferme la description sommaire de toutes les paroisses du diocèse à cette époque ; il est aujourd'hui déposé aux Archives départementales).
I.— ARCHIDIACONE DE DINAN (82 paroisses et 6 trèves)
I. — DOYENNE DE POULET (11 paroisses) (nota : Nous ne savons pourquoi M. de Courson, dans son Supplément au Cartulaire de Redon, met le Poulet en dehors de l'archidiaconé de Dinan ; tous les Pouillés de Saint-Malo placent ce doyenné et la ville de Saint-Malo elle-même dans l'archidiaconé de Dinan. Il se pourrait bien cependant que dans l'origine, — avant, par exemple, la translation du siège épiscopal à Saint-Malo, — le territoire d'Aleth eût été placé, en dehors des autres circonscriptions, sous l'immédiate surveillance des évêques ; mais depuis bien des siècles il n'en était plus ainsi). Le territoire d'Aleth (pou-Aleth, pagus Alethi, par contraction Poulet) est ainsi désigné dans un acte de la première moitié du XIème siècle : « Est autem in regione Brittanie, que vocatur Pohelet, una villa que vocatur Cancavena, etc. ». Nous trouvons aussi en 1232 un Guillaume, doyen de Poulet, « decanus de Poelet » ; et en 1382 Guillaume Le Chat, doyen de Poulet et recteur de Saint-Jouan-des-Guérets, « Guillelmus Catus decanus de Pagealeto et S. Johannis de Garetis rector » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 380 ; II, 429).
II. — DOYENNE DE POUDOUVRE (24 paroisses et 3 trèves) Le nom breton de ce doyenné (pou-dour, pagus aquarum) indique sa haute antiquité : au XIIème siècle nous trouvons mentionnés des doyens de Corseul, « Hamon decanus de Corsot », Guillaume et Hingant, portant le même titre, ce dernier en 1184 (Cartulaire Sancti Albini de Nemore – Anciens Evêchés de Bretagne, III, 44, et IV, 360) ; au siècle suivant apparaît Robert, doyen de Poudouvre (1281). Nous ne savons au juste s'il y eut un doyenné de Corseul indépendant de celui de Poudouvre, ou si ce dernier doyenné porta quelque temps le nom de Corseul. — En 1324, Thomas Champion, doyen de Poudouvre, fonda, dit l'abbé Manet, la chapellenie de Saint-Louis dans la cathédrale de Saint-Malo.
III. DOYENNE DE PLUMAUDAN (26 paroisses et 1 trève) Vers 1200 vivait Josse, doyen de Plumaudan ; en 1272 apparaît Jean, « decanus de Plomaudan ».
IV. — DOYENNE DE BECHEREL (21 paroisses et 2 trèves) Robert de La Cadoyère, doyen de Bécherel, vivait en 1406, mais il est aussi fait mention d'un doyen de Combourg vers 1230 (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 889, et II, 775).
II.— ARCHIDIACONE DE PORHOET (79 paroisses et 18 trèves)
I. — DOYENNE DE BEIGNON (22 paroisses et 7 trèves)
II. — DOYENNE DE LA NOUEE (16 paroisses et 5 trèves)
III. — DOYENNE DE LOREAC (15 paroisses et 1 trève) Doyens de Lohéac : Geffroy (1163), Pierre Becdelièvre (1488).
IV. — DOYENNE DE MONTFORT (26 paroisses et 5 trêves) On trouve en 1200 : « P. decanus Montfortensis », et en 1230 « Guillaume de Carlou, doyen de Montfort ». De plus, l'Obituaire de Saint-Méen mentionne Etienne, doyen de Montfort, qui vivait en 1247 et 1260.
Les principaux bénéfices du diocèse de
Saint-Malo étaient : l'évêché, les cinq abbayes d'hommes de Saint-Méen,
Paimpont, Beaulieu, Saint-Jacques de Montfort et Saint-Jean-des-Prés, et
l'abbaye de femmes du Mont-Cassin, présentés par le roi et conférés par
le Pape ; — le doyenné du Chapitre, dont le titulaire était élu par le
Chapitre lui-même ; — les deux archidiaconats, la chantrerie, la théologale,
la pénitencerie et les autres canonicats, tous à la nomination de l'évêque
seul ; — les semi-prébendes, à la nomination du Chapitre ; — les
canonicats des collégiales de Dinan et du Guildo, à la nomination des
seigneurs de ces lieux, lorsqu'elles existaient (nota : elles avaient
disparu longtemps avant la Révolution) ; — les cures ou rectorats et les
prieurés dont la liste suit ; — enfin, les chapellenies et prestimonies
que nous retrouverons plus tard dans les paroisses où elles étaient fondées.
En résumé, le Roi présentait au Pape : l'évêque de Saint-Malo, — les abbés de Saint-Méen, — Paimpont, — Beaulieu, — Montfort, — Saint-Jean-des-Prés, — et l'abbesse du Mont-Cassin ; — â l'évêque : tous les prieurs de Marmoutiers et de Saint-Melaine. L'évêque nommait seul : les deux archidiacres, — le grand-chantre, — le théologal, — le pénitencier — et tous les autres chanoines de sa cathédrale ; — les recteurs de Beignon, — Mernel et Saint-Nicolas de Josselin, — et, en 1789, tous les recteurs dépendant jadis de Marmoutiers, de Saint-Melaine et de Léhon. L'évêque nommait alternativement avec le Pape : les recteurs de Châteauneuf, — Paramé, — Saint-Benoît-des-Ondes, — Saint-Jouan-des-Guérets, — Saint-Père-Marc-en-Poulet, — Saint-Servan, — Saint-Suliac, — Bourseul, — Langrolay, — Pleslin, — Pleurtuit, — Plorec, — Ploubalay, — Plouer, — Quévert, — Saint-Briac, — Saint-Enogat, — Saint-Lunaire, — Taden, — Trigavou, — Caulne, — La Chapelle-du-Lou, — Eréac, — Guenroc, — Guitté, — Landujan, — Lanrelas, — Médréac, — Plumaudan, — Plumaugat, — Saint-Jouan-de-l'Isle, — Saint-Maden, — Sévignac, — Trémeur, — Yvignac, — Dingé, — Langouët, — Lanrigan, — Longaulnay, — Lourmais, — Plouasne, — Saint-Gondran, — Saint-Léger, — Saint-Pern, — Augan, — Campénéac. — Caro, — Guer, — Comblessac, — Lieuron, — Loutehel, — Maure, — Maxent, — Néant, — Ploërmel, — Réminiac, — Saint-Abraham, — Saint-Malo de Beignon, — Gomené, — Saint-Martin de Josselin, — Ménéac, — La Nouée, — Taupont, — Bréal, — Goven, — Guignen, — Guipry, — Lohéac, — Pipriac, — Saint-Malo-de-Phily, — Saint-Senou, — Saint-Thurial, — Bois-Gervilly, — Clayes, — Concoret, — Coulon, — Le Crouais, — Saint-Léry, — Quédillac, — et deux des trois recteurs de Notre-Dame de Josselin. L'évêque nommait alternativement avec son Chapitre, le vicaire perpétuel de Saint-Malo, — et alternativement avec le seigneur de Montmuran, le recteur des Iffs. Le Chapitre nommait seul les recteurs de Cancale et de La Gouesnière, et alternativement avec l'évêque, le vicaire perpétuel de Saint-Malo. — Il nommait aussi seul son doyen, les quatre semiprébendés, plusieurs chapelains, le sous-chantre, le sacriste, les bacheliers de la cathédrale, etc. L'abbé de Saint-Méen nommait les recteurs de Gaël, — Montauban, — Saint-Jean de Montfort, — Saint-Onen, — Trémorel, — et dans l'origine ceux de Concoret, — Le Crouais, — Quédillac, — Saint-Léry, — Saint-Méen. — Il avait, en outre, les prieurés de Gaël, — Le Crouais, — Saint-Jean de Montfort, — Montreuil, — Saint-Onen — et Saint-Ganton. L'abbé de Marmoutiers présentait, dans l'origine, les recteurs de Saint-Malo de Dinan, — Bécherel, — Combourg, — Plouasne, — Le Quiou, — Guer, — Saint-Martin et Notre-Dame de Josselin, — Ménéac, — Iffendic — et Talensac. — Il avait les prieurés de Saint-Malo de Dinan, — Léhon, — Bécherel, — Combourg, — Saint-Nicolas de Guer, — Saint-Nicolas de Plermel, — Saint-Martin de Josselin — et Iffendic. L'abbé de Saint-Melaine nommait, dans l'origine, les recteurs de Comblessac, — Plélan-le-Grand, — Guichen, — Bédée, — Clayes, — Breteil, — les Iffs, — Irodouer, — Miniac, — Saint-Nicolas de Montfort — et Pleumeleuc. — Il avait les prieurés de Guichen, — Miniac, — les Moustiers, — Plélan-le-Grand, — Bédée, — les Brûlais — et Saint-Nicolas de Montfort. L'abbé de Saint-Jacut présentait, dans l'origine, les recteurs de Corseul, — Ploubalay, — Créhen, — Lancieux, — Trégon, — Saint-Sauveur de Dinan, — Tréméreuc — et la Trinité. — Il avait les prieurés de Bodieuc, — La Trinité, — l'Abbaye Saint-Maur, — Saint-Sauveur de Dinan, — Créhen — et Saint-Cadreuc. L'abbé de Saint-Florent de Saumur nommait primitivement les recteurs de Saint-Suliac, — Dingé, — Lanrigan — et Saint-Léger. — Il avait le prieuré de Saint-Suliac. L'abbé du Mont Saint-Michel présentait, à l'origine, les recteurs de Cancale, — Saint-Benoît-des-Ondes — et Saint-Méloir-des-Ondes. — Il avait les prieurés de Saint-Méloir-des-Ondes et de Ménéac. L'abbé de Saint-Gildas de Rhuys présentait le recteur de Saint-Nicolas de Josselin et avait le prieuré du même nom. L'abbé de Saint-Jouin de Marne présentait, à l'origine, le recteur de Saint-Jouan-de-l'Isle. L'abbé de Saint-Nicolas d'Angers présentait, à l'origine, le recteur de Saint-Pern et avait le prieuré du même nom. L'abbé de Redon présentait, à l'origine, les recteurs de Maxent et de Lohéac, et avait les prieurés de Maxent, — Lohéac — et Sainte-Croix de Josselin. L'abbesse de Saint-Georges de Rennes nommait les recteurs de La Baussaine, — Cardroc, — La Chapelle-Chaussée, — Langouët, — Saint-Domineuc, — Tinténiac, — Saint-Séglin. — Elle avait les prieurés de Saint-Séglin et de Tinténiac. L'abbesse de Saint-Sulpice-des-Bois nommait le recteur de Saint-Germain-des-Prés. — Elle avait les prieurés de la Ville-ès-Nonains, — Thélouët — et Saint-Nicolas-des-Prés. Le prieur de Léhon présentait originairement les recteurs de Trélivan, — Brusvily, — Calorguen, — Léhon, — Saint-Juvat, — Trévron, — Evran — et Trévérien. — Il avait les prieurés de Léhon et de la Mare-Normant. Tous les abbés, abbesses et prieur ci-dessus appartenaient à l'Ordre de Saint-Benoît. La Congrégation des Chanoines réguliers de Saint-Augustin avait les bénéfices qui suivent : L'abbé de Paimpont nommait, à l'origine, le recteur de Mauron et les prieurs-recteurs de Paimpont, — Saint-Brieuc de Mauron, — Tréhoranteuc, — Brignac, — Bruc — et Lassy. — Il avait les prieurés de Saint-Barthélemy-des-Bois, — Bouix, — Boussac, — Chantereine, — La Lande, — Coëtlan, — Guer, — Saint-Malo-des-Bois, — Sainte-Brigitte — et Sainte-Madeleine de Bréal. L'abbé de Montfort présentait le recteur de Treffumel et les prieurs-recteurs de Baulon, — Monterfil, — Saint-Gonlay, — Saint-Malon, — Saint-Maugand — et Romillé. — Il avait les prieurés de la Muce, Vaux et Saint-Péran. L'abbé de Beaulieu présentait les recteurs de Bourseul et Pleslin, et les prieurs-recteurs de Corseul, — Plélan-le-Petit, — Saint-Maudé, — Langadias, — Mégrit, — Vildé-Guingalan — et Trédias. — Il avait aussi le prieuré simple de la Vieille-Tour. L'abbé de Saint-Jean-des-Prés présentait les prieurs-recteurs de la Croix-Helléan, — Guillac, — Guilliers, — Loyat, — Mohon, — Pommeleuc — et Nôtre-Dame de Josselin. — Il avait le prieuré de Saint-Michel de Josselin. L'abbé de Rillé nommait le prieur-recteur de Québriac et avait, selon M. de Courson, le prieuré de Taupont. L'abbé de Sainte-Croix de Guingamp avait le prieuré de Saint-Georges de Trémeur. Les PP. de la Mission nommaient, au XVIIIème siècle, le recteur de Saint-Méen. Le général des Trinitaires avait les prieurés de Dinart et de Saint-Jacques de Dinan. Le commandeur de La Nouée nommait, à l'origine, le recteur de Vildé-Guingalan. Enfin,
les seigneurs du Plessis-Balisson, de Tréméreuc, de Broons, de Montmuran,
de la Hardouinaye et de la Chapelle-Bouexic, présentaient les recteurs du
Plessis-Balisson, — Tréméreuc (alternativement avec l'abbé Saint-Jacut),
— Broons, — les Iffs (alternativement avec l'évêque), — Merdrignac
et la Chapelle-Bouexic ; et les seigneurs de la Muce, de Merdrignac, de
Lohéac, de Bossac, du Molant et de Montfort, présentaient les prieurs de
la Muce, — Sainte-Brigitte, — Chantereine, — la Lande, — la
Madeleine de Bréal — et Saint-Lazare de Montfort. (extrait du Pouillé de Rennes) |
© Copyright - Tous droits réservés.